Lizzie Crowdagger's Blog, page 2
March 29, 2024
Final Fantasy 7 Rebirth : un petit arrière-gout de malaise
Discussion féministe du jeu vidéo Final Fantasy VII Rebirth, développé par Square Enix, et du petit arrière-gout malaisant qu’il m’a laissé.
Final Fantasy 7 RebirhFinal Fantasy VII est un jeu qui m’avait beaucoup marquée lors de sa sortie en 1997, et je l’avais d’ailleurs mentionné dans le stream sur les imaginaires politiques et féministes dans le cadre du marathon SF & Révolution.
Final Fantasy VII Rebirth est la deuxième partie d’une réinterprétation moderne, initée en 2020 par Final Fantasy VII Remake. Il parle de beaucoup de choses que je ne vais pas aborder ici, mais disons juste que c’est raffraichissant de pouvoir incarner des écoterroristes qui font exploser des réacteurs, même si l’intrigue parle rapidement aussi d’autres choses avec un méchant dark et charismatique et trop fort et avec une trop grosse épée qui s’appelle Sephiroth.
Et, globalement, si vous voulez mon avis rapide sur ce jeu, ça a été une claque. J’étais restée un peu mitigée avec le premier épisode, mais là en termes de jeu, de personnages, de mise en scène, c’est assez fabuleux, même s’il y a quelques défauts pénibles par moments (je pense fortement aux puzzles dans les donjons).
Bref cet article n’est pas une critique globale du jeu parce que je pense que j’aurais au final assez peu de choses à dire par rapport à ce qui a pu être dit ailleurs beaucoup plus tôt, et ça va peut donner l’impression que je suis super négative parce que je me concentre sur un point spécifique qui m’a mis un malaise, mais c’est juste que c’est parce que c’est là-dessus que j’estime avoir des choses à dire qui ont peut-être pas trop été dites ailleurs.
Spoiler et content warningCet article donne mon impression d’une partie de l’intrigue du jeu, donc ça nécessite de spoiler un minimum pour en parler. Si vous n’avez jamais fait Final Fantasy 7 du tout ni ce Rebirth et que vous êtes du genre à éviter les spoilers, ne lisez peut-être pas la suite. Ou peut-être que si si vous préférez savoir à l’avance quand il y a des thématiques liées aux violences faites aux femmes qui peuvent être malaisantes, honnêtement je ne sais pas.
Et du coup au passage, oui content warning : cet article va parler de violences sexistes.
Le personnage de CloudPour ça il faut commencer à parler du personnage de Cloud, qui est le protagoniste principal de Final Fantasy VII et que j’ai le souvenir d’avoir toujours un peu détesté. À l’époque, c’était parce que je découvrais ce jeu après avoir fait Final Fantasy VI, qui n’avait pas vraiment de personnage « principal » à proprement parler mais te laisser énormément de choix pour savoir avec qui tu jouais, sauf dans quelques passages clés, alors que Final Fantasy VII t’imposait de jouer ce personnage de Cloud, avec une intrigue en plus très centrée sur lui et ses problèmes d’identité.
En effet, on réalise assez vite qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec ce personnage, et on apprend au fur et à mesure qu’il a des souvenirs qui ne sont pas très fiables, qu’il y a des expériences avec l’énergie Mako qui font qu’il a une relation bizarre avec Sephiroth.
C’était déjà le cas dans l’original et c’est encore plus présent dans cette version Final Fantasy VII Re—, ce qui en soit n’est pas foncièrement un problème parce que je trouve que c’est globalement plutôt bien traité et qu’il peut y avoir un côté très satisfaisant quand tu revois l’histoire et que tu sais un peu ce qui se passe de te dire “ah mais oui c’est vrai qu’il y avait déjà ce moment ici”, etc.
Mon malaiseLe passage qui m’a mise mal à l’aise, c’est aux deux/tiers du jeu, au moment du réacteur de Gongaga, quand Cloud a une énième vision de Sephiroth et qu’on voit qu’il a clairement un gros problème, et que suite à cela il s’en prend à son amie d’enfance Tifa en lui donnant un coup d’épée. Pour éviter le coup d’épée, Tifa plonge dans la « mako » et en réchappe de justesse.
Pour le dire autrement : à ce moment là du jeu, Cloud, certes avec un jugement clairement altéré, est clairement auteur non seulement de violence sur une femme, mais aussi de tentative de féminicide, qui n’est évitée que grâce à la réaction éclair de Tifa.
Le jeu original était-il mieux ?Dans le jeu original, cette scène n’avait pas lieu. Il y en avait une autre assez similaire qu’on retrouve aussi plus ou moins à la fin de Rebirth sur Aerith, mais qui était un peu différente parce qu’au final Cloud ne passe pas à l’acte. (Et apparemment une autre scène de violence avec Aerith que j’avais oubliée et qui n’est — heureusement — pas présente dans cette nouvelle version.)
Par ailleurs, le réalisme était loin d’être le moindre et le jeu n’était pas séparé en trois épisodes. Il y avait un moment très malaisant après ce passage et jusqu’à ce que Cloud comprenne qui il est vraiment et se « reprenne », mais du coup au moins tu ne finissais pas un jeu avec un type qui peut potentiellement récidiver à tout moment.
Et puis, surtout, soyons honnête, je me posais moins de questions à l’époque, parce qu’il y a indéniablement plein de passages du jeu original qui sont bien plus cringe du point de vue féministe/LGBT que ce qu’on peut voir dans la nouvelle version.
Suite à ça, Tifa finit par ressortir de l’eau inanimée et Cloud a l’air un peu absent, suite à quoi Barrett lui colle une mandale et lui dit « reprends-toi pélo » et…
…
TOUT EST RÉGLÉ ?
Oui bon c’était pas terrible mais t’inquiète on continue non seulement à te garder dans la team comme si de rien n’était, à te placer en chef d’équipe, mais on te laisse garder ta PUTAIN D’ÉPÉE DE DEUX MÈTRES DE LONG AVEC TOI EN PERMANENCE ?
Alors certes on voit assez clairement que Barrett et Tifa ont l’air de se dire qu’il déconne un peu le Cloud, mais t’as vraiment l’impression que sinon ben voilà on fait avec il a essayé de tuer sa copine d’enfance mais c’est pas très grave.
Le problèmePour être honnête avec ça, même si j’aurais aimé que ce soit traité différemment (rien qu’un truc où à partir de ce moment les autres personnages retirent leur épée à Cloud et lui interdisent de prendre part aux combats, ce qui serait même pas gênant parce qu’il y a SIX autres personnages que tu peux jouer), le problème que j’ai ce n’est pas forcément que la réaction des autres personnages n’est pas réaliste. C’est bien le contraire.
Parce ce qui m’a sans doute mise le plus mal à l’aise, c’est que ça ressemble un peu trop à des situations réelles. Où des mecs se sont montrés violents avec une meuf mais, bon, il était pas dans son état normal et même s’il ne fait clairement rien pour éviter que la situation se reproduise quand même c’est un type sympa et cool et charismatique et qu’est-ce qu’on ferait sans lui.
Même dans des cas de mecs qui ont effectivement tué une femme, on a vu des hordes de fans hurler que le pauvre n’y était pour pas grand chose, un accès de colère ça arrive et c’était vraiment pas de bol qu’elle meurre, sans doute une chute malheureuse, les fils du destin tragique mais quand même, vous ne voudriez pas qu’il arrête de faire des concerts non plus ?
Mon malaise, c’est que les autres personnages ne réagissent pas, et qu’on doit continuer à jouer Cloud jusqu’à la fin du jeu, et probablement aussi dans le prochain, et qu’il continue à trimballer sa grosse épée tout le temps.
Alors, certes, on me dira peut-être que c’est une situation qui n’a quand même pas grand chose à voir avec la réalité vu que là c’est Sephiroth qui manipule le personnage et blablabla mais ça ressemble quand même un peu trop à des situations similaires avec des mecs violents qui affrontent sans doute aussi leurs démons.
J’aurais aimé adorerBref, à côté de ça j’ai trouvé le reste du jeu vraiment génial et c’est probablement un des jeux vidéos les plus solides auxquels j’ai joués ces dernières années, et je vais certainement pas vous dire de le boycotter. Malgré ça, j’aurais du mal à le recommander, ou en tout cas pas sans mettre ce bémol que ça peut être vraiment malaisant.
Et ça me rend un peu perplexe que dans toutes les discussions que j’ai vues autour de ce jeu après l’avoir fini j’ai jamais vu ce point vraiment évoqué. Alors certes c’est peut-être parce que c’était des mecs, mais peut-être aussi que c’est moi qui me plante, donc s’il y a des féministes qui ont fait ce jeu je serais curieuse de savoir si vous en avez pensé la même chose et si le dernier tiers du jeu vous a mis aussi mal à l’aise.
The post Final Fantasy 7 Rebirth : un petit arrière-gout de malaise first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
Final Fantasy 7 Rebirth : j’aurais aimé pouvoir le recommander
Discussion féministe du jeu vidéo Final Fantasy VII Rebirth, développé par Square Enix, et du petit arrière-gout malaisant qu’il m’a laissé.
Final Fantasy 7 RebirhFinal Fantasy VII est un jeu qui m’avait beaucoup marquée lors de sa sortie en 1997, et je l’avais d’ailleurs mentionné dans le stream sur les imaginaires politiques et féministes dans le cadre du marathon SF & Révolution.
Final Fantasy VII Rebirth est la deuxième partie d’une réinterprétation moderne, initée en 2020 par Final Fantasy VII Remake. Il parle de beaucoup de choses que je ne vais pas aborder ici, mais disons juste que c’est raffraichissant de pouvoir incarner des écoterroristes qui font exploser des réacteurs, même si l’intrigue parle rapidement aussi d’autres choses avec un méchant dark et charismatique et trop fort et avec une trop grosse épée qui s’appelle Sephiroth.
Et, globalement, si vous voulez mon avis rapide sur ce jeu, ça a été une grosse claque. J’étais restée un peu mitigée avec le premier épisode, mais là en termes de jeu, de personnages, de mise en scène, c’est assez fabuleux, même s’il y a quelques défauts pénibles par moments (je pense fortement aux puzzles dans les donjons).
Bref cet article n’est pas une critique globale du jeu parce que je pense que j’aurais au final assez peu de choses à dire par rapport à ce qui a pu être dit ailleurs beaucoup plus tôt, et ça va peut donner l’impression que je suis super négative parce que je me concentre sur un point spécifique qui m’a mis un malaise, mais c’est juste que c’est parce que c’est là-dessus que j’estime avoir des choses à dire qui ont peut-être pas trop été dites ailleurs.
Spoiler et content warningCet article donne mon impression d’une partie de l’intrigue du jeu, donc ça nécessite de spoiler un minimum pour en parler. Si vous n’avez jamais fait Final Fantasy 7 du tout ni ce Rebirth et que vous êtes du genre à éviter les spoilers, ne lisez peut-être pas la suite. Ou peut-être que si si vous préférez savoir à l’avance quand il y a des thématiques liées aux violences faites aux femmes qui peuvent être malaisantes, honnêtement je ne sais pas.
Et du coup au passage, oui content warning : cet article va parler de violences sexistes.
Le personnage de CloudPour ça il faut commencer à parler du personnage de Cloud, qui est le protagoniste principal de Final Fantasy VII et que j’ai le souvenir d’avoir toujours un peu détesté. À l’époque, c’était parce que je découvrais ce jeu après avoir fait Final Fantasy VI, qui n’avait pas vraiment de personnage « principal » à proprement parler mais te laisser énormément de choix pour savoir avec qui tu jouais, sauf dans quelques passages clés, alors que Final Fantasy VII t’imposait de jouer ce personnage de Cloud, avec une intrigue en plus très centrée sur lui et ses problèmes d’identité.
En effet, on réalise assez vite qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec ce personnage, et on apprend au fur et à mesure qu’il a des souvenirs qui ne sont pas très fiables, qu’il y a des expériences avec l’énergie Mako qui font qu’il a une relation bizarre avec Sephiroth.
C’était déjà le cas dans l’original et c’est encore plus présent dans cette version Final Fantasy VII Re—, ce qui en soit n’est pas foncièrement un problème parce que je trouve que c’est globalement plutôt bien traité et qu’il peut y avoir un côté très satisfaisant quand tu revois l’histoire et que tu sais un peu ce qui se passe de te dire “ah mais oui c’est vrai qu’il y avait déjà ce moment ici”, etc.
Mon malaiseLe passage qui m’a mise mal à l’aise, c’est aux deux/tiers du jeu, au moment du réacteur de Gongaga, quand Cloud a une énième vision de Sephiroth et qu’on voit qu’il a clairement un gros problème, et que suite à cela il s’en prend à son amie d’enfance Tifa en lui donnant un coup d’épée. Pour éviter le coup d’épée, Tifa plonge dans la « mako » et en réchappe de justesse.
Pour le dire autrement : à ce moment là du jeu, Cloud, certes avec un jugement clairement altéré, est clairement auteur non seulement de violence sur une femme, mais aussi de tentative de féminicide, qui n’est évitée que grâce à la réaction éclair de Tifa.
Le jeu original était-il mieux ?Dans le jeu original, cette scène n’avait pas lieu. Il y en avait une autre assez similaire qu’on retrouve aussi plus ou moins à la fin de Rebirth sur Aerith, mais qui était un peu différente parce qu’au final Cloud ne passe pas à l’acte. (Et apparemment une autre scène de violence avec Aerith que j’avais oubliée et qui n’est — heureusement — pas présente dans cette nouvelle version.)
Par ailleurs, le réalisme était loin d’être le moindre et le jeu n’était pas séparé en trois épisodes. Il y avait un moment très malaisant après ce passage et jusqu’à ce que Cloud comprenne qui il est vraiment et se « reprenne », mais du coup au moins tu ne finissais pas un jeu avec un type qui peut potentiellement récidiver à tout moment.
Et puis, surtout, soyons honnête, je me posais moins de questions à l’époque, parce qu’il y a indéniablement plein de passages du jeu original qui sont bien plus cringe du point de vue féministe/LGBT que ce qu’on peut voir dans la nouvelle version.
Suite à ça, Tifa finit par ressortir de l’eau inanimée et Cloud a l’air un peu absent, suite à quoi Barrett lui colle une mandale et lui dit « reprends-toi pélo » et…
…
TOUT EST RÉGLÉ ?
Oui bon c’était pas terrible mais t’inquiète on continue non seulement à te garder dans la team comme si de rien n’était, à te placer en chef d’équipe, mais on te laisse garder ta PUTAIN D’ÉPÉE DE DEUX MÈTRES DE LONG AVEC TOI EN PERMANENCE ?
Alors certes on voit assez clairement que Barrett et Tifa ont l’air de se dire qu’il déconne un peu le Cloud, mais t’as vraiment l’impression que sinon ben voilà on fait avec il a essayé de tuer sa copine d’enfance mais c’est pas très grave.
Le problèmePour être honnête avec ça, même si j’aurais aimé que ce soit traité différemment (rien qu’un truc où à partir de ce moment les autres personnages retirent leur épée à Cloud et lui interdisent de prendre part aux combats, ce qui serait même pas gênant parce qu’il y a SIX autres personnages que tu peux jouer), le problème que j’ai ce n’est pas forcément que la réaction des autres personnages n’est pas réaliste.
Parce ce qui m’a sans doute mise le plus mal à l’aise, c’est que ça ressemble un peu trop à des situations réelles. Où des mecs se sont montrés violents avec une meuf mais, bon, il était pas dans son état normal et même s’il ne fait clairement rien pour éviter que la situation se reproduise quand même c’est un type sympa et cool et charismatique et qu’est-ce qu’on ferait sans lui.
Même dans des cas de mecs qui ont effectivement tué une femme, on a vu des hordes de fans hurler que le pauvre n’y était pour pas grand chose, un accès de colère ça arrive et c’était vraiment pas de bol qu’elle meurre, sans doute une chute malheureuse, les fils du destin tragique mais quand même, vous ne voudriez pas qu’il arrête de faire des concerts non plus ?
Mon problème, c’est que les autres personnages ne réagissent pas, et qu’on doit continuer à jouer Cloud jusqu’à la fin du jeu, et probablement aussi dans le prochain, et qu’il continue à trimballer sa grosse épée tout le temps.
Alors, certes, on me dira peut-être que c’est une situation qui n’a quand même pas grand chose à voir avec la réalité vu que là c’est Sephiroth qui manipule le personnage et blablabla mais ça ressemble quand même un peu trop à des situations similaires avec des mecs violents qui affrontent sans doute aussi leurs démons.
J’aurais aimé adorerBref, à côté de ça j’ai trouvé le reste du jeu vraiment génial et c’est probablement un des jeux vidéos les plus solides auxquels j’ai joués ces dernières années, et je vais certainement pas vous dire de le boycotter. Malgré ça, j’aurais du mal à le recommander, ou en tout cas pas sans mettre ce bémol que ça peut être vraiment malaisant.
Et ça me rend un peu perplexe que dans toutes les discussions que j’ai vues autour de ce jeu après l’avoir fini j’ai jamais vu ce point vraiment évoqué. Alors certes c’est peut-être parce que c’était des mecs, mais peut-être aussi que c’est moi qui me plante, donc s’il y a des féministes qui ont fait ce jeu je serais curieuse de savoir si vous en avez pensé la même chose et si le dernier tiers du jeu vous a mis aussi mal à l’aise.
The post Final Fantasy 7 Rebirth : j’aurais aimé pouvoir le recommander first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
February 26, 2024
Wikipédia et le nécronyme des personnes trans : l’insoutenable neutralité du point de vue ?
Sur le bistro de Wikipédia, la discussion autour d’une potentielle annonce publique des sondages et décisions de vote est animée. « Ce qui se passe à l’intérieur de wikipédia n’a pas à en sortir », résume une contributrice.
Une position qui semble relativement partagée. Pourtant, Wikipédia n’est pas Las Vegas : la discussion a lieu sur une page publique accessible à n’importe qui et qui concerne des sondages et des prises de décision également accessibles publiquement.
Comment comprendre cette contradiction entre volonté de transparence et d’entre-soi ?
Un certain passif sur les questions de genreÀ l’origine de cette discussion, un sondage sur la mention du nom de naissance des personnes trans, qui cherche à tracer une voie entre deux objectifs contradictoires : une volonté encyclopédique d’une part, et le respect des personnes trans qui n’ont pas forcément envie de voir leurs nécronymes (deadnames, ou « noms de naissance ») sur un site aussi visible et référencé que Wikipédia.
Un débat compliqué : en 2022, un précédent sondage sur la même question avait été avorté et sources de nombreuses tensions. Tensions également quelques années plus tôt, lors d’un sondage autour de l’écriture inclusive en 2020.
L’association Les Sans Pages, un projet qui se donne pour but « de réduire le fossé des genres sur Wikipedia par la production d’articles sur l’encyclopédie, et l’organisation d’évènements et de formations pour promouvoir la participation et la visibilité des femmes aux projets Wikimedia », crystallise les critiques internes pour son côté « militant », soupçonné d’être en conflit avec la volonté encyclopédique et surtout à la neutralité de point de vue qui est un principe fondateur de Wikipédia. Il y a également des tensions avec l’association Wikimédia France (à ne pas confondre avec Wikipédia en français), avec là encore des soupçons de faire passer la lutte contre les discriminations avant la neutralité.
L’organisationPour mieux comprendre ce conflit, il faut s’intéresser à la façon dont sont organisés les différents projets Wikimédia, qui incluent Wikipédia pour l’encyclopédie, Wiktionary pour le dictionnaire, Wikimedia Commons pour les ressouces multimédia, Wikiquote pour les citations, etc.
La fondation WikimédiaÀ la base se situe la fondation Wikimédia. Cette organisation à but non lucratif états-unienne fournit les infrastructures (notamment l’hébergement Web) pour les différentes Wikipédias et autres projets Wikimédia. En dehors de quelques règles de base, elle n’a cependant pas de véritable rôle éditorial sur ces différents projets.
Les communautésIl y a différentes communautés pour chaque projet, mais aussi pour chaque langue : les règles ne sont donc pas forcément identiques entre les wikipédia francophone et anglophone.
Ces différents communautés sont largement autonomes, même si elles doivent tout de même respecter quelques règles de base.
Les associations localesDifférentes associations existent également et promeuvent la participation aux différents projets Wikimédia, ainsi que plus largement une diffusion libre des savoirs. Pour la francophonie, on y retrouve entre autres Wikimédia France, Wikimédia Belgique ou Wikimédia CH, qui sont reconnues comme « chapitres nationaux » par la fondation Wikimédia ; mais on retrouve également différentes associations gravitant autour, comme Les Sans-Pages.
Il y a évidemment des chevauchements : quelqu’un peut être membre d’une ou plusieurs assocations tout en participant à un ou plusieurs projets. Cependant, il peut y avoir aussi des tensions entre ces différentes entités.
Pour Max, la communauté est partagée entre deux courants :
D’un côté, les gens qui vont monter des associations type les sans pagEs ou Wikimédia France, qui pensent que Wikipédia appartient à tout le monde, que ce n’est pas normal qu’on soit si peu nombreu-x-es, et qui passent leurs week-ends à tenir des stands ou faire des ateliers pour attirer du monde.
De l’autre, les gens qui estiment que c’est « la communauté » qui est légitime, et s’étonnent que ces associations ont de l’argent / des dons / subventions, tout ça pour les dépenser dans des trucs pas « concrets ».
Ce scepticisme s’exprime par exemple en 2022 envers le soutien financé par cette association vers Les Sans-Pages, alors que :
[ses] principaux revenus sont les dons, recueillis grâce à la qualité du travail rédactionnel fourni bénévolement par la communauté ;la confusion Wikipédia / Wikimedia France dans l’esprit du public fait que toute action qui affecte l’image de l’association rejaillit sur celle de la communauté et sur celle de l’encyclopédie.Difficile neutralité
Wikipédia (et les différents projets Wikimédia) se fondent par ailleurs sur le principe de neutralité de point de vue, et celui-ci n’est pas négociable.
Ce principe, qui cherche à « présenter tous les points de vue pertinents, en les attribuant à leurs auteurs, mais sans en adopter aucun » s’applique à toutes les Wikipédias, et il faut reconnaitre que c’est sans doute en partie ce qui a permis à autant de contributeurs venant d’horizons et aux opinions différentes de construire ce qu’est l’encyclopédie aujourd’hui.
Cette approche ne trouve-t-elle pourtant pas ses limites lorsqu’on parle d’oppressions et de groupes minorisés ? « Quelle est la neutralité de point de vue, si ce n’est celui du groupe dominant dans la société ? », s’interroge ainsi Clara Sohet.
Pour Max, le problème n’est pourtant pas vraiment là :
Le principe de neutralité fait normalement la synthèse des sources existantes, donc il nous oblige par exemple à rapporter le point de vue de la psychanalyse sur la transidentité, mais en disant clairement « ceci n’est pas une vérité révélée, mais la position psychanalytique, qui est critiquée sur tel et tel point ».
Le souci, c’est la langue. Un impensé de Wikipédia est que tout est factoïde, que le débat ça va être si un point va être développé en une ligne ou trois paragraphes. Mais on ne peut pas avoir de position intermédiaire sur la langue, il faut trancher.
Ce n’est pas un hasard si l’autre sondage qui a provoqué une tension énorme c’est celui sur « l’écriture inclusive », comprendre l’utilisation du pronom “iel” et le point médian. Il n’y a pas de position intermédiaire posible : soit Wikipédia utilise “iel”, soit non.
Une nécessité de trancher que l’on retrouve pour les biograpies de personnes vivantes : comment tracer la ligne entre ce qui est « encyclopédique » (d’autres parleraient « d’intérêt public ») et ce qui relève de la vie privée ?
Les règles et usages s’élaborent et s’affinent donc à petits pas, à mesure qu’un « consensus » s’élabore. Revient alors la question cruciale de « qui prend les décisions ? ». La situation actuelle, où cela repose dans les faits sur les contributeurs les plus investis, et donc ayant assez de temps et les compétences pour, conduit donc inévitablement à un certain nombre de biais.
Démarchage et rameutageC’est dans ce contexte que s’ouvre le 12 février 2024 et pour deux semaines le sondage sur la mention du nécronyme des personnes trans.
Rapidement, celui-ci est relayé sur un message sur le réseau social Mastodon :
Si vous avez un compte Wikipédia avec au moins 50 edits sur l’espace principal (aka les articles), je vous enjoins à aller donner votre avis sur le sondage qui a été ouvert sur la question de la mention du deadname des personnes trans dans leurs articles
Le RT est vivement apprécié !
TW : TRANSPHOBIE (particulièrement en page de discussion)
Un appel qui ne passe par pour tout le monde, d’autant qu’il suscite un grand intérêt et est beaucoup partagé. Sur la page de discussion du sondage en question, le ton monte vite : mettant en avant la recommandation concernant le démarchage, certains parlent d’abord de démarchage incorrect ou abusif, puis de « rameutage » voire d’ « appel à la fraude électorale ». Le trigger warning (avertissement de contenu) parlant de transphobie est, de son côté, vu par certains comme une insulte.
Rapidement, il est demandé aux administrateurs de Wikipédia francophone de se prononcer sur l’exclusion d’un certain nombre de participant·e·s, pour propos « clivants » ou « agressifs » (ceux-ci dénonçant en face de la transphobie), mais aussi et surtout pour avoir (ou s’être) « rameuté ».
Ce n’est pas la première fois que la question du « rameutage » ou du « démarchage incorrect » se pose pour des sondages ou prises de décision sur Wikipédia. Il faut dire que les critères pour y participer sont — jusqu’ici — assez souples : il suffit d’avoir un compte sur Wikipédia crédité de plus de 50 contributions, des critères qui regroupent beaucoup plus de monde que le nombre habituel de personnes qui y participent effectivement.
La recommandation actuelle sur Wikipédia est de décourager tout appel sur les réseaux sociaux à participer à un sondage, au point de demander des sanctions contre les « wikipédien·ne·s » l’ayant fait. Cette limitation de circulation de l’information aux contributeurs les plus réguliers entre quelque peu en contradiction avec le fait que toutes ces discussions et décisions… sont visibles par tout le monde, compte Wikipédia ou pas, avec un encadré sur la page du sondage rappelant, non pas qu’il faut éviter de diffuser celle-ci, mais que « la présente page est publique et susceptible d’être très consultée, voire médiatisée ».
Une contradiction que ne comprennent pas forcément des personnes qui ont, de bonne foi, voulu participer au sondage et sont maintenant menacées de sanctions sur Wikipédia. « Je n’étais pas au courant de cette règle contre le démarchage », explique Clara Sohet, qui fait partie des personnes visées. « Clairement, une fois que j’ai su pour cette règle, je savais que j’étais carrément hors des clous, mais j’espérais m’en sortir en me disant que je n’avais dicté à personne comment voter exactement. »
Interdire la “publicité” des sondages est absurde. Si je comprends bien, ils ont eu des problèmes dans le passé. je pense que les limitations qui avaient été prévues pour le sondage (comptes ayant 50 participations sur les articles français au moment de l’ouverture du sondage) est une mesure de sécurité suffisante pour empêcher les comptes trolls de venir en masse.
pense, de son côté, Marc, également visé. Une approche loin d’être partagée par les tenanciers :
Le démarchage est la porte ouverte à tout groupe de pression, idéologique, politique, religieux, financier etc. Il doit être combattu fermement. La crédibilité de Wikipedia est en jeu, car on en arriverait à un système où qui rameute le plus de trolls a raison.
argumente JohnNewton8, qui ne voit pas la contradiction avec le fait que ces pages soient publiques :
Des prises de décision en petit groupeCe n’est pas un referendum ouvert à tous, ni une pétition qu’on ferait circuler, ça ne concerne que les bénévoles qui construisent l’encyclopédie. À l’Assemblée, au Sénat, les débats sont publics. Ça ne veut pas dire que les députés demandent au public leur avis.
Un argument qui peut surprendre. Dans cette métaphore, n’importe quel contributeur ayant plus de 50 contributions serait lui-même député, et quiconque a déjà un peu suivi ce qu’il se passe au parlement aura bien remarqué qu’un « rameutage » dans ce cadre n’est pas vraiment susceptible de sanctions.
Cette logique est cependant plus compréhensible lorsqu’on regarde quelques chiffres : il y a en ce moment 17 860 utilisateurs actifs (ayant fait une modification dans les 30 derniers jours), contre plus de quatre millions de compte sur la Wikipédia francophone. En miroir, la plupart des décisions et des sondages sont d’ordinaire clos avec autour d’une centaine d’avis, là où le sondage sur la question du nécronyme des personnes trans en recueille déjà près de trois fois plus.
La règle formulée officiellement est donc qu’il suffit d’avoir contribué à plus de cinquante modifications d’articles, mais l’usage en pratique est très différent : ne participent à ces sondages et décisions que les personnes qui sont très impliquées dans Wikipédia, connaissent bien ses arcanes et suivent ce qui se passe derrière la partie émergée visible lorsque l’on consulte l’encyclopédie :
Tout le monde doit pouvoir contribuer à Wikipedia. Mais pour commencer à donner son avis il faut en maîtriser les règles, ce qui impose une assiduité et une ancienneté significatives.
explique JohnNewton8. Il faut dire que des règles et recommandations, il y en a un grand nombre à avoir en tête, sans même parler des usages et du vocabulaire très spécifique qui peuvent rendre les discussions entre « wikipédien·ne·s » assez hermétiques aux nouveaux-venus.
Avec le « rameutage » par les réseaux sociaux de personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie, cet usage est donc chamboulé, et les habitué perçoivent cette vague d’intrus — même ayant les cinquante contributions réglementaires — comme un coup de force.
Suite à ce sondage, deux propositions ont d’ailleurs émergé chez les habitués de Wikipédia : communiquer plus largement sur les votes et les sondages (et donc rapprocher la pratique de la règle officielle), ou « durcir » les conditions de participation (et donc rapprocher la règle officielle de la pratique).
Pour l’instant, c’est plutôt la seconde approche qui semble tenir la ligne, et l’heure semble plutôt à resserrer les rangs qu’à les ouvrir.
Des sanctions très mal perçuesAlors que le sondage approche de sa clôture, des sanctions sont prises par les administrateurs, et plusieurs personnes voient ainsi leur compte Wikipédia bloqués pour une durée indéfinie.
Marc et Clara Sohet font partie des personnes voyant leur compte bloqué de façon définitive, et ont l’impression d’avoir affaire à un deux poids, deux mesures :
La personne qui a été la plus violente envers nous, bien qu’apparemment elle soit récidiviste, ne risque, elle que trois jours de blocage
La nouvelle du blocage (in)définitif de quelques personnes trans pour « démarchage incorrect » et « règles de savoir-vivre » est rapidement relayée sur les réseaux sociaux, poussant l’association Toutes des femmes à communiquer :
Bien qu’initialement ouvert à tout contributeur·ice ayant un minimum de 50 contributions, la participation à ce sondage s’est rapidement verrouillée. Accusés de “propagande”, et de manque d’objectivé, de nombreux·ses contributeur·ices trans en ont été exclu·es.
Des contributeur·ices trans rapportent avoir été bannis définitivement de Wikipédia pour avoir soulevé leurs inquiétudes et signalé l’existence de ce sondage, tandis que des contributeur·ices ayant tenu des propos manifestement transphobes n’ont été que légèrement sanctionné·es.
Pourtant, mentionner systématiquement les anciens prénoms des personnes trans sur leur page Wikipédia représenterait bien une grave atteinte à leur vie privée, et contribuerait à les mettre toujours davantage en danger dans la société.
Ces comportements ne peuvent que continuer à exclure les personnes marginalisées des contributions à Wikipédia. Wikipédia en français doit entendre la voix des contributeur·ices trans et allié·es et les prendre au sérieux. Cette conversation ne peut avoir lieu sans elles.
Pour ce qui est de prendre en compte les rapports d’oppression, ce n’est donc peut-être pas tant la volonté de neutralité de point de vue qui pose problème, que la manière d’appliquer les « règles de savoir-vivre » et la façon dont la violence verbale est perçue :
Le « TW : transphobie » a été vu comme de la diffamation, alors que des propos transphobes « polis » sont passés crème,
explique Max.
Une façon de faire qui n’est pas sans rappeler la notion de Tone policing, ou police du ton… dont on ne trouve pour l’heure pas de page sur la wikipédia francophone.
Une question qui ne concerne pas que WikipédiaÉvidemment, les sanctions entrainent de nouvelles critiques sur les réseaux sociaux ; sur Le Bistro de Wikipédia, le sentiment de citadelle assiégée est encore renforcé. Alors que la publicité de ce sondage aurait pu être l’occasion d’expliquer les rouages internes de Wikipédia, et de pousser plus de personnes à s’y impliquer, elle n’aura fait que renforcer les fractures et les tensions.
Les différents articles qui sont sortis au cours de cette polémique montrent par ailleurs que le problème n’est pas spécifique à Wikipédia. Celui de France Inter, par exemple, fait intervenir un « sociologue spécialisé dans les questions de genre » (à défaut d’avoir trouvé une personne trans à interroger) pour parler des implications concrètes que peut avoir le fait de dévoiler le nom de naissance d’une personne trans, en particulier dans une période qui voit une montée de la transphobie.
Malheureusement, plutôt que de montrer que les mêmes questions peuvent se poser dans le journalisme, l’article arrive à illustrer parfaitement (et ironiquement) le problème… en se concluant sans réfléchir sur le nécronyme d’une personne trans.
(Modifié pour corriger “projets MediaWiki” en “projets Wikimédia”, Mediawiki étant le logiciel utilisé par les projets Wikimédia mais aussi tout un tas d’autres wikis)
The post Wikipédia et le nécronyme des personnes trans : l’insoutenable neutralité du point de vue ? first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
February 12, 2024
Flipper Zéro et Parcoursup : l’obscurité par la sécurité
Au Canada, le gouvernement a annoncé interdire l’importation du Flipper Zero pour réduire les vols de voitures. En France, il refuse de publier le code source de Parcoursup, en mettant en avant de nombreuses failles de sécurité. Ces deux cas relèvent de ce qu’on appelle la sécurité par l’obscurité. À moins que ça ne soit l’inverse ?
Le Canada, Flipper Zero et les voituresAprès une recrudescence de vol de voitures, le gouvernement canadien, via la voix (ou plutôt un tweet) de son ministre de l’innovation, des sciences et de l’industrie, a :
annoncé que nous interdisions l’importation, la vente & l’utilisation de dispositifs de piratage, comme les “flippers”.
François-Philippe Champagne, sur Twitter
Le Flipper Zero est un petit dispositif plutôt mignon, qui ressemble à l’enfant d’une clé USB et d’un tamagotchi, qui se présente comme un « appareil multi-outils pour geek » et est un engin pratique pour faire joujou avec des puces RFID ou NFC, du Blueetooth, de l’infrarouge et tout un tas d’autres choses auxquelles je dois admettre ne pas forcément tout comprendre.
Il est apparemment très pratique pour le pen testing, ou test de pénétration, qui consiste à évaluer la sécurité d’un système informatique.
Le problème, évidemment, c’est lorsqu’on produit un système informatique très mal sécurisé et qu’on n’a jamais pen testé.
Quoi qu’il en soit, les capacités réelles du Flipper Zero, aussi adorable soient-ils, semblent tout de même légèrement fantasmées : n’espérez pas acquérir cet engin pour pouvoir démarrer n’importe quel voiture ou dupliquer la carte bancaire de votre oncle (mais, avec un peu de chance, vous arriverez à ouvrir la trappe à rechargement d’une Tesla).
Alex Kulagin, le directeur des opérations de Flipper Zéro, a ainsi déclaré pour Gizmodo :
Flipper Zero ne peut pas être utilisé pour voler une quelconque voiture, et spécifiquement pas celles produites après les 1990s, car leurs systèmes de sécurité ont des codes tournant. Par ailleurs, cela requerrait de bloquer activement le signal depuis le propriétaire original, ce que le matériel de Flipper Zero est incapable de faire. Flipper Zero est destiné au développement et aux tests de sécurité et nous avons pris les précautions nécessaires pour nous assurer que l’appareil ne puisse pas être utilisé à des fins néfastes.
Personnellement, ce que je mettrais surtout en avant, c’est que si un constructeur met sur le marché une voiture qui peut être piratée aussi facilement, alors sa responsabilité devrait clairement être engagée et c’est plutôt elle qui porte une lourde part de responsabilité que le vendeur d’un gadget électronique.
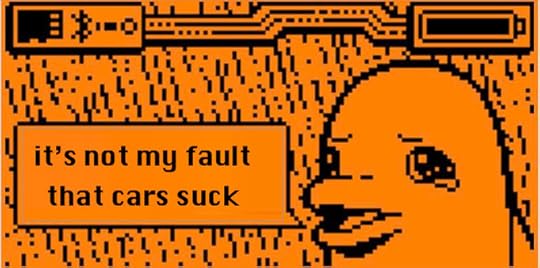 Source : Hacker Meme sur MastodonLa France, la transparence et Parcoursup
Source : Hacker Meme sur MastodonLa France, la transparence et ParcoursupEn attendant, en France, vous avez toujours le droit (pour l’instant) de commander un Flipper Zero, mais comme je n’ai pas de lien affilié avec Amazon ou un autre vendeur, je ne vais pas forcément vous recommander de le faire (personnellement, j’avoue que j’ai failli craque l’été dernier parce que c’est vraiment mignon et cool, mais, soyons honnête, je m’en serais peut-être servie deux heures). Ce qui n’empêche pas cette approche particulière de la sécurité informatique, consistant à essayer de cacher les problèmes sous le tapis, d’être aussi présente dans l’actualité hexagonale.
Récemment (enfin c’était en novembre mais on n’en a parlé que récemment), en effet, la justice a donné raison au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui refusait de publier le code source de Parcoursup (article ZDNet), malgré un avis favorable de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) après une demande de l’association Ouvre Boite.
La raison invoquée par le ministère est quelque peu croustillante, puisqu’on peut lire dans la décision de justice que le ministère mettait en avant que « le code source comportait de nombreuses vulnérabilités ».
Nulle doute que tous les élèves qui sont obligé·e·s de confier toutes leurs données personnelles (ainsi que leur avenir) à cette boite noire seront heureu·x·ses d’apprendre que le gouvernement lui-même dit que son système est troué comme du gruyère.
L’obscurité par la sécuritéAu départ, j’avais envie de mettre ces deux actualités en parallèle, parce qu’il me semblait que, dans les deux cas, il s’agissait d’une approche de sécurité par l’obscurité, qui consiste à baser sa sécurité non pas sur la robustesse des algorithmes de cryptographie, mais sur le fait qu’ils sont tenus — plus ou moins — secrets.
Pourtant, dans le cas de Parcoursup, il me semble assez probable que la sécurité ne soit, en réalité, qu’un prétexte pour que le code source en question ne soit pas rendu accessible, et ce malgré l’avis de la CADA. Il y a quelques mois, La Quadrature du Net avait publié des analyses de l’algorithme de la CAF qui montraient son caractère discriminant. On peut raisonnablement supposer que le gouvernement n’a pas forcément envie que l’algorithme de Parcoursup soit scruté de la même manière.
Mais même pour le cas canadien, il est évident qu’interdire l’importation du Flipper Zero ou autres engins équivalents (ce qui parait compliqué, parce qu’un smartphone jailbreaké permet déjà de faire pas mal de choses similaires) ne permettra probablement pas de réduire le nombre de voitures volées, et qu’il s’agit plutôt d’un moyen facile pour un politicien de faire croire qu’il agit.
Et, concernant la sécurité, il est évident qu’il n’y a pas que dans le domaine de l’informatique que des politiciens aiment bien utiliser ce prétexte pour se mettre en avant et ne pas avoir à répondre sur les questions gênantes.
Bref si la sécurité par l’obscurité est une approche aux résultats plus que mitigés, l’obscurité par la sécurité a, elle, de beaux jours devant elle.
The post Flipper Zéro et Parcoursup : l’obscurité par la sécurité first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
February 9, 2024
Like a Dragon Infinite Wealth : une suite dispensable ?
Critique du jeu vidéo Like a Dragon : Infinite Wealth, développé par Ryū Ga Gotoku et publié par Sega
Tl;DrJe fais un titre un peu trompeur pour faire croire que je vais critiquer mais j’ai évidemment adoré même si je trouve dommage qu’il reste enfermé par l’héritage des épisodes précédents
Dans les épisodes précédentsLike a Dragon : Infinite Wealth est la suite de Yakuza : Like A dragon, qui est sans aucun doute le jeu qui m’a le plus marquée ces dernières années, puisqu’il m’a non seulement fait faire l’intérêt des jeux Yakuza/Like a dragon (une petite dizaine en tout) mais est aussi clairement une source d’inspiration majeure pour mon projet actuel de roman au nom de code mystérieux 8–9‑3.
Trivia nulL’origine du mot « yakuza » apparaît sous le shogunat des Tokugawa (1603–1867). Il est tiré d’une combinaison du jeu de cartes japonais appelé oicho-kabu, proche du baccara, qui est traditionnellement joué avec des cartes de kabufuda ou de hanafuda. À la fin d’une partie, les valeurs des cartes sont additionnées et l’unité de la somme représente le score du joueur. Le but du jeu est de s’approcher le plus de 9.
« Ya » vient de yattsu, qui signifie huit (peut également se dire hachi), « ku » veut dire neuf (le mot kyu est aussi utilisé), et « za » est sans doute une déformation de « san » qui veut dire trois. Ya-ku-za est donc la somme de 8, 9 et 3, soit 20 et donc un score de 0, qui est une main perdante. Ce nom signifie donc « perdants », « bons à rien ». Les yakuzas sont à l’origine issus des plus pauvres, des exclus de la société.
(La page Wikipédia de Yakuza)
Yakuza : Like a Dragon était à l’époque un nouveau départ pour la série de jeux Yakuza, centrée à la fois sur un nouveau personnage et avec un tout nouveau système de jeu, et marque aussi le rebranding de Yakuza en Like a Dragon en Occident, ce qui rend la numérotation et les titres inutilement compliqués, mais voilà.
En japonais, Like a Dragon : Infinite Wealth s’appelle juste 龍が 如く8 (Ryū Ga Gotoku 8, ou en français Tel un dragon 8) et est la suite de 龍が如く7. Le jeu est développé par le studio 龍が如くスツジオ (Ryū Ga Gotoku Studio) et, voilà, là tout a le même nom c’est beaucoup plus simple.
Contrairement à ses prédécesseurs, qui adoptaient un style que certain·e·s ont pu qualifier de beat’em all (tabassez-les tous) mais était déjà en vrai fortement empreint d’éléments de RPG, Like a Dragon : Infinite Wealth relève du JRPG pur et dur au tour par tour. Ce qui est cohérent avec le choix comme personnage principal d’Ichiban Kasuga, ancien yakuza, perdant magnifique et sorte de Don Quichotte qui se prend pour un héros de Dragon Quest. On suivait donc son parcours, et Kazuma Kiryu, le protagoniste des jeux précédents, n’apparaissait que très brièvement et de manière relativement anecdotique.
Aujourd’hui encore, je recommande vraiment cet épisode si vous voulez découvrir la série, d’une part parce que je pense que c’est celui dont je préfère l’intrigue et aussi parce que grâce à ce choix de se centraliser sur un nouveau personnage il y a au final assez peu de références aux jeux précédents.
Ce n’est pas tout à fait le cas de cette suite, Like a Dragon : Infinite Wealth, qui non seulement reprend le personnage d’Ichiban Kasuga mais voit aussi réapparaitre Kazuma Kiryu comme personnage important. Il faut dire qu’entre-temps il y a eu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, où il était à nouveau le protagoniste et qui voyait son point de vue pendant les évènements de Yakuza : Like a Dragon. Ouais, c’est un peu le bazar.
Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il est indispensable d’avoir fait Yakuza : Like a Dragon avant de jouer à ce nouvel opus, parce que l’intrigue reste complète en elle-même, mais si vous êtes du genre à vouloir voir les films dans l’ordre même quand ils sont à peu près indépendants, oui ça peut être mieux de commencer par celui-là.
Gameplay : du mieux en tout pointSi ce nouveau Like a Dragon se déroule en bonne partie dans un nouveau lieu, Hawaï, du point du système de jeu il ne déboussolera pas les personnes qui se sont essayées au précédent : il s’agit donc d’un JRPG au tour par tour punchy et efficace. Le système est peaufiné et amélioré : on peut maintenant déplacer son personnage, faire des attaques de dos, plus d’attaques en utilisant des accessoires (comme le fameux plot de circulation).

Globalement j’ai beaucoup aimé ce système de combat, qui a l’avantage de proposer des combats qui sont à la fois assez rapides et très cinématiques. En revanche ne vous attendez pas non plus à des sommets de tactique : clairement, ce qui compte avant tout c’est d’avoir suffisamment de niveaux et du matériel suffisamment puissant, et si certains bosses demanderont un peu de concentration on est loin des exigences que peuvent demander des RPG tactiques comme X‑Com ou Fire Emblem.
Comme pour le précédent, on a un système de jobs qui permet de beaucoup s’amuser et de varier un peu, avec des métiers toujours aussi barrés : sabreur, surfeur, hôte, pistolero, etc. pour les hommes, championne de tennis, idole, domina, etc. pour les femmes. Ce qui m’amène à ma critique principale dans ce système : cette répartition genrée des métiers est non seulement affreusement sexiste mais limite aussi inutilement les possibilités.
Autre petit point négatif : s’ils sont intéressants, les combats peuvent parfois être nombreux, et auraient sans doute gagné, lorsqu’on se déplace en ville, à être moins nombreux et/ou plus facilement esquivables.
À cette boucle de gameplay principale s’ajoutent tout un tas d’activités annexes, dont les classiques bornes d’arcade, jeux de cartes, shogi ou mah-jong, practice de golf ou de base-ball, et évidemment l’indispensable karaoké. En plus de ces habituels, il y a aussi quelques « gros morceaux » spécifiques à chaque épisode et dont je ne parlerai pas plus en détail parce qu’autant perso je me fiche qu’on me divulgâche l’histoire mais j’aime bien être surprise par la présence d’un mini-jeu. Il y aura en tout cas de quoi faire, et le jeu est diablement généreux.
Ce qui m’amène tout de même à une troisième critique, qui peut s’appliquer à l’ensemble des jeux de la franchise : malheureusement, ces jeux « annexes » ne le sont pas entièrement. Contrairement à un jeu comme Elden Ring qui fait confiance aux joueu·r·se·s et rend possible de complètement zapper une majorité du jeu, le studio Ryū Ga Gotoku a la fâcheuse tendance à vouloir absolument vouloir montrer ses gros minis-jeux dans l’intrigue principale. Cela conduit à devoir parfois passer une demi-heure dans un mini-jeu (ou une intrigue secondaire) avant de pouvoir reprendre la suite de l’aventure principale, plutôt que de pouvoir tomber dessus à son propre rythme à un moment où on a plutôt envie d’explorer ou de farmer des points d’expérience ou de l’argent.
Une intrigue moins génialeSi la série des Yakuza/Like a Dragon est toujours très généreuse en termes de gameplay différents, elle l’est aussi en scènes cinématiques et dialogue, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. Personnellement, j’adore, et j’ai l’impression de binge-watcher une bonne série télé, mais je conviens que tout le monde n’apprécie pas de pouvoir poser la manette pendant tellement longtemps que la console va finir par mettre un message « Attention je vais me mettre en veille si t’appuies pas sur un bouton ».
Comme d’habitude, la mise en scène est d’excellente qualité et arrive à rendre un dialogue d’une dizaine de minutes intéressant. Même chose pour les acteur·ice·s, et comme pour l’épisode précédent le jeu dispose de sous-titres français (pas de doublage VF par contre) et une traduction de bonne qualité, même si j’ai observé quelques petites erreurs qui auraient pu être corrigées (et qui l’ont peut-être été depuis, j’ai vu qu’il y avait eu un patch parlant de localization issues, à voir).
Bref, on est plutôt sur du très bon, le jeu arrivant toujours à surfer sur la ligne de crêtes entre choses sérieuses et dramatiques et un côté absurde et humoristique. Comme d’habitude, il essaie aussi d’aborder un peu certaines thématiques sociales, comme la réintégration des anciens yakuzas, les personnes à la rue, ou la question des déchets que les pays riches voudraient juste pouvoir mettre sous le tapis. On est pas forcément sur un film de Ken Loach mais c’est toujours agréable de voir certains jeux vidéos parler de manière frontale de thématiques actuelles.
Malgré tout ça, je ne peux pas m’empêcher d’être un peu mitigée, parce que je trouve qu’on reste quand même un peu en deça de l’épisode précédent.
J’ai hésité à faire une section « avec spoilers » pour détailler exactement tous les points qui m’ont un peu posé problème mais je réalise que c’est plus « Comment j’aurais fait si c’était moi qui était scénariste » et ça n’a pas forcément grand intérêt.
Je dirai donc juste que, contrairement à son prédécesseur, je trouve que l’intrigue de ce jeu est lestée par les épisodes précédents, avec Kazuma Kiryu qui revient prendre beaucoup de place dans l’histoire en faisant essentiellement du Kazuma Kiryu, ce qui en soi peut donner des histoires intéressantes mais qu’on a déjà vues dans Yakuza Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Like a Dragon : Gaiden.
À côté de ça, on a finalement assez peu de nouveaux personnages et, s’il n’est pas désagréable de retrouver Ichiban Kasuga, je ne suis pas sure que j’avais besoin de l’avoir en personnage principal. L’histoire d’Ichiban Kasuga était géniale dans le jeu précédent mais pour moi elle est plus ou moins conclue. J’aurais été contente qu’il apparaisse comme personnage jouable mais que l’intrigue tourne plus autour des nouveaux personnages et que ceux-ci soient plus approfondis.
Point positif à noter tout de même : malgré ma critique sur l’aspect sexiste du système de jobs, on a pour une fois un certain nombre de personnages féminins (on n’atteint certes pas la parité dans les personnages jouables pour autant), et que j’ai trouvées plutôt bien traitées, ce qui n’est pas toujours le cas dans les intrigues des jeux de cette série.
Fallait-il vraiment que ce soit une suite ?S’agit-il donc d’une suite dispensable ? Eh bien, par certains côtés, non, parce que je suis contente que ce jeu ait existé et il m’a fait passer un très bon moment. En revanche, je pense vraiment qu’il n’était pas indispensable qu’il s’agisse d’une suite.
Après la sortie de Yakuza 6, la série, jusqu’ici centrée sur Kazuma Kiryu, commençait à s’essoufler. Le studio Ryū Ga Gotoku avait relancé les choses en lançant deux nouveaux jeux, centrés sur deux nouveaux personnages : d’un côté Judgment, spin-off centré sur le personnage de Yagami, un détective anciennement avocat, et de l’autre Yakuza : Like a Dragon centrée sur le personnage de Kasuga.
Les deux étaient, à mon avis, géniaux. Malheureusement, je ne suis pas sure que Ryū Ga Gotoku ait tiré les bonnes leçons de ce succès car, plutôt que de faire de nouveaux, certes dans le même univers et la même franchise, mais avec des nouveaux personnages et de nouvelles histoires, ils ont entre temps fait Lost Judgment, qui reprenait le personnage de Yagami, Like a Dragon : Gaiden, qui reprenait le personnage de Kiryu, et donc ce Like a Dragon : Infinite Wealth qui reprend le personnage de Kasuga.
Gageons que pour les épisodes suivants, le studio aura la sagesse d’explorer de nouveaux personnages et ne voudra faire autant d’épisodes centrés autour de Kasuga qu’il n’en a fait sur Kiryu.
The post Like a Dragon Infinite Wealth : une suite dispensable ? first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
January 6, 2024
Bilan auto édition 2023
C’est le début d’année, et comme chaque année depuis un moment c’est l’occasion de faire un petit bilan sur mes activités d’auto-édition. Et, comme chaque année depuis un moment à peine moins court, on va pas se mentir, c’est plutôt morose, au point où j’en viens à me demander si ça sera pas le dernier.
ActivitéSi 2022 était catastrophique, 2023 arrive à être pire, puisque je n’ai rien proposé de nouveau cette année. Rien, zéro, nada. Bon, c’est peut-être un tout petit peu trompeur parce que le temps d’écriture est un temps long et qu’il y a quand même eu un peu de travail qui, espérons-le, débouchera sur quelque chose de concret en 2024, mais ça craint quand même, d’autant plus qu’une partie importante de mes revenus vient de personnes qui me soutiennent sur Patreon pour, à priori, que je leur propose de nouvelles choses.
J’y reviendrai en conclusion mais je pense que la question se pose d’arrêter cette aventure.
(Mise à jour : prise par le côté négatif j’avais omis de partager les quelques chiffres que je peux donner, qui ne sont pas ouf mais permettent un peu d’objectiver voire de relativiser les choses.)
Si, du point de vue des titres sortis, mon travail peut ressembler au néant complet, il y a quelques indicateurs qui permettent de dire que mon activité était moins catastrophique que 2022 :
Mots écrits : 17000J’ai essayé de faire le NaNoWriMo, sans réussir à boucler l’objectif des 50000 mots dans le mois, mais en arrivant tout de même à en écrire à peu près le tiers pour un projet que j’espère pouvoir finaliser. Je n’ai pas de comparatif avec les années précédentes parce que je n’ai pas forcément pour habitude de mesurer cela mais je vais peut-être le faire de façon plus régulière si ça permet de me motiver (ou peut-être que ce sera juste pénible, donc on verra).Contributions sur Github : 361 (contre 63 en 2022)
Là, ça mesure l’activité de mon compte Github, sur laquelle sont stockés à la fois mes textes publics, mais aussi des dépôts privés pour mes travaux en cours (ou certains qui sont publiés d’ailleurs mais pas sous licence libre), ainsi que pour tout ce que je fais au niveau programmation, notamment Crowbook, l’outil que j’utilise pour mettre en page tous ces romans. Donc ce n’est pas forcément un très bon indicateur de ce que j’ai fait en termes d’écriture, mais le fait qu’il y ait une activité beaucoup plus conséquente en 2023 qu’en 2022 est un peu encourageant.
(Il faudrait par ailleurs aussi que je me pose à un moment la question de rester sur Github ou pas, mais c’est une autre histoire.)
Nombre de ventes
Même s’il n’y a pas de vraies nouvelles sorties, j’ai tout de même remis en ligne le Crowpack (que j’avais oublié de mettre sur le nouveau site), qui regroupe tous mes textes disponibles sous licence copyleft. J’ai également le Ravenpack, qui vous propose pour le coup tous mes textes auto-édités pour une somme modique. Ça fait que malgré l’absence de vraie nouvelle sortie, les ventes sont à peu près les mêmes qu’en 2022, c’est-à-dire de toute façon assez basses.
RemarqueCes chiffres ne concernent que les ventes de livres en auto-édition, et donc ne prennent pas en compte Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), Enfants de Mars et de Vénus, ni Créatures de Rêve, qui sont édités par Dans nos histoires dans le circuit plus «traditionnel». Aussi, ils ne sont pas forcément fiables à 100%, mais ça donne une idée.
Numérique/Ebooks : 94 ( 83 l’an passé)Amazon : 51 (54%) (
83 l’an passé)Amazon : 51 (54%) ( 36 l’an passé)Kobo : 11 (12%) (
36 l’an passé)Kobo : 11 (12%) ( 22 l’an passé)Ko-Fi: 18 (19%) (= 18 l’an passé)Autres : 14 (15%) (
22 l’an passé)Ko-Fi: 18 (19%) (= 18 l’an passé)Autres : 14 (15%) ( 5 l’an passé)Papier : 40 (= 40 l’an passé)Total : 134 (
5 l’an passé)Papier : 40 (= 40 l’an passé)Total : 134 ( 123 l’an passé)
123 l’an passé)Donc, voilà, mêmes causes, même conséquences, c’est à peu près la même chose que l’an passé.
Je me rends compte que dans ces bilans je ne faisais que les bilans par canaux de vente et pas par titre, et j’ai la flemme de refaire une liste détaillée par titre, mais grosso-modo celui qui se vend le « plus » en numérique est Punk is undead avec une cinquantaine de ventes (wouhou) tandis qu’en papier c’est La sorcellerie est un sport de combat avec 25 exemplaires, ce qui est à la fois très peu et finalement pas si mal en auto-édition vu si ces livres peuvent être commandées en librairie ils sont disponibles à très, très peu d’endroits.
Chiffre d’affaireAllez maintenant on fait entrepreneuse et on parle de chiffre d’affaires sérieux. Comme d’habitude, c’est l’occasion de remercier les personnes qui me soutiennent financièrement malgré ma production inexistante 


Globalement c’est très similaire à l’année passée, il y a quelques différences par-ci par là mais qui sont surtout dû à des fluctuations normales.
Il y a cependant une différence majeure mais qui ne se voit pas : la fermeture de uTip du jour au lendemain au milieu de l’année. Comme en général je touchais l’argent sur uTip quelques mois après les dons ça ne se voit pas forcément pour cette année, mais ça veut dire que pour l’année prochaine il y aura probablement une baisse importante parce que si une partie des gens ont migré sur Patreon, ce n’est pas le cas de tout le monde, ce que je peux comprendre aisément.
Auto-édition : 2075€ ( 1802 l’an passé)Abonnements (Patreon/utiip) : 1202€ (
1802 l’an passé)Abonnements (Patreon/utiip) : 1202€ ( 1938 l’an passé)Royalties (Amazon/Kobo/Smashwords/BOD) : 377€ (
1938 l’an passé)Royalties (Amazon/Kobo/Smashwords/BOD) : 377€ ( 288 l’an passé)Ventes et dons directs via le site : 437€ (
288 l’an passé)Ventes et dons directs via le site : 437€ ( 298 l’an passé)Droits d’auteurs : 210€
298 l’an passé)Droits d’auteurs : 210€Bref je suis toujours partagée sur comment analyser cette somme, parce que d’un côté ça me permet clairement de garder la tête un peu hors de l’eau et de compléter des allocations pas follichonnes, n’ayant plus d’autres revenus à côté. De l’autre, c’est clairement pas une rémunération qui permet vraiment d’en vivre et de rien chercher à côté, et donc dans le fait d’avoir une partie du temps (et surtout d’énergie on va pas se mentir) bouffé par de la recherche d’emploi même si celle-ci n’a malheureusement rien donné. (Nique le capilisme).
Et maintenant ?Clairement, il est hors de question que je fasse un bilan similaire en 2024 et, si c’est le cas, je pense qu’il sera temps de mettre la clé sous la porte. Ce qui ne veut pas dire que je fermerai le site ou quoi, mais que j’arrêterai notamment la page Patreon.
Donc si je vous ai pas proposé au moins un nouveau truc en 2024, ce sera le clap de fin. J’espère encore que ce ne sera pas le cas et que j’arriverai à finir au moins un des projets que j’ai commencés.
En attendant, je vous souhaite une bonne année 2024, ou en tout cas une pas trop mauvaise ce qui vu les circonstances serait déjà pas si mal. Prenez soin de vous, prenons soin les un·e·s des autres, et 

 !
!
The post Bilan auto édition 2023 first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
Bilan 2023
C’est le début d’année, et comme chaque année depuis un moment c’est l’occasion de faire un petit bilan sur mes activités d’auto-édition. Et, comme chaque année depuis un moment à peine moins court, on va pas se mentir, c’est plutôt morose, au point où j’en viens à me demander si ça sera pas le dernier.
ActivitéSi 2022 était catastrophique, 2023 arrive à être pire, puisque je n’ai rien proposé de nouveau cette année. Rien, zéro, nada. Bon, c’est peut-être un tout petit peu trompeur parce que le temps d’écriture est un temps long et qu’il y a quand même eu un peu de travail qui, espérons-le, débouchera sur quelque chose de concret en 2024, mais ça craint quand même, d’autant plus qu’une partie importante de mes revenus vient de personnes qui me soutiennent sur Patreon pour, à priori, que je leur propose de nouvelles choses.
J’y reviendrai en conclusion mais je pense que la question se pose d’arrêter cette aventure.
Nombre de ventesMême s’il n’y a pas de vraies nouvelles sorties, j’ai tout de même remis en ligne le Crowpack (que j’avais oublié de mettre sur le nouveau site), qui regroupe tous mes textes disponibles sous licence copyleft. J’ai également le Ravenpack, qui vous propose pour le coup tous mes textes auto-édités pour une somme modique. Ça fait que malgré l’absence de vraie nouvelle sortie, les ventes sont à peu près les mêmes qu’en 2022, c’est-à-dire de toute façon assez basses.
RemarqueCes chiffres ne concernent que les ventes de livres en auto-édition, et donc ne prennent pas en compte Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), Enfants de Mars et de Vénus, ni Créatures de Rêve, qui sont édités par Dans nos histoires dans le circuit plus «traditionnel». Aussi, ils ne sont pas forcément fiables à 100%, mais ça donne une idée.
Numérique/Ebooks : 94 ( 83 l’an passé)Amazon : 51 (54%) (
83 l’an passé)Amazon : 51 (54%) ( 36 l’an passé)Kobo : 11 (12%) (
36 l’an passé)Kobo : 11 (12%) ( 22 l’an passé)Ko-Fi: 18 (19%) (= 18 l’an passé)Autres : 14 (15%) (
22 l’an passé)Ko-Fi: 18 (19%) (= 18 l’an passé)Autres : 14 (15%) ( 5 l’an passé)Papier : 40 (= 40 l’an passé)Total : 134 (
5 l’an passé)Papier : 40 (= 40 l’an passé)Total : 134 ( 123 l’an passé)
123 l’an passé)Donc, voilà, mêmes causes, même conséquences, c’est à peu près la même chose que l’an passé.
Je me rends compte que dans ces bilans je ne faisais que les bilans par canaux de vente et pas par titre, et j’ai la flemme de refaire une liste détaillée par titre, mais grosso-modo celui qui se vend le « plus » en numérique est Punk is undead avec une cinquantaine de ventes (wouhou) tandis qu’en papier c’est La sorcellerie est un sport de combat avec 25 exemplaires, ce qui est à la fois très peu et finalement pas si mal en auto-édition vu si ces livres peuvent être commandées en librairie ils sont disponibles à très, très peu d’endroits.
Chiffre d’affaireAllez maintenant on fait entrepreneuse et on parle de chiffre d’affaires sérieux. Comme d’habitude, c’est l’occasion de remercier les personnes qui me soutiennent financièrement malgré ma production inexistante 


Globalement c’est très similaire à l’année passée, il y a quelques différences par-ci par là mais qui sont surtout dû à des fluctuations normales.
Il y a cependant une différence majeure mais qui ne se voit pas : la fermeture de uTip du jour au lendemain au milieu de l’année. Comme en général je touchais l’argent sur uTip quelques mois après les dons ça ne se voit pas forcément pour cette année, mais ça veut dire que pour l’année prochaine il y aura probablement une baisse importante parce que si une partie des gens ont migré sur Patreon, ce n’est pas le cas de tout le monde, ce que je peux comprendre aisément.
Auto-édition : 2075€ ( 1802 l’an passé)Abonnements (Patreon/utiip) : 1202€ (
1802 l’an passé)Abonnements (Patreon/utiip) : 1202€ ( 1938 l’an passé)Royalties (Amazon/Kobo/Smashwords/BOD) : 377€ (
1938 l’an passé)Royalties (Amazon/Kobo/Smashwords/BOD) : 377€ ( 288 l’an passé)Ventes et dons directs via le site : 437€ (
288 l’an passé)Ventes et dons directs via le site : 437€ ( 298 l’an passé)Droits d’auteurs : 210€
298 l’an passé)Droits d’auteurs : 210€Bref je suis toujours partagée sur comment analyser cette somme, parce que d’un côté ça me permet clairement de garder la tête un peu hors de l’eau et de compléter des allocations pas follichonnes, n’ayant plus d’autres revenus à côté. De l’autre, c’est clairement pas une rémunération qui permet vraiment d’en vivre et de rien chercher à côté, et donc dans le fait d’avoir une partie du temps (et surtout d’énergie on va pas se mentir) bouffé par de la recherche d’emploi même si celle-ci n’a malheureusement rien donné. (Nique le capilisme).
Et maintenant ?Clairement, il est hors de question que je fasse un bilan similaire en 2024 et, si c’est le cas, je pense qu’il sera temps de mettre la clé sous la porte. Ce qui ne veut pas dire que je fermerai le site ou quoi, mais que j’arrêterai notamment la page Patreon.
Donc si je vous ai pas proposé au moins un nouveau truc en 2024, ce sera le clap de fin. J’espère encore que ce ne sera pas le cas et que j’arriverai à finir au moins un des projets que j’ai commencés.
En attendant, je vous souhaite une bonne année 2024, ou en tout cas une pas trop mauvaise ce qui vu les circonstances serait déjà pas si mal. Prenez soin de vous, prenons soin les un·e·s des autres, et 

 !
!
The post Bilan 2023 first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
November 20, 2023
Inscrivez-vous à notre Newsletter : le tracking généralisé
Ça fait un bout de temps que les newsletters reviennent à la mode. Si c’est parfois le cas venant de particuliers, c’est aussi particulièrement présent dans un certain nombre de journaux que je consulte régulièrement.
Pourtant, j’ai du mal à me laisser convaincre. Déjà, je reçois bien assez de mails comme ça, et je préfère consulter des articles dans mon navigateur (Firefox, évidemment) quand j’en ai envie plutôt que des les voir mélangés à des trucs auxquels je dois répondre plus ou moins urgemment (et à bonne quantité de spam).
Et puis, je suis d’une nature suspicieuse. Pourquoi est-ce que tous ces gens tiennent à me communiquer leurs articles par e‑mail ? Est-ce que ce ne serait pas, justement, pour avoir mon e‑mail ? Et ensuite pouvoir l’utiliser pour faire… des choses pas très claires avec ?
L’expérienceAujourd’hui, je décide d’en avoir le cœur net, et de voir ce que que je manque : je me crée une adresse, news@crowdagger.fr, juste pour ça. Et je vais m’abonner à ces news letters.
Problème : j’aimerais bien pouvoir distinguer qui a eu accès à tel mail. Je pourrais faire une adresse différente par endroit où je m’inscris, mais ce serait vite pénible, même avec des alias. Je me rappelle heureusement qu’il est possible d’ajouter un champ à la fin de son adresse mail, mais je ne sais plus exactement comment. Je pars donc pour demander sur Mastodon, mais, alors que je rédige le message en cherchant un exemple de ce que je veux, la solution me revient en tête : il est possible d’ajouter « + » dans la partie identifiant de son adresse mail. Ainsi, je pourrais m’abonner à Mediapart avec l’adresse «news+mediapart@crowdagger.fr» et au Monde avec «news+monde@crowdagger.fr». Bon, je m’envoie un mail à moi-même avant pour vérifier que ça marche. Youpi, c’est parti, je vais enfin pouvoir voir ce que j’ai raté.
Je me dis que ça va être turbo-facile, et que je vais juste avoir à copier/coller mon adresse mail sur tous ces différents journaux. Mais ce n’est pas toujours aussi simple.
MediapartSur Mediapart, il faut passer par une page sur laquelle on peut choisir d’un coup toutes les newsletters auxquelles on veut s’abonner. Cool ! J’avais beau être abonnée Mediapart, je ne pensais pas qu’il y en avait autant. Je m’inscris à beaucoup, mais pas à toutes. Je rentre mon adresse mail et je fais « valider mes choix». C’était facile !
Une question me titille cependant. Est-ce que ce n’est pas un peu trop facile ? Et si j’avais mis l’adresse mail de quelqu’un d’autre pour le pourrir ? Sûrement que je vais recevoir un mail qui va me demander de confirmer en cliquant sur un lien ? Effectivement, je reçois immédiatement un mail. Mais rien à confirmer, ça me dit juste que mon inscription a été prise en compte.
Arrêt sur images et LibérationSur Arrêt sur images, c’est aussi simple. Et toujours pas de confirmation par e‑mail pour vérifier que c’est bien le mien. Heureusement que personne n’aurait l’idée d’inscrire quelqu’un à ce genre de choses contre son gré !
Chez Libé c’est ici. Alors je pense que sur le principe c’est censé être aussi simple, mais la page a du mal à s’afficher chez moi, il faut dire que j’ai pas mal de bloqueurs de publicités et de de javascript externe. Mais en désactivant un peu mon niveau de protection je paviens à m’inscrire.
Le MondeAvec Le Monde, c’est un peu plus lourd : je odis créer un compte. Au moins, ça permet de vérifier que le mail est bien le mien et que je n’inscris pas quelqu’un d’autre. Et je suis même positivement surprise : une fois connectée, la page ne me permet pas juste de m’inscrire à une newsletter, mais aussi de consulter les newsletters passées. Je peux les regarder quand je veux et sans polluer mes mails, c’est formidable le progrès !
Le Figaro et Basta!Comme pour Le Monde, il faut se créer un compte. Contrairement au Monde, pour créer un compte il ne faut pas juste rentrer son adresse mail mais aussi rentrer un nom, un prénom, une civilité (juste Monsieur ou Madame, on est au Figaro, pas chez les queeros).
Pour Basta!, comme pour le Figaro, il faut mettre son nom et son prénom en plus de l’adresse mail. Pas de civilité, en revanche, et pas de création de compte.
Premier bilan temporaireJe décide de m’arrêter là pour ce soir. Dans ma boite mail nouvellement créée, j’ai une dizaine de mails de bienvenue sur des newsletters diverses. Aucune information concrète pour l’instant, 100% de bruit : j’ai peut-être la promesse d’avoir par la suite des informations intéressantes, mais pour l’instant, beaucoup d’effort pour pas grand chose.
Pour tous les mais que j’ai reçu, mon client me prévient : « Pour protéger votre confidentialité, les ressources distantes ont été bloquées. » Les ressources distantes, c’est typiquement mettre un lien vers une image plutôt que l’image elle-même dans le corps du mail. Ça permet de réduire un peu la bande passante — l’image ne sera téléchargée que quand vous choisirez de lire le mail, et ne le sera pas si vous l’ignorez. C’est, aussi, une mine d’or pour l’analyse des données : il suffit de modifier un peu l’adresse de l’image pour chaque mail envoyé pour savoir quel utilisateur a ouvert tel mail ou pas. C’est pour ça que les client mails décents bloquent le chargement : c’est une fuite de données potentielle majeure.
Un tracking généraliséOn peut egarder un peu plus à quoi ressemblent ces liens pour se faire une idée : si on a juste un nom de fichier genre “banniere.jpg”, il y a peu de chance que chaque accès à ce fichier puisse être relié à mon adresse mail. En revanche, si le fichier s’appelle “4834832842982.jpg”, il est beaucoup plus possible que ce numéro soit relié à mon adresse à moi, et distinct pour quelqu’un d’autre. Si l’image est un pixel blanc caché dans un coin de la page qui s’appelle “43433842249.jpg”, on peut se dire qu’il n’est pas là pour des raisons esthétiques.
Résultat des courses :
le mail de Mediapart contient une image de 1px sur 1px dont l’URL est https://info.mediapart.fr/optiext/optiextension.dll?ID=gOxL091wsQ0kcN1kap%2BXKc1Urm12FBj%2BHVXz0ZJRiPo0QFHXb4rA1Eaqr%2Bd_a6ilYHsZdOfCMrfN4_ryw60ZUf94gAle mail d’Arrêt sur Images contient une image de 1px sur 1px dont l’URL est https://arretsurimages.us11.list-manage.com/track/open.php?u=11ea85761d70cb652e11fd80b&id=6ad3b82969&e=dd0dda9474le mail de Libération contient une image de 1px sur 1px dont l’URL est https://newsletter.liberation.fr/m/opening/200138/503974/4ibGJx13NrWi7Q1-IqT_KnFKF-B12viezBEiZxMr5xU=/transpix.gifle mail du Monde contient une image de 1px sur 1px dont l’URL est https://u8504822.ct.sendgrid.net/wf/open?upn=V0ERLDq26X4nvWNb01zFJ3PlrMOUMn0F20eBkapwqV5sBSHQl818x9uPokBrADCU17Fq2lPyUiJNhtd7fUTAAfZMyJRKAtYoQn-2F5fttKlsplX5qbUFbGB2jZgB9LHus88rB2ZDtm-2B1XOBoymAx-2BxzHl66xyqYt2T-2B0OcNspV9-2FM-2FIdpktLiHSCLf0QiVQeV6owza0F0dlzZvysCZlRJVBfZT7PtjLIubT2XNss-2F-2Ff-2FM-3Dle mail du Figaro contient une image de 24px sur 24px (redimensionnée à 1px sur 1px) dont l’URL est http://url6991.moncompte.lefigaro.fr/wf/open?upn=IDkkKrIkmxUQKL6UAsmzwmAXymW-2BgZpsr8WDzTBJoFFENgKKjh284wetZw-2BfpswAl2wClTeRkBLO4-2BaWHMB0bO7JkSh8r8pAxQEcRv7G2oxDo2czmxMSC18dlEQWeyObJuetg4p7VHkBS7dpKLay77bYJCLAH-2BChBwcusUXfv7nhy5UytGhPj5o5d9TmFa1en8r1wInUTqn1tAi-2FFf2d3QA44dlDy2QrbJtxirDoDj0-3Dle mail de Basta! contient une image de 1px sur 1px dont l’URL est https://fgdafii.r.bh.d.sendibt3.com/tr/op/wf1jzYGxTNggWCy9vE6SomrrcS8UQCZMDW2XcAd4l0tV3PfBc5xfmunvahYiTzJekza7l-_gJJyGlcnT6k12uO-YTYaG1Qu_3q7plSetND21pcILInh3-5RbsYZY6bxbGUkbVX3Du2xpNowUmOCniRn0dzKx5Qz4el9RQW-Htfg7jMG-1fFoA_iLhPznOZNQHy9ZeSqUV3_MYamEp3_5HxuMopaWGTOzqISiJbooBref, pour l’instant, je n’ai reçu aucune information intéerssante via ces newsletters, mais tous ces journaux ont jugé indispensable de mettre une image de 1px sur 1px à une adresse permettant, je le suppose, de savoir que c’est bien moi qui ai regardé le mail. Une pratique de tracking détestable que je pensais bien voir utilisée par certains, mais dont je suis déçue de voir qu’elle est en fait généralisée à tous.
Pas de bons élèves pour cette fois, et mon impression initiale en sort renforcée : et si toutes ces newsletters servaient surtout, au final, à collecter plus de données ?
The post Inscrivez-vous à notre Newsletter : le tracking généralisé first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
November 3, 2023
NaNoWriMo ? (Début de roman)
Ça y est, on est en novembre, mois du NaNoWriMo — National Novel Writing Month, défi qui consiste à écrire un roman (en tout cas, 50000 mots, ce qui fait un petit roman) en un mois. Je suis d’habitude assez réticente à ce genre de défis un peu stakhanovistes, mais comme ma productivité littéraire est un peu au point mort ces dernières années, je me suis dit que j’allais essayer d’y participer, sans forcément atteindre la barre fatidique des 50000, en sachant que ce serait de toute façon toujours mieux que rien.
Voilà donc l’introduction du projet sur lequel je travaille, qui a pour l’instant comme working title « 8–9‑3 ». Il est évidemment tout à fait incertain que cela se concrétise en un vrai roman, ni en un texte achevé, mais je me suis dit que je pouvais déjà au moins partager ça. Si vous avez des retours, n’hésitez pas, ce qui rend le travail d’écriture particulièrement compliqué c’est qu’il est très solitaire et qu’on a en général des critiques uniquement des années après que le texte initial ait été rédigé.
8–9‑3
お前にひとつ良いこと教えていてやる。極道ってのはなあ ボクシングとは 違え。喧嘩に負けたヤツが敗者になるんじゃねえ。最後まで 「張り続けら れなかった」ヤツが負けるんだよ。
(久瀬 大作)
Je vais t’apprendre un truc intéressant. Dans le monde des yakuzas, ce n’est pas comme à la boxe. La personne qui s’écroule, ce n’est pas elle qui perd. Celle qui perd, c’est celle qui ne peut pas tenir jusqu’au bout.
(Daisaku Kuze)
Le coup de pied me cueille dans les côtes et j’étouffe un gémissement de douleur.
— Ça t’apprendra à te mêler de ce qui te regarde pas, dit le type au bout du pied.
Un homme moyen-grand, avec des cheveux bruns et une petite barbiche. De carrure sportive, je l’appelle l’Équilibré.
Ils sont trois à me tabasser, et on croirait le choix de personnages dans un vieux jeu de castagne à l’époque de la Megadrive : il y avait toujours un personnage d’Équilibré, un Bourrin plus lent mais qui frappait plus fort, et un (souvent une) Agile qui se distinguait par sa rapidité plus que par la puissance de ses coups.
En l’occurrence, le Bourrin est un type énorme au crâne rasé qui fouille mon portefeuille, et l’Agile une personne svelte aux cheveux bruns un peu plus longs en sidecut avec un perfecto noir.
Pour l’instant, c’est surtout l’Équilibré qui m’a cogné.
— Naomi, hein ? demande le Bourrin.
Je me dis que c’est le bon moment pour tenter une bravade.
— Si vous pensez me déstabiliser en m’apprenant mon prénom, vous vous rendez compte que je le connais déjà, hein ?
J’en ai profité pour essayer de me redresser un peu. Mauvaise idée. En représailles, l’Agile m’envoie un nouveau coup de pied, qui me fait bizarrement plus mal que ceux de l’Équilibré. Peut-être parce qu’iel frappe plus fort, ou peut-être juste à cause des rangers coquées.
— C’est pas le moment de faire la maligne.
Malheureusement pour elle, Naomi ne brillait pas forcément par sa capacité à savoir quand il ne fallait pas faire la maligne. De manière générale, ses aptitudes à appréhender correctement la réalité étaient assez discutables. Sinon, elle ne se serait probablement pas retrouvée là, en pleine nuit, en train de se faire dérouiller sur un bord de départementale mal éclairée.
Pendant qu’elle se tortillait de douleur, le plus grand continuait à examiner sa carte d’identité.
— Ou « le malin », ajouta-t-il. Le sexe sur la carte d’identité…
— Wow, wow, l’interrompit immédiatement la personne qui venait de donner le coup de pied. On va vraiment partir sur des attaques transphobes ?
L’homme au crâne rasé haussa les épaules.
— Rien de personnel, mais je me disais qu’on pouvait utiliser un côté plus psychologique.
— Je suis pas du genre à invoquer le code d’honneur en permanence, mais, et quoi, après ? On va aussi se mettre aux agressions sexuelles ?
— Je pense qu’on peut éviter tout ça, trancha le troisième homme en regardant la jeune femme qui était à ses pieds. Je dirais qu’elle a compris la leçon.
C’était, cependant, une hypothèse clairement optimiste, car Naomi essayait une nouvelle fois de se relever.
— Et trois contre un, c’est dans le code d’honneur ? demanda-t-elle avec défi.
L’Agile se vexe et se penche immédiatement sur moi pour placer une main autour de mon cou.. De l’autre, iel tient une lame qui a surgi de nulle part et brille des reflets de la lune.
L’Équilibré, lui, soupire.
— Tu ne sais vraiment pas quand te taire, hein ?
— Tu as peut-être cru qu’il s’agissait d’un combat loyal en un contre un ? demande l’Agile en me fixant avec des yeux qui sont peut-être plus menaçants que sa lame. On est juste venu·e·s te coller une petite raclée d’avertissement, parce qu’on est gentil·le·s et qu’on ne veut pas directement passer aux choses trop sérieuses. Mais peut-être que je devrais te couper la langue pour éviter que tu la remues ?
— Oh, raille le Bourrin. Alors, les allusions transphobes, c’est over the line, mais le couteau et les mutilations c’est friendly ?
L’Agile fait un tsk avec sa langue.
— On rediscutera de ça quand on sera seul·e·s, tu veux bien ?
Iel reporte ensuite son attention sur moi.
— Maintenant, tu dis gentiment « j’ai compris » et on passe à autre chose.
— Compris quoi ? Vous pensez me faire peur ?
Cette fois ci, c’est iel qui soupire et, d’agacement, m’envoie son poing à la figure avec la main qui tenait le couteau. Ça assome, mais au moins, iel ne m’a pas effiloché.
— J’ai une idée, commente le Bourrin. C’est un peu psychologique, mais pas over the line.
***
Thibault gara sa Mazda MX‑5 à côté des conteneurs à poubelles, puis fit le tour de son véhicule, ouvrit le coffre, et attrapa le cabas contenant les emballages.
Ce n’était d’évidence pas l’heure à laquelle les gens étaient supposés aller poser leurs ordures, car le lampadaire le plus proche était à une bonne vingtaine de mètres et n’éclairait du reste que moyennement bien. Thibault s’était fait avoir l’autre fois, lorsqu’il était venu à pied et avait dû faire le tri entre les plastiques et le verre à la lumière de son téléphone.
Cette fois-ci, il avait prévu le coup : il était venu en voiture, et s’était placé de sorte à ce que les phares l’éclaire durant sa tâche. Il aurait aussi pu venir plus tôt, mais il avait des horaires assez décalés ces derniers jours et ne pensait à vider ses déchets que lorsque cela débordait.
Entre deux bruits de bouteilles de verre qui se fracassaient contre le sol, il entendit une série de coups. Thibault sursauta d’abord, puis se rassura en se disant qu’il ne s’agissait sans doute que d’une bestiole nocturne qu’on ne croisait pas en ville. Il avait même, une fois, entraperçu un faon, ou un chevreuil, ou un daim — Thibault n’était pas très calé en cervidés — dans le jardin du chalet familial.
— Ohé ? Il y a quelqu’un ?
Cette fois-ci, Thibault se figea. Clairement, il ne s’agissait pas d’un des animaux habituels qui le faisaient sursauter lorsqu’il se promenait la nuit.
Thibault posa précautionneusement son cabas à emballage, et sortit son téléphone de son sac banane en cuir, afin d’activer le mode torche.
— Ohé !
C’était bien une voix. Elle semblait provenir du petit local qui abritait les conteneurs pour les poubelles non recyclables.
— Il y a quelqu’un ? demanda Thibault, avant de réaliser qu’il s’agissait d’une question stupide à la réponse évidente.
Alors qu’il approchait prudemment, il entendit un gros bruit suivi de jurons :
— Oh, merde, purée !
Thibault poussa la porte branlante du local et vit qu’un des trois gros conteneurs à poubelles était renversé, son contenu étalé sur le sol. Le contenu en question consistait en quelques sacs poubelles remplis et, plus étonnant, une jeune femme qui se tenait présentement à quatre pattes et avait des difficultés à se relever, ce qui s’expliquait en partie par le fait que des sacs poubelles épars ne forment pas exactement une surface très stable.
— Bonjour, fit un Thibault perplexe sans trop savoir si c’était le genre de choses qui se disaient en de telles circonstances. Vous voulez un coup de main ?
La jeune femme lui jeta un regard également perplexe, et lui rendit son bonjour en acceptant la main qu’il lui tendait. Elle avait des cheveux bruns attachés — même si certaines mèches étaient présentement décoiffées —, une veste tailleur sombre, et du sang sur le visage. Il s’agissait bien évidemment de Naomi, aussi on évitera de continuer à la nommer par périphrases.
— Désolée du dérangement, s’excusa-t-elle. C’est juste que c’est compliqué de sortir de ces machins-là.
— C’est vrai, admit Thibault par réflexe, avant de réaliser qu’il venait de dire cela comme s’il s’extrayait régulièrement de poubelles.
Il restait un peu abasourdi, d’autant plus qu’il lui semblait évident que la femme qui se tenait en face de lui n’était pas juste en train de faire les poubelles. Celle-ci, cependant, commençait à s’écarter sans lui prêter attention.
— Euh, excusez-moi, fit-il en commençant à la suivre. Vous allez bien ?
— Oui, et vous ? répondit machinalement Naomi.
Elle continuait à marcher un peu le long de la route, et Thibault se demanda quoi faire. Il ne voulait pas laisser quelqu’un de blessé sans assistance, mais il s’écartait un peu de sa voiture sur laquelle il avait laissé le contact, ce qui n’était guère prudent.
— Vous ne voulez pas que j’appelle les secours ?
À son soulagement, Naomi s’arrêta et commença à regarder aux alentours, visiblement à la recherche de quelque chose.
— Non, pourquoi ? demanda-t-elle.
Thibault hésita sur ce qu’il pouvait répondre. « Vous sortez d’une poubelle depuis laquelle vous appeliez » ? Elle le savait. « Les gens qui vont bien ne sortent pas d’une poubelle en pleine nuit » ? C’était peut-être le genre de choses qui ne se disaient pas.
— Vous avez du sang sur vous, finit-il par dire.
Naomi se passe une main sur le visage, puis jura.
— Oh, merde.
Elle ne s’attarda cependant pas dessus, et embraya aussitôt :
— Vous pourriez éclairer par là ?
Thibault s’exécuta, ravi d’avoir des ordres précis à suivre, et éclaira la zone avec la lumière de son téléphone.
— Ah ! s’exclama Naomi, avant de se diriger vers une tache sombre au sol.
Un sac, visiblement.
— Pas de téléphone, évidemment, maugréa-t-elle.
— Je m’appelle Thibault, fit Thibault sur une impulsion.
Il le regretta aussitôt. Ce n’était sans doute pas le moment. Il aurait sans doute dû se présenter plus tôt, ou profiter de l’instant propice.
— Naomi, répondit Naomi. Merci pour la lumière. Bonne soirée !
Elle venait clairement de le congédier. Sur le fond, ça ne lui posait pas de problème, mais il était tout de même embêté à l’idée de la laisser repartir seule dans cet état.
— Vous ne voulez pas au moins que je vous dépose quelque part ?
Naomi lui jeta un air surpris, puis se tourna vers sa décapotable rouge.
— Je ne voudrais pas salir votre voiture. Ne vous en faites pas, je ne vais pas très loin.
Il resta coi quelques instants, tandis qu’elle lui tournait le dos et commençait à s’écarter.
— Vous vous foutez de moi, hein ? demanda-t-il finalement.
Naomi s’arrêta et se retourna.
— Pardon ?
— Vous pensez vraiment que mon plus gros souci actuellement, c’est la propreté de ma voiture ? s’emporta-t-il. Je veux dire, si vous ne voulez pas être seule en bagnole avec un type louche, je peux comprendre. Et je ne voudrais pas insister. Mais on se fout de la propreté de ma voiture !
Naomi l’écoutait, l’air un peu amusée.
— Ok, fit-elle.
— Ok ? demanda Thibault.
— Ok, je veux bien un trajet en voiture, si vous vous foutez de sa propreté. Je crois que j’ai un caillou dans la chaussure.
Thibault soupira de soulagement.
— Merci, dit-il. Ça me tranquilise.
Ils retournèrent tous les deux vers la voiture, Naomi semblait amusée par l’inquiétude de Thibault. Lorsqu’elle s’installa sur le siège passager, et qu’elle put se regarder dans le miroir de courtoisie, éclairée par la petite lumière de l’habitacle, elle comprit mieux pourquoi. En plus d’un saignement d’origine indéterminé, elle avait un sérieux début de cocard sur le visage.
— Merde, fit-elle, avant d’examiner ses vêtements. Merde, merde.
— Vous ne voulezpas que je vous emmène aux urgences ? demanda Thibault.
— Non. Ce dont j’ai besoin, c’est d’une douche.
Thibault démarra. Il était conscient d’abandonner le reste de son cabas d’emballages, mais il lui semblait que ce n’était pas le moment opportun. Il se promit de repasser au retour.
— Je suppose, lança-t-il aventureusement sur le ton de la conversation, que ça ne se fait pas de vous demander ce qui vous est arrivé ?
— Oh, répondit Naomi avec nonchalance. C’est le genre de choses qui arrivent, quand on mène la vie de yakuza.
The post NaNoWriMo ? (Début de roman) first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.
October 30, 2023
Quelques images 3D d’octobre
Comme je l’avais dit sur Patreon, mon activité littéraire a été assez lamentable ces derniers temps, et plutôt que de mettre en avant ce que je ne faisais pas, j’avais envie de montrer un peu ce que je faisais, même si c’est pas ouf. En l’occurrence, j’essaie d’apprendre Blender et j’avais envie de partager quelques images que j’ai faites le mois dernier, que les gens qui me suivent sur Mastodon ont probablement déjà vues.
 Un blob cat avec un cœur
Un blob cat avec un cœur Une blob bat
Une blob bat Un chat d’Halloween, d’après un autocollant de Solidaires Informatique
Un chat d’Halloween, d’après un autocollant de Solidaires Informatique  Une première tentative de modélisation de personnage
Une première tentative de modélisation de personnage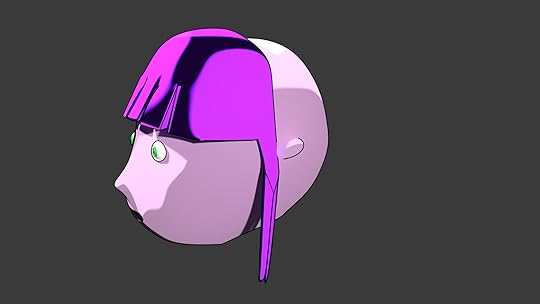 Une autre tentative de modélisation de visageUne Clio
Une autre tentative de modélisation de visageUne Clio Un arbre, d’après le tutoriel sur Youtube de Retroshaper
Un arbre, d’après le tutoriel sur Youtube de Retroshaper Voilà ! Je ne suis pas sure qu’il y aura un post similaire pour novembre parce que j’aimerais bien essayer de faire le NaNoWriMo cette année, mais si j’arrive à écrire un peu je le partagerai peut-être 
The post Quelques images 3D d’octobre first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.



