Lizzie Crowdagger's Blog, page 17
December 2, 2015
Souscription pour Enfants de Mars et de Vénus
J'ai la joie de vous annoncer la sortie prochaine (prévue pour janvier 2016) d'un nouveau roman, Enfants de Mars et de Vénus !
C'est quoi ?
Enfants de Mars et de Vénus est un polar fantastique. On y suit deux héroïnes, Lev (la narratrice) et Alys. Voici la quatrième de couverture :
« Sauf qu’on n’est pas un couple, a tranché Alys.
— Vraiment ? ai-je demandé, un peu surprise.
— Lev, je t’aime bien, mais pour l’instant on a à peine couché deux fois ensemble et, pour ce que j’en sais, tu couches avec toutes les filles trans que tu rencontres. »
J’ai levé ma main en signe de protestation.
« Ce sarcasme est complètement infondé. Et puis, qu’est-ce que tu fais des lacrymos, des machos, des bastons avec les skins, des interrogatoires musclés et tout ça ? Ça ne compte pas, pour toi ?
— Si, mais ça correspond plus à la description d’un gang que d’un couple. »
J’ai haussé les épaules.
« D’accord, ai-je concédé. Être en gang, ça me va aussi. »
Et une quatrième de couverture alternative :
Lev est une lesbienne motarde. Aussi, lorsqu'elle rencontre la mécanicienne Alys, ce pourrait être le début d'une longue et belle histoire romantique sur fond de bruits de moteur.
Sauf qu'Alys est trans. Qu'elle est soupçonnée d'être une tueuse en série psychopathe – peut-être parce qu'elle est trans, ou peut-être pas. Et qu'elle a des pratiques occultes. Des histoires de sorcellerie qui ne sont peut-être pas sans lien avec les étranges cauchemars dont commence à souffrir Lev.
Mais Lev est bien décidée à ne pas se laisser démonter. Elle pourra heureusement compter sur ses plus fidèles alliés : son poing américain, ses rangers coquées et ses deux best friends for life, M. Smith et M. Wesson.
Donc en gros voilà, ça parle encore de lesbianisme, de motos, de gros flingues et d'explosions.
C'est quoi cette histoire de souscription ?
Ce livre est édité par Dans nos histoires, qui est un petit éditeur associatif. Pour permettre la publication de leurs livres prévus pour 2016 ils lancent donc une souscription, c'est-à-dire que vous pouvez les précommander : vous les payez maintenant (ou demain, vous avez jusqu'au 10 janvier) et vous les recevrez au moment de leur sortie. Donc voilà, vous allez là, vous imprimez, vous cochez les livres pour lesquels vous voulez souscrire, et vous envoyez tout ça avec un chèque. Youpi !
Vous pouvez également toujours acheter Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), et comme le fait remarquer l'éditeur ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël. Ou de cadeau d'anniversaire si par exemple vous connaissez une personne née à Noël et dont l'anniversaire passe toujours un peu à la trappe parce que c'est Noël, mais je m'égare.
Une petite comparaison foireuse du genre « ça coûte que deux paquets de clopes » pour montrer que c'est pas cher ?
Enfants de Mars et de Vénus ne coûte que 12€, c'est pas cher, c'est le tiers d'une amende pour stationnement interdit, donc si :
vous vous êtes garé·e en stationnement interdit mais que vous eu la chance de pas avoir d'amende ;
vous avez trouvé une place pour ne pas avoir à vous garer en stationnement interdit ;
vous n'avez pas de voiture, et donc vous ne vous garez jamais en stationnement interdit et n'avez pas d'amende à payer ;
hé bien avec l'argent que vous avez économisé comme ça, vous pouvez vous précommander trois exemplaires d'Enfants de Mars et de Vénus !
(Si vous vous êtes pris récemment une amende pour stationnement interdit, désolée pour vous... mais du coup peut-être que vous devriez précommander le livre quand même pour vous remonter le moral ?)
September 17, 2015
Blonde à forte capacité pulmonaire
Pour fêter la 189ème vente[1] de Pas tout à fait des hommes, j'ai décidé de republier ici une nouvelle qui se situe dans le même univers, et où l'on retrouve l'héroïne, Kalia.
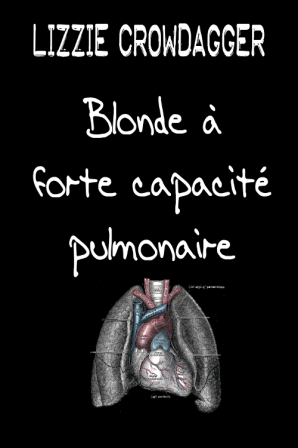
Kalia est une elfe blonde à forte capacité pulmonaire.
Blonde, c’est indiscutable. Même si ses longs cheveux ne sont pas, en ce moment, très propres, ils en sont pour le moins jaune pâle ; il n’y a donc pas de doute à ce sujet.
Elfe, cela se voit moins. En fait, la seule chose qui permet de dire que Kalia en est une, ce sont ses oreilles pointues, mais elles sont en général cachées par les cheveux mentionnés précédemment. Elle n’est ni grande, ni mince, comme le sont la majorité de ses congénères ; à vrai dire, elle est plutôt petite et elle a pris quelques kilos dernièrement. En ce qui concerne l'éblouissante beauté elfique, tout est dans l’œil de l’observateur, mais il faut reconnaître que la plupart des observateurs ne semblent pas si éblouis que ça.
Quant à sa capacité pulmonaire, même si sa poitrine est significativement moins volumineuse que la moyenne des femmes adultes, elle est plutôt forte, puisque Kalia entame sa troisième minute sous l’eau et qu’elle n’a pas encore perdu connaissance.
Si elle se trouve actuellement sur le fond vaseux de la Malsaine, le fleuve qui traverse la ville de Nonry et qui mérite particulièrement son nom en aval de celle-ci, ce n’est pas parce qu’elle a envie de batifoler dans l’eau. La raison à sa présence ici, c’est qu’elle a été jetée d’un pont, pieds et poings liés, attachée à une solide barre en fonte ; et c’est, indirectement, parce qu’un homme bien habillé est venu frapper à la porte de son appartement il y a deux jours.
Blonde à forte capacité pulmonaire est une nouvelle de fantasy. Vous pouvez la télécharger gratuitement :
au format PDF ;
au format ODT (LibreOffice) ;
exceptionnellement, pour les autres formats (epub, mobi, ...) c'est sur Smashwords (mais tout aussi gratuit et sans besoin de se créer un compte).
Blonde à forte capacité pulmonaire a été initialement publiée dans le second numéro de Solstice, Crimes en imaginaire, publié en 2008 par les éditions Mille Saisons. À ma connaissance, cette anthologie n'est plus disponible sur le site de l'éditeur, mais il doit toujours être possible d'en trouver des exemplaires si vous vous débrouillez bien.
Le personnage central de Kalia est par ailleurs également l'héroïne du roman Pas tout à fait des hommes ; chronologiquement, celui-ci se déroule avant cette nouvelle. Deux autres nouvelles se situent dans le même univers (mais ne partagent pas les mêmes personnages) : Une mine de déterrés et Sortir du cercueil. Vous pouvez les retrouver toutes les deux (ainsi que deux autres nouvelles) dans le recueil Sorcières & Zombies.
Vous aurez pu faire le calcul vous-même, ce texte a été écrit il y a sept ans. Il y aurait peut-être des choses que je ne ferais pas de la même façon maintenant, comme, hum, le titre. Le but était de jouer sur la contradiction entre celui-ci et le contenu du texte, et de jouer sur le cliché qu'on peut parfois voir dans la fantasy (et ailleurs) avec des meufs qui sont réduites à des plantes vertes avec des gros seins. Sauf qu'au final je ne sais pas si le résultat permet vraiment une critique de ça, ou joue juste sur le côté racoleur. J'aurais pu le changer, évidemment, mais outre que c'est pénible de trouver un nouveau titre, ça a été publié comme ça. Il n'en reste pas moins que c'est une nouvelle que j'aime bien et que j'avais envie de partager à nouveau pour les gens qui n'auraient pas acheté cette anthologie à l'époque.
Note
[1] J'avais prévu d'attendre la 200ème, et puis je me suis dit que, merde, les chiffres ronds, c'est tellement convenu. On pourrait aussi me dire qu'il n'y a pas de quoi pavoiser d'avoir vendu 189 exemplaires, toutes versions confondues (papier et numérique) en à peu près cinq ans, mais pour un livre surtout disponible en téléchargement gratuit — et sous licence libre — je trouve que ce n'est, tout bien considéré, pas si honteux.
September 11, 2015
Auteurs en danger, ouais ouais...
Hier est sorti un petit livret gratuit ironiquement intitulé La gratuité, c'est le vol, disponible sur le site Web Auteurs en danger, ironiquement commandité par le Syndicat National de l'Édition. Un peu comme si le Medef sortait un site « Travailleurs en danger », sauf que dans le milieu de la culture il n'est pas de bon ton de parler de lutte des classes : après tout, aut·eur·rice·s, éditeurs, libraires nous sommes tou·te·s dans la même galère, pas vrai ?
Pour ce faire, le SNE a donc engagé Richard Malka, avocat qui a notamment défendu Clearstream ou Dominique Strauss-Kahn, mais également Charlie Hebdo, ce qui en fait, on le verra, un défenseur hors pair de la liberté d'expression (sauf donc celle de Denis Robert face à Clearstream, il ne faut pas pousser mémé dans les orties). C'est aussi un homme engagé, qui a signé le manifeste misogyne des « 343 salauds ».
Richad Malka, donc, commandité par le SNE, prétend défendre les auteurs. Ce qui est bel et bon : en tant qu'autrice, moi aussi j'ai envie de gagner plus de tune. Le site Web, tel qu'il est présenté, va dans ce sens :
Réduire la rémunération des auteurs, c’est risquer de limiter la profusion et la diversité de la création.
Serait-ce une auto-critique du Syndicat National de l'Édition, puisque les avances, à-valoir, et pourcentages sur les droits d'auteurs ont eu plutôt tendance à baisser ces dernières années, qu'un nombre non négligeable d'éditeurs n'assurent pas le minimum légal concernant la reddition des comptes ? Que nenni. On le verra, le danger, pour les auteurs, il n'est pas chez nous, puisque tout fonctionne très bien, mais vient essentiellement de l'étranger, et notamment des Américains et de l'Europe. Le but de ce livret vise en effet à démonter le rapport Reda, rédigée par une députée européenne du Parti Pirate, et une réforme française sur le droit d'auteur à venir.
Je ne prétends pas être au courant de ces deux textes : je vais juste me contenter de répondre aux arguments de ce qu'en dit Richard Malka et le Syndicat National de l'Édition, puisque je suis autrice et que c'est écrit, aussi, en mon nom (quoique je ne me fasse aucune doute : peu probable que ce soit à des gens comme moi pas signés chez un « gros » que prétendent défendre ces gens).
Les bons exemples
Malka commence son livret en expliquant qu'il n'y a pas besoin de réforme, plus que tout va bien en France et qu'on a un système qui marche bien, et qui est tout à fait adapté au numérique. Il donne ainsi des bons points (il en donnera aussi des mauvais plus tard).
Un de ces objets de louanges est Elsevier qui a su passer au numérique avec succès. Si vous ne connaissez pas cet éditeur, je vous invite à cliquer sur le lien : en gros le principe est que ça marche bien, puisque les auteurs (des scientifiques) doivent payer pour être publiés (ce qui est un peu une obligation pour avoir une carrière scientifique), puis à nouveau payer pour lire les revues. On cherchera en vain en quoi ce modèle est favorable aux auteurs.
Un autre objet de louanges est le dispositif ReLire, fortement critiqué par un certain nombres d'auteurs (je vous invite notamment à lire les articles disponibles sur le SELF, Syndicat des Écrivains de Langue Française), dispositif qui permet l'exploitation en numérique d'œuvres « indisponibles » (et un certain nombre qui sont encore disponibles, oups, mais c'est une erreur, ça va être corrigé vous dit-on) et où les auteurs doivent batailler s'ils veulent en être retirés. Là encore ce livret montre bien qu'il ne défend que les intérêts des éditeurs, et absolument pas ceux des auteurs.
Les mauvais exemples
L'auteur donne aussi les mauvais élèves, ceux qui se font de l'argent sur le dos des auteurs mais pas comme il faut : les « GAFA », c'est-à-dire Google Amazon Facebook Apple, et qui eux auraient tout à bénéficier de la gratuité et des exceptions du droit d'auteur. Alors, pour être claire : je ne porte pas ces compagnies dans mon cœur. Cependant, les arguments utilisés sont quelque peu de mauvaise foi, car si l'argument tient effectivement pour Google (qui vend du trafic et les données des gens qui se connectent à son site), et à tout à gagner à ce que tout devienne gratuit, voire éventuellement à Apple (qui vend surtout des machines), je suis assez dubitative pour ce qui est de Facebook (sur lequel on trouve assez peu de livre, essayez de copier/coller un livre dans un statut Facebook pour voir) et encore plus pour ce qui est d'Amazon, qui se fait sutout de l'argent en vendant des livres, et n'a pas forcément intérêt à ce qu'on les trouve gratuitement sur Google (et sur Facebook, mais vraiment, ce serait pas pratique).
Bref, des arguments assez cavaliers qui en gros surfent sur le cheval de bataille (je mélange peut-être mes images, désolée) des méchantes entreprises américaines faces aux gentilles entreprises de chez nous.
Sus à l'américanisation
Malka dénonce également les exceptions additonnelle au droits d'auteur, qui serait, selon lui, dangereux pour ceux-ci. Non, on ne parle pas de ReLire, ça c'est bien (pour les éditeurs), on parle de ce qui pourrait passer, vous ne suivez pas ?
Parmi celles-ci, il y a notamment la notion de Fair-use, effectivement inspirée des États-Unis, et qui est mal, parce que ça vient des États-Unis, et qu'en France ça marche bien, alors pourquoi mettre cette horreur chez nous ? Qu'importe que le fair-use consiste essentiellement à lever un peu certaines règles rigides du droit d'auteur lorsqu'il s'agit de parodie, de droit à la création, etc. En tant qu'autrice, je suis donc censée me sentir menacer par ce droit. Bizarrement, j'aurais surtout tendance à penser que j'aurais moins peur de risquer un procès parce que j'ai casé une phrase de l'Arme Fatale 3 ou une de Fight Club dans Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), mais bon, j'imagine que les auteurs qui ne partent pas d'absolument zéro pour leur création ne doivent pas être de vrais auteurs.
Il y a aussi une critique de l'« exception pour des œuvres transformatives », qui en gros permettrait la fan-fiction tant que c'est pas commercial. Personnellement, je n'y vois rien de bien méchant ; je sais que des auteurs ou autrices sont en désaccord avec moi là-dessus, bon, admettons. Mais ce qui est particulièrement savoureux, c'est de s'insurger sur le fait qu'« un auteur pourrait utiliser un personnage créé par un autre, sans son autorisation ». Soit. Sauf que, dans ce cas, cher Syndicat National de l'Édition, il faudrait commencer par interdire à vos membres d'imposer ce genre de clauses à leur auteur, ou des clauses leur empêchant d'utiliser leur personnage chez un autre éditeur.
On retrouve un peu le même souci, d'ailleurs, dans la clause d'extra-territorialité :
Toutefois l’adoption de cette exception empêcherait, par exemple, l’auteur français d’un ouvrage sur le blasphème d’en interdire la diffusion à l’étranger et de se réserver la cession de ses droits pour certains pays.
C'est gentil Morray, mais dans la plupart des contrats d'édition il y a déjà une clause du style « la présente cession est valable en tout lieu et pour toute langue ». Alors, certes, tu peux négocier, ça dépend des éditeurs et de ton statut d'auteur, mais en gros dans la majorité des cas quand c'est une grosse boîte et que t'es pas connu·e, spoiler : en fait tu peux pas trop négocier. Donc là encore, il s'agit plutôt de défendre le droit des éditeurs que celui des auteurs.
(Bon après autant garder les droits de traduction ça peut avoir un intérêt, autant pour un livre vendu en numérique je vois assez peu l'intérêt de dire « ahah non vous êtes pas en France vous pouvez pas me l'acheter, je veux pas de votre argent »).
Bref...
Bref, je ne vais pas m'acharner sur plein d'autres exemples[1], et je pense qu'il est de toute façon clair pour pas mal de gens que ce texte qui prétend défendre les « Auteurs en danger », venant du Syndicat National de l'Édition, est une vaste blague et ne vise qu'à défendre leurs propres intérêts, c'est-à-dire ceux des grand éditeurs.
Je vais donc arrêter un peu l'analyse sérieuse et conclure avec une attaque un peu en-dessous de la ceinture, parce que quand même, ça m'a fait rire de voir ça. Richard Malka, au nom du Syndicat National de l'Édition, termine son pamphlet par une ode à la liberté d'expression face à Amazon et Apple qui ont retiré un certain nombre d'œuvres. (Ironiquement, ce sont les mêmes qui vont dénigrer l'auto-édition sous prétexte qu'on peut publier n'importe quoi sur Amazon, sans même passer par le filtre d'un éditeur qui s'assure que ça vaut la peine d'être lu, mais passons).
La défense de la liberté d'expression.
Par Richard Malka, avocat de Clearstream face à Denis Robert
Par le Syndicat National de l'Édition, dont on peut lire sur la page wikipédia :
Pendant la Seconde Guerre mondiale, et durant la période d'Occupation, le Syndicat des éditeurs français et les maisons d'édition acceptent de fournir les informations qui servent à l'établissement de la liste Otto (en référence à l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, Otto Abetz), liste des livres interdits à la vente par les autorités d'occupation, et qui est diffusée par la Propaganda Abteilung et la Propaganda Staffel.
Bref, là-dessus comme pour se présenter en « défenseurs des auteurs », ils ont beaucoup de culot mais n'ont pas des masses de face.
Note
[1] Post-scriptum : je me rends tout de même compte que j'ai oublié de parler de la réduction de durée du droit d'auteur, alors que ça me paraît important. En gros, actuellement, une œuvre est sous droit d'auteur jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, date à laquelle elle passe dans le domaine public. Le rapport Reda préconisait de diminuer cette durée (toujours après la mort de l'auteur, cela dit). Encore quelque chose qui fait hurler les éditeurs mais pour laquelle je me sens assez peu concernée, vu que, d'une part, je serais morte, et d'autre part que la durée de présence en librairie d'un livre est de toute façon assez courte. Le vrai scandale, à mon avis, est plutôt que beaucoup d'éditeurs demandent encore aux auteurs de céder les droits sur une œuvre pour toute leur vie et une partie de leur mort, plutôt que des contrats sur 5 ou 10 ans qui leur permettrait d'exploiter d'une autre façon une œuvre en « fin de vie » chez leur éditeur. (Il est théoriquement possible, mais affreusement compliqué, de récupérer ses droits lorsque l'œuvre n'est plus exploitée au format papier, et à peu près impossible en numérique — il suffit qu'elle soit en téléchargement quelque part.)
July 24, 2015
La narration à la première personne (vaguement à propos d'Une autobiographie transsexuelle #3)
Voici le troisième article qui a pour objectif de poser quelques éléments de réflexions diverses autour d'Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires). Pour rappel, le premier article sur le sujet tournait autour des aspects un peu politiques liés à la représentation de minorités (en l'occurrence lesbiennes et femmes trans), tandis que le second parlait des méchants. Toujours pour rappel, si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez notamment commander le livre sur le site de l'éditeur, Dans nos histoires.
Avertissement : cet article peut contenir quelques légers spoilers si vous n'avez pas encore lu ce livre.
Dans cet article, même si je pars de ce livre comme point de départ et exemple, j'en profite aussi pour donner quelques réflexions personnelles, qui valent ce qu'elles valent, sur la narration à la première personne. Je tiens à préciser (encore) que même si j'ai une relative expérience dans l'écriture de fiction, je n'ai pas un cursus littéraire, donc jen'utilise pas forcément les bons mots pour parler des choses et il y a des chances pour que je dise un paquet d'évidences (voire des absurdités) pour des gens qui s'y connaissent un peu dans le domaine. J'espère que ça intéressera quand même certaines personnes, en tout ça m'a permis de mettre un peu des trucs au clair dans ma tête.
La narratriceUne autobiographie transsexuelle (avec des vampires) est, comme son titre peut le laisser penser, écrit à la première personne. Ce qui veut donc dire que la narration n'est pas confiée à un narrateur censément omniscient et désincarné, mais à un personnage du roman.
Le personnage en question s'appelle Cassandra. C'est une jeune femme transsexuelle, qui vient d'emménager à Lille et essaie de mener une vie à peu près ordinaire, du moins jusqu'à ce qu'elle croise le chemin des Hell B☠tches, un groupe de lesbiennes mortardes surnaturelles.
Un petit aparté (légèrement psychorigide)
Avant de parler plus spécifiquement des conséquences qu'a introduit ce choix sur l'écriture du roman, je vais faire une petite digression sur l'écriture à la première personne en général, et sur des choses que j'ai vues avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, alors autant en profiter pour donner mon point de vue.
Notamment, j'ai souvent lu que la narration à la troisième personne, c'était avoir un narrateur omniscient, ce qui n'était pas le cas dans la narration à la première personne ; et par corollaire, la narration à la première personne ne peut donc décrire que des évènements auxquels participe le ou la narratrice, ce qui peut être parfois limitant.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Sur l'omniscience d'abord : on trouve des tas de romans à la troisième personne où le narrateur n'est pas pour autant omniscient. L'exemple le plus typique, c'est quand la narration, si elle est à la troisième personne, suit de près le point de vue d'un personnage, comme dans Le Trône de Fer (de George Martin) où on change de « personnage point de vue » à chaque chapitre. On trouve aussi des romans où le narrateur n'est pas « incarné » (il ne fait pas partie des évènements) mais parle ponctuellement en « je », et laisse sous-entendre qu'il n'est pas si omniscient, comme dans cet extrait de Le petit bleu de la côte Ouest, de Jean-Patrick Manchette :
Par le truchement de deux diffuseurs – un sous le tableau de bord, un sur la plage arrière – un lecteur de cassettes diffuse à bas niveau du jazz de style West-Coast : du Gerry Mulligan, du Jimmy Giuffre, du Bud Shank, du Chico Hamilton. Je sais par exemple qu’à un moment, ce qui est diffusé est Truckin’, de Rube Bloom et Ted Kœlher, par le quintette de Bob Brookmeyer.
À l'inverse, il est des cas où un roman présente un narrateur qui correspond à un personnage bien défini, mais qui dans les faits est ce que l'on pourrait appeler omniscient à toutes fins utiles : certes, ce personnage ne connaît pas absolument tout du monde qui l'entoure, mais en tant que narrateur (par exemple parce qu'il écrit l'histoire après les évènements et a pu faire un certain nombre de recherches) il dispose de suffisamment d'informations sur les évènements relatés dans le roman pour que la différence avec l'omniscience soit assez limitée en pratique, surtout que le narrateur peut tout à fait être un peu inventif ou imaginatif. Ce qui implique, donc le corollaire : oui, dans l'écriture à la première personne, on peut tout à fait avoir des scènes où le narrateur n'est pas présent, simplement parce que celui-ci a par la suite appris ce qui s'était passé et est tout à fait libre d'en parler.
Un exemple de cette possibilité, et qui n'est pas tiré d'un roman (même si cela se rapproche du polar par bien des aspects), c'est Bye-Bye Saint-Eloi, la réponse au parquet des inculpé·e·s de Tarnac qui, s'il est écrit à la première personne (en l'occurence, plutôt du pluriel que du singulier), prend néanmoins la liberté d'avoir des chapitres centrés sur des « personnages » extérieurs à la narration, comme le policier des RGs Christian Bichet.
Si je prends cet exemple, ce n'est pas pour le contenu (qui est assez hors-sujet par rapport à cet article) mais parce qu'il montre bien que lorsque des gens réels écrivent sur les évènements réels qu'ils ont vécus, ils ne se sentent pas forcément interdits de faire des recoupages, quitte à combler certains trous avec l'hypothèse qui leur semble la plus plausible, et à exposer des faits auxquels ils n'ont pas assisté directement. Par conséquent, est-ce qu'un personnage fictif écrivant sur des évènements fictifs qu'il a vécu devrait, lui, se l'interdire, au nom du réalisme ?
Pour en venir à parler tout de même un peu d'Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), la partie 2 commence sur une scène où la narratrice, Cassandra, n'est pas présente. Le personnage « point de vue » de la scène est Sigkill, qui ira ensuite trouver notre héroïne un peu plus tard et lui présentera les faits. Ce choix de narration, s'il ne respecte pas scrupuleusement certaines choses que j'ai pu lire sur l'écriture à la première personne, a deux intérêts : d'abord cela permet de conserver la chronologie, et surtout cela évite un « dialogue dans le dialogue », où au lieu d'avoir directement le point de vue de Sigkill, on aurait Cassandra qui nous raconte que Sigkill lui raconte qu'elle a vécu telle et telle chose.
Pour conclure cet aparté, je dirais que selon moi la différence entre narration à la première personne et à la troisième personne n'est pas vraiment liée à l'omniscience (un narrateur peut dans tous les cas se présenter comme omniscient, ou tout du moins présenter les faits qu'il expose comme la vérité absolue ; il ne pourra pas trop être contredit, puisque c'est lui le narrateur et que, par définition, c'est lui qui écrit l'histoire). La vraie différence, à mon avis, tient plutôt que dans la narration à la première personne, le narrateur est incarné dans un personnage, ce qui implique que la personnalité de ce personnage va avoir des conséquences sur la façon dont le roman sera écrit.
Personnalité de la narratrice
Ce qui m'amène, assez naturellement, à parler de la personnalité de Cassandra, et des impacts que cela a sur la narration.
Cassandra est plutôt timide (particulièrement au début) et relativement pudique sur un certain nombre de choses. Ce qui, d'un point de la narration, n'est pas forcément évident : par rapport à d'autres narrateurs à la première personne, Cassandra s'épanche au final assez peu sur sa vie. De plus, il y a certaines choses dont elle n'a pas envie de parler. Le problème, c'est que comme c'est elle la narratrice, si elle n'a pas envie d'en parler, elle n'en parle pas, ce qui rend un peu compliqué de transmettre cela au lecteur.
(Spoilers)
Un exemple de ça, c'est l'appartenance de Cassandra à la famille van Helsing, liée à l'Institut Van Helsing. Sans entrer dans les détails sur ce groupe (tout à fait périphérique à l'histoire de toute façon), il s'agit évidemment d'une référence au professeur Abraham van Helsing dans Dracula, de Bram Stoker, et à un certain nombre d'œuvres diverses et variées inspirées de Dracula qui ont utilisé ce nom, comme le film (dispensable) Van Helsing, ou le manga/anime Hellsing (avec aussi comme influence la Pinkerton National Detective Agency de l'époque des westerns). Bref, l'Institut Van Helsing, c'est des chasseurs de vampires, et il est compréhensible que Cassandra n'ait pas envie de révéler à son amoureuse vampire qu'elle fait partie de la famille de ses dirigeants. La question c'est : comment faire pour que le lecteur soit quand même au courant ?
Ce que je trouve intéressant (sans me jeter des fleurs) avec la première partie d'une Autobiographie Transsexuelle (avec des vampires), c'est qu'au final la révélation la plus importante sur Cassandra n'est pas dans le texte, mais dans le méta-texte, et plus précisément dans la signature :
Cassandra van Helsing, novembre 2008
qui conclut cette première partie. Malheureusement, même si j'avoue rester assez fière de moi sur ce coup-là, je pense que les lecteurs et lectrices pas forcément hyper au taquet sur la fiction vampirique n'auront pas vu ça comme un cliffhanger et ne se seront pas pas senti·e·s obligé·e·s de lire la suite pour savoir si Cassandra était sincère ou une tueuse de vampires infiltrée.
Quelques informations sur l'Institut Van Helsing sont néanmoins données plus explicitement dans la seconde partie du roman, au prix d'un léger compromis sur ce qu'il m'aurait semblé logique que Cassandra écrive (si elle ne voulait vraiment pas parler de ce sujet, il serait logique qu'elle ne relate pas les discussions avec ses camarades qui en parlent ; d'un autre côté, le but est tout de même que la personne qui lit le livre puisse être au courant).
Au final, le fait que Cassandra soit assez réservée sur ce qu'elle dit d'elle-même est assez frustrant en tant qu'autrice, puisque clairement à des moments j'avais l'impression de ne pas donner suffisamment d'informations sur ce personnage, et en même temps il n'aurait pas été très logique qu'elle s'épanche dessus.
Cela dit, cela donne une excuse en or si on me dit que le personnage est mal caractérisé : moi, j'y peux rien, c'est de sa faute à elle si elle parle pas plus de sa life.
Narration structurée
Il y a d'autres éléments de la personnalité de Cassandra qui jouent sur des choix de narration, de manière plus ou moins importante. Un exemple de décision au final pas très importante sur la narration, c'est le temps utilisé par le récit : le récit est écrit au passé simple et pas au passé composé, ce qui est le « standard » pour une œuvre littéraire mais pas forcément ce qu'on utiliserait spontanément en racontant quelque chose qu'on a vécu. Cependant l'idée était que Cassandra, qui avait grandi en Grande-Bretagne (bien qu'ayant aussi la nationalité française par sa maman) écrivait plutôt en anglais (où l'utilisation du passé simple est plus courante au quotidien), et que la version que vous aviez entre les mains était censée être traduite.
Un élément un peu plus important, c'est que Cassandra est quelqu'un de plutôt structurée, ce qui se traduit par une narration assez bêtement chronologique, sans trop de parenthèses dans le récit.Autrement dit, il y a une histoire qui est à peu près facile à suivre, ce n'est pas bourré de flash-backs et autre digressions de la narratrice. Les choses auraient sans doute été différentes avec une autre narratrice ; j'avais notamment commencé à écrire une « suite », où la narratrice était Morgue (j'avais d'ailleurs posté un petit début ici), et la narration était beaucoup plus chaotique : Morgue avait bien du mal à nous raconter l'histoire qu'elle devait nous raconter, et passait son temps à partir en digression dès qu'elle en avait l'occasion. Par ailleurs, elle cassait réglulièrement le quatrième mur en s'adressant directement au lecteur, et se montrait une narratrice extrêmement peu fiable, contrairement à Cassandra.
Une petite parenthèse sur la notion de narrateur fiable : l'idée, ce n'est pas forcément qu'il ou elle dise la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, qui n'aurait pas beaucoup de sens pour un roman (peut-être que Cassandra ment du début à la fin d'Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) mais de fait à part si je sors une suite qui montre qu'elle mentait, vous n'avez aucune possibilité de le savoir), mais que ça ne se contredit pas à l'intérieur du roman. Cassandra est peut-être floue sur des détails de sa vie privée, mais lorsqu'elle dit « je me suis pris un coup de poing », il n'y a pas de raison de douter qu'elle se soit pris un coup de poing. Alors que Morgue, elle, aurait plutôt tendance à dire qu'elle a survécu à une rafale de 'Kalashnikov, avant d'admettre quelques pages plus loin que, d'accord, il ne s'agissait peut-être que d'un pistolet à billes.
Pour conclure
Le choix du narrateur ou de la narratrice, ce n'est donc pas une grande surprise, a une grande influence sur l'histoire qui sera racontée. J'ai souvent eu des blocages à l'écriture qui se sont levés lorsque j'ai décidé de changer la narratrice ou le point de vue principal, et ça a notamment été le cas pour Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) ; même si je mets certains bémols sur le fait que certains procédés seraient « réservés » à tel ou tel type de narration.
Il y a des avantages et des inconvénient au fait de choisir une narration à la première personne ; vous trouverez sans doute facilement des articles là-dessus si le sujet vous intéresse. Personnellement, les deux choses que je trouve les plus intéressantes sont :
la voix du personnage, qui, lorsqu'on a de la « chance », peut aider rapidement à poser l'ambiance du roman qu'on veut écrire (je ne parle pas tant de le poser pour les lecteurs, mais déjà pour soi-même lorsqu'on se met à la rédaction) ;
les arguments de mauvaise foi qu'on peut utiliser grâce à cela : en effet, lorsqu'on a choisi l'écriture à la première personne, on peut facilement se défausser de toutes les critiques qui nous sont faites en tant qu'auteur/autrice sur un texte en blâmant le narrateur ou la narratrice à la place. Telle scène d'action est présentée de manière confuse ? Je n'y peux rien, c'est la narratrice qui l'a écrite comme ça. Il reste des fautes dans le livre ? C'est normal, c'est réaliste, vous ne vous attendiez quand même pas à ce que la narratrice écrive parfaitement ?
July 15, 2015
Caribon, un logiciel pour détecter les répétitions
En tant qu'autrice qui écrit en français, il y a toujours un moment assez pénible à la relecture d'un texte : repérer les répétitions et les éliminer. Ou, en tout cas, essayer de les éliminer. En réduire un peu le nombre, en tout cas.
L'objectif de ce billet, un peu hors sujet pour ce blog (quoique ce n'est pas la première fois que je présente un logiciel lié à l'écriture), est de vous présenter un petit programme qui vise à aider les auteurs à repérer ces répétitions. J'y case aussi quelques réflexions sur ces fichues répétitions, parce qu'en fait il y a plus à dire sur le sujet qu'on ne pourrait le penser à première vue.
Caribon en ligne
Ne faisons pas durer le suspens plus longtemps : le logiciel dont je veux vous parler s'appelle Caribon, et il y a une version utilisable en ligne ici. Pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordinateur, vous pouvez juste copier/coller un texte de votre choix et, zou, ça marche[1].
Si vous copiez/collez un document depuis un traitement de texte, comme LibreOffice, la mise en page devrait être préservée. Bon, avec un roman en entier c'est un peu too much et le serveur va vous envoyer bouler (d'après mes quelques essais, c'est possible de monter jusqu'à environ 30000 mots, mais ça varie sans doute selon la charge du serveur).
Je ne vais pas détailler toutes les options possibles (il y a une page de documentation si ça vous intéresse), mais je vais discuter un peu de certaines fonctionnalités, parce que je les trouve intéressantes et que ça permet d'aborder des questions liées à la jonction « linguistique / informatique ».
Racinisation
Un souci, quand on veut détecter les répétitions, c'est de réussir à faire comprendre au logiciel que des mots peuvent être de la même famille : par exemple le singulier et le pluriel d'un même mot, ou des conjugaisons différentes d'un même verbe sont des répétitions, même si ce n'est pas exactement le même mot.
Pour cela, Caribon utilise une bibliothèque dite de racinisation, ou stemming en anglais. La racinisation, c'est le fait de ne garder que la racine (ou le radical) d'un mot : par exemple, mange, mangerai et mangés ont tous trois la même racine. Il y a des algorithmes pour ça, et notamment la bibliothèque Snowball qui fournit des algorithmes pour différentes langues (parce qu'évidemment, il faut adapter à chaque langue).
Recherche approximative
Malheureusement, ces algorithmes ne sont pas parfaits. D'une part, ils ne se débrouillent pas forcément très bien sur les exceptions : par exemple il est impossible, juste avec un algorithme, de savoir que vais et irai sont le même verbe.
Sur ce cas précis, il n'y a pas beaucoup de solution à part avoir un dictonnaire énorme listant toutes les exceptions de chaque langue (donc, plus une approche algorithmique). Et d'ailleurs, pour en revenir au sujet des répétitions : est-ce que « vais » et « irai » en sont vraiment une, alors que les deux mots ne se ressemblent pas du tout ?.
En revanche, pour un certain nombre de cas, il peut être utile de « repérer » des mots (ou plutôt des racines) qui sont similaires sans être tout à fait identiques. C'est ce qui s'appelle la « recherche approximative »[2], alias fuzzy string searching ou approximate string matching en anglais. C'est notamment pratique lorsque l'algorithme de racinisation a des loupés... ou alors quand c'est vous, et que par exemple vous avez fait une faute de frappe mais que « répétition » et «répetition » étaient censés être le même mot.
Cela introduit néanmoins un souci lorsque des mots similaires ne sont en fait pas le même mot : la recherche approximative risque par exemple de considérer que pétition et répétition en sont une, de répétition. Mais là encore je pense qu'on peut débattre : est-ce que ça devrait être le cas ou pas ? D'un côté, ce n'est pas le même mot, mais de l'autre ils sonnent en partie pareil. Et c'est là que je réalise que s'il y a un consensus certain sur le fait qu'il faut éviter les répétitions, je ne suis pas sûre qu'il y ait une opinion aussi unanime sur ce qui constitue exactement une répétition.
Toujours est-il que Caribon vous propose d'activer ou de désactiver cette recherche approximative, et d'en modifier le paramètre (le « seuil d'approximation »). Mais alors, comment ça marche, la recherche approximative ? En gros ça se base sur la distance de Levenshtein, qui consiste à définir la distance entre deux mots comme le nombre d'opérations basiques (ajout d'une lettre, retrait d'une lettre, permutation de deux lettres) pour passer d'un mot à l'autre. Concrètement, Caribon divise cette distance entre deux mots par la taille du mot (lequel ? le premier ou le second, j'imagine) et si ce nombre (entre 0 et 1, qui correspond à un « taux de ressemblance ») est inférieur au « seuil d'approximation », alors les deux mots sont considérés comme une répétition.
À noter que ces deux notions, la « racinisation » et la « recherche approximative de mots », si elles servent ici juste à détecter des répétitions, sont en fait assez fondamentales pour un certain nombre de champs, comme les corrections orthographiques ou quand vous tapez du texte dans un moteur de recherche. Même si après, il y a évidemment des algorithmes beaucoup plus compliqués que ça.
Mots à ignorer
Caribon fournit également une liste de mots à ignorer, du moins pour le français et l'anglais. Il est aussi possible de rajouter d'autres mots à cette liste. Ces mots ne seront donc pas considérés comme des répétitions.
Bon, là il n'y a pas grand chose à dire d'intéressant sur l'algorithme sous-jacent, mais ça soulève encore une fois la question : une répétition, c'est quoi exactement ? Typiquement, il y a des mots qu'il est assez évident qu'on veut ignorer (le, la, les, des, ...) et d'autres où ça va dépendre des gens. Par exemple, selon certaines personnes, il faut éviter les répétitions des verbes être ou avoir, ce qui peut poser particulièrement problème si on écrit un texte au passé composé. Autre exemple : les noms propres, répétitions ou pas ? Vaut-il mieux utiliser des périphrases sans grand intérêt pour parler de vos protagonistes (comme alterner « le jeune homme » et « l'aventurier » pour ne pas répéter le nom de votre héros) ou alors se dire que si on répète les noms des personnages, c'est pas bien gênant ? (Là encore, Caribon vous laisse le choix, avec une case à cocher « Ignorer les noms propres ».)
La version en ligne de commande
Caribon est un logiciel libre que vous pouvez aussi télécharger et lancer sur votre ordinateur. En plus de la version « site web », il y a une version utilisable en ligne de commande, qui permet de générer des documents HTML semblables à ce qu'on peut voir avec la version en ligne. Il est également possible d'afficher les répétitions sur la sortie standard du terminal, mais pour pour un gros document ce n'est pas très pratique.
L'intérêt principal de l'exécuter sur votre ordinateur, c'est que ça va beaucoup plus vite : par exemple, si la version en ligne m'envoie balader quand j'essaie de lui passer l'intégralité du manuscrit d'Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), le programme téléchargé sur la machine arrive à l'analyser en moins d'une demi-seconde.
Par contre, avant de pouvoir lancer ce programme, il vous faudra le compiler,ce qui implique au minimum de copier/coller quelques lignes de commande, et je ne suis pas sûre que ça marche très bien sous Windows. Plutôt pour les gens qui s'y connaissent déjà un peu plus techniquement, donc ; pour les autres, il faudra se contenter de la version en ligne.
Conclusion
En commençant cet article, j'avais peur qu'il soit fort court puisque je ne voyais pas quoi mettre à part deux liens pour faire de la pub. Au final, il est plutôt trop long. Toujours est-il que j'espère que ce logiciel pourra être utile à quelques personnes, voire que mes élucubrations sur les répétitions ou comment les repérer auront intéressé des gens. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là : il faut que je reprenne la relecture d'un roman et... oh, mon Dieu, tant de mots soulignés, j'ai vraiment fait autant de répétitions ?
Notes
[1] Ça devrait marcher. Avec l'informatique, on ne sait jamais.
[2] En fait, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, j'ai juste essayé de traduire, si ça se trouve il y a une autre formulation consacrée.
May 13, 2015
Convertir des epub en PDF pour sa liseuse ?
Une fois n'est pas coutume, je vais plutôt parler lecture que écriture, et plus particulièrement lecture sur liseuse, des différents formats, et de comment faire des conversions de l'un à l'autre.
Les liseuses, c'est coolTout d'abord, je tiens à dire que j'aime beaucoup lire sur liseuse. J'ai eu la chance qu'on m'en offre une à Noël 2013, et ça a vraiment changé ma façon de lire.
Pour moi, c'est l'idéal. Ça permet de ne pas avoir à se trimballer des livres volumineux, et quand on lit de la Fantasy où les livres sortent souvent en grand format, ont un nombre de pages conséquents, et où une histoire fait au minimum trois tomes, c'est bien. Par ailleurs grâce à la technologie e-ink on n'a pas besoin de recharger l'engin en permanence, ce qui permet de partir une semaine en vacances sans trimballer de cable, ce qui à mon avis est l'avantage par rapport à, mettons, une tablette.
Je ne dis pas tout cela pour vous convaincre d'acheter une liseuse. Je dis juste ça pour dire que j'apprécie cette technologie. Vraiment.
Problème de composition
Cela étant dit, par rapport à un livre papier mis en page correctement, je suis désolée, mais au niveau de la composition, c'est souvent assez merdique.
La composition, c'est quoi ? Ça se dit typesetting en anglais, et c'est la partie de la mise en page qui va consister à décider quelles lettres sur telle ligne, si on décide de faire passer un mot à la ligne suivante pour que ça tienne ou si on le coupe en deux, si on fait passer une ligne sur la page suivante pour ne pas qu'elle se retrouve seule, ou encore de faire en sorte d'éviter de se retrouver avec un point d'interrogation en début de ligne.
Lorsqu'on a un fichier PDF, on fait cette composition une fois pour toutes : on sait qu'on va avoir un roman écrit en 11pt sur du A5, et c'est fait, point. Si on décide de changer de format, on doit refaire cette composition, soit en utilisant des logiciels qui vont essayer de faire le boulot le mieux possible (comme le vénérable TeX), soit manuellement en insérant un saut de page pour éviter qu'une ligne se retrouve toute seule, soit en mélangeant les deux techniques.
Ce n'est à première vue pas l'idéal pour une liseuse : en effet, les liseuses ont des tailles d'écrans différents, et les utilisateurs peuvent aussi préférer augmenter ou diminuer la taille de caractères à leur convenance. On utilise donc à place en général le format Epub, qui est en gros du HTML, et l'idée est que cette composition se fait en temps réel.
Et donc, moins bien. Je n'ai pas essayé toutes les liseuses, juste la mienne, plus quelques moteurs de rendus Epub sur ordinateur, et, désolée, mais ce n'est pas du niveau d'un livre papier. Je l'admets : pour un roman ou il n'y a pas de mise en page compliqué, c'est suffisamment correct pour que ça n'interrompe pas trop la lecture et qu'on puisse continuer, mais on peut faire mieux. Surtout que ma liseuse a la fâcheuse tendance de faire des césures pour le coup vraiment pourries. Par exemple dans « césure » on sait qu'en français on peut couper entre « cé » et « sure » mais que par contre il serait pour le moins étrange de couper juste la dernière lettre. Bon, ben, ma liseuse ne le sait pas toujours.
Il y a d'autres trucs plus subtils qu'on ne remarque pas forcément mais qui joue sur le rendu, comme jouer sur l'espacement entre les caractères et les mots (le crénage), ou les ligatures typographiques (par exemple fi devient fi).
La solution (?) : du PDF adapté à sa liseuse
Une solution pour avoir une composition plus propre serait donc d'avoir un fichier PDF qui soit adapté à la taille de ma liseuse et à la taille de caractères que je suis capable de lire. Or, avec LaTeX (basé sur TeX), je sais qu'à partir d'un fichier source écrit dans ce langage, je peux générer un fichier PDF à n'importe quelle taille et qui ait une composition assez propre.
Il faut signaler que le moteur de LaTeX fait beaucoup plus de boulot que celui qui sert à afficher le rendu d'un Epub ou d'une page Web, et il peut faire ça parce qu'il n'a pas besoin d'être en temps réel. Même sur un ordinateur puissant, cela peut prendre entre quelques secondes et quelques minutes (plus il y a de figures, d'images, de tableaux, etc. plus ça prend de temps). Ce n'est donc pas adapté si on a envie que le texte s'affiche instantanément lorsqu'on décide de changer la taille des caractères ; mais comme je sais à peu près la taille qu'il me faut et que je le génère de façon à ce qu'il soit adapté pour ma liseuse, ce n'est pas embêtant.
Malheureusement, il y a un souci : la plupart des livres numériques dont je dispose, je les ai téléchargés au format Epub, je n'ai pas les sources LaTeX.
Où l'on refait de la pub pour Pandoc
C'est donc le moment de faire une nouvelle fois de la publicité pour ce fabuleux convertisseur qu'est Pandoc (j'en avais déjà parlé lorque je m'étais mise à utiliser le format Markdown pour l'écriture de mes textes). En effet, Pandoc est, depuis la version 1.13, capable non seulement de générer de l'Epub mais de le prendre en format d'entrée, ce qui permet de convertir un fichier Epub en LaTeX (ou directement en PDF).
Il ne restait donc qu'à générer un template LaTeX adapté à ma liseuse. Malgré le fait qu'il soit pour le moins très crade (et, tel qu'il est, uniquement adapté pour le français), le voici. Si d'aventure vous aviez envie de jouer avec, sachez juste que la ligne à modifier pour l'adapter à votre liseuse est la suivante (et en particulier les paramètres 'paperwidth' et 'paperheight' :
\usepackage[paperwidth=4.07in, paperheight=5.43in, top=1cm, left=0.5cm,bottom=1cm,right=0.5cm]{geometry}
Il suffit ensuite de placer ce fichier dans un répertoire "templates", et de jouer un peu avec les options de Pandoc, et la ligne suivante devrait fonctionner (à supposer que vous ayez placé le répertoire templates dans le répertoire courant ("./") :
pandoc -s --chapters --data-dir=./ --from=epub -o livre.pdf livre.epub
Bilan et perspectives
J'ai testé ça sur quelques livres numérique que j'avais téléchargés, et j'ai eu à vrai dire la surprise que ça marche pratiquement du premier coup. En regardant de plus près, tous les fichiers n'étaient pas parfaits, il y avait parfois des petits soucis liés à l'encodage, donc il faudrait regarder ça de plus près, mais mon but était à vrai dire surtout de tester ce que ça pouvait donner, pas de proposer un super outil.
Et le résultat, ma foi, est plutôt joli, ça ressemble plus à un vrai livre papier, c'est cool.
Et en même temps... ben, le truc c'est qu'une liseuse c'est quand même fait pour lire un fichier Epub, pas un PDF. Et le problème avec un PDF, même mis à la bonne taille, c'est que certaines fonctionnalités disparaissent, comme pouvoir invoquer le dictionnaire en appuyant sur un mot (notamment pratique pour lire en anglais, mais aussi parfois pour le français). Et, surtout, soyons honnête, je n'ai pas véritablement le courage de faire ça pour tous les livres de ma collection, sachant que ça risque d'impliquer que la conversion se fasse correctement.
Cela dit, je tire de tout ça trois conclusions :
LaTeX, c'est cool, et Pandoc aussi et le tout c'est des logiciels libres, youpi.
Ce serait chouette que ma liseuse intègre un moteur de rendu basé sur TeX. Pas forcément le truc par défaut, en option, ça fait que le livre prendrait peut-être une minute à devoir être « recalculé » quand on décide de changer la taille de caractères, mais putain ce serait quand même autre chose. Et puis tant qu'à écrire au père Noël, si c'était du logiciel libre, si je tombais pas, trop souvent, sur des « livres » numériques verrouillés par des DRMs sur ces livres (il est évident que s'amuser à convertir un livre ça marche pas s'il y a ces DRMs), etc. Mais bon, on peut toujours rêver...
De manière plus réaliste, on pourrait peut-être envisager de pas avoir à se taper de manipuler directement pandoc en ligne de commandes et envisager un joli plugin pour Calibre qui ferait tout ça automatiquement et produirait un joli PDF qu'il enverrait sur la liseuse[1]. J'avoue que je ne suis pas persuadée d'avoir l'énergie, la motivation, ni les compétences techniques pour m'y coller, mais bon, on ne sait jamais...
Note
[1] Si ça se trouve ça existe déjà d'ailleurs, j'avoue que je n'ai même pas vérifié
May 7, 2015
À propos de gratuité
Il y a quelques temps, j'avais vu passer un article en deux parties de Thibault Delavaud, intitulé La gratuité, pire ennemie de l'auteur indé. J'avais, à l'époque, eu envie d'écrire une petite réaction dessus, puis comme un certain nombre de choses que j'avais pour projet d'écrire, je l'avais remis à plus tard.
Il y a quelques jours, j'ai vu passer un article du même auteur qui revenait un peu là-dessus, Le mythe de la rémunération de l'auteur, et là j'ai une insomnie, donc je me suis dit que c'était le bon moment.
La gratuité, dangereuse pour les auteurs ?
Si je résume les arguments en essayant de ne pas les déformer, la gratuité n'est un outil valable pour un auteur que dans des cadres, grosso-modo, de promotion de ce qui est payant, soit en limitant la gratuité dans le temps afin de faire de la pub pour que le livre se vende mieux, soit en distribuant un livre gratuitemet afin que les lecteurs qui l'auraient découvert aient envie de lire la suite ou les autres livres de l'auteur, et pour cela mettent la main au porte-feuilles. Par ailleurs il y a l'idée que la gratuité est sur-estimée et que ce n'est pas parce que vous mettez votre chef d'œuvre en ligne gratuitement que ça va faire un buzz de ouf.
Dans l'absolu, je pense que si vous essayez de vous faire de l'argent en vendant vos livres, ce n'est pas une stratégie absurde et je suis assez d'accord sur les limites de la gratuité comme outil de promotion.
Ce qui me pose plus question, c'est qu'il y a aussi l'idée que tout travail mérite salaire et que, si vous distribuez gratuitement vos livres, vous contribuez à fragiliser l'industrie du livre et, en gros, à faire en sorte que beaucoup d'auteurs n'arrivent pas à vivre de l'écriture.
Alors évidemment, vu que d'une part je propose gratuitement à disposition une bonne partie de mes textes (même si des fois je préfère dire que c'est à prix libre, mais dans les faits ça revient à pouvoir les télécharger gratuitement), et d'autre part que je n'ai pas envie de foutre mes « camarades auteurs » dans la merde, ça m'interroge.
Les textes gratuits cassent-ils le marché ?
Ce qui m'a amené à me poser la question : est-ce que les textes gratuits « cassent le marché », et donc la rémunération des auteurs ? Sauf que je pense, à la réflexion, que la question est, comme cela, assez mal posée.
Déjà, mettons qu'on se dise « je vais lire un livre, n'importe lequel, je vais donc prendre le moins cher » ; soit, mais dans ce cas, est-ce que la plupart des gens se tournent vraiment vers des auteurs auto-édités inconnus, plutôt que de piocher dans les nombreux auteurs classiques tombés dans le domaine public et reconnus comme d'une grande qualité littéraire et qu'il est bon d'avoir lu ? Je n'en suis pas persuadée.
Surtout, je pense que la plupart du temps, on a envie de lire un livre donné, ou un livre d'un·e auteur·e donné·e, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'un·e ami·e l'a trouvé génial, parce qu'il a eu une super bonne critique, ou alors parce qu'on est fan de la série télé qui en a été adaptée.
Autant dire que dans ce cadre, oui, la gratuité (ou un pris très faible) peut-être un élément un peu déloyal mis en place par un grand éditeur qui s'en sert pour inonder le marché, en investissant de l'argent dans la publicité, les médias, etc. Mais je doute que cette faculté de « casser le marché » soit la même pour les petits auteur·e·s auto-édité·e·s qui diffusent leur livre gratuitement puisque de toute façon tout l'argent qu'ils pourraiennt gagner avec c'est 15,24€ et un mars.
L'auteur indé doit-il être petit patron ?
Bref, ce qui me gêne avec les articles sus-mentionnés, c'est que ça donne l'idée que la gratuité « dangereuse » vient avant tout des petits auteurs auto-édités et pas des campagnes de promotions agressives menées par des entreprises qui ont un peu plus de pouvoir sur le « marché »[1]. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que je vois une certaine tendance à pointer du doigt les « amateurs » d'un domaine qui feraient du tort aux « professionnels ».
Comme je le disais en introduction, je ne trouve pas les conseils sur l'utilisation de la gratuité absurdes pour des auteur·e·s qui désirent se faire de l'argent avec leurs œuvres. Ce qui me pose question, en revanche, c'est que ce soit le seul modèle envisageable, et quand bien même l'auteur reconnaît dans son article que la majorité des auteur·e·s ne vivent pas de leur plume et que « si vous ne gagnez pas votre vie avec la vente de vos livres, ne désespérez pas, c’est tout à fait normal ». Dans ce cadre, est-il vraiment si absurde que le fait de faire de l'argent et des ventes ne soit pas forcément l'objectif principal d'un certain nombre d'auteurs dits « amateurs » ?
Certes, on peut dire que « tout travail mérite salaire », et certes il est très difficile pour un·e auteur·e de faire en sorte que son écriture soit considérée comme un travail légitime. Pour autant, est-ce qu'il faut forcément considérer l'écriture comme un travail ? Est-ce que tout processus créatif doit forcément être monétisé ?
Ça rejoint quelque chose qui me gêne dans beaucoup de discours que je vois passer sur l'auto-édition : le fait de vouloir absolument s'éloigner de ce qui peut relever de l'amateurisme ou du DIY (j'avais écrit un article il y a quelques temps sur les liens que je voyais entre auto-édition et DIY) et où il faut penser commercial, marketing, professionalisme. Au final l'auto-éditeur doit se muer en auto-entrepreneur, voire en petit patron : comment espérer faire des ventes avec une couverture peu attractive ? il faut bien recruter un graphiste professionnel (stagiaire si possible, ça réduira vos frais).
En soit, ça ne me pose pas de problèmes que des gens aient cette approche[2] (et je confesse que j'ai le cul un peu entre deux chaises là-dessus), mais ce qui me gêne c'est que ça devient le seul discours et au final la seule possibilité dans ce domaine. Vous voulez essayer de vous faire de l'argent avec vos livres ? Ok, ça ne me pose pas de problème, franchement, je comprends, un peu d'argent, surtout quand on n'en a pas beaucoup, c'est toujours ça de pris. Mais si vous considérez que l'écriture c'est un loisir, que vous avez envie de diffuser des textes gratuitement, ben très bien aussi. Oui, même si vous estimez en votre âme et conscience que c'est pas un niveau « profesionnel » et qu'il y a quelques maladresses et sans doute quelques coquilles. Et même si vous mettez comme couverture le dessin que votre petit frère a fait sous Paint et que vous, vous trouvez cool mais qui, objectivement, n'est pas du niveau d'un·e graphiste professionnel·le.
Je ne pense pas que faire ça nuise aux auteur·e·s qui essaient d'en vivoter ou tout du moins de gagner un peu d'argent, de même que je ne pense pas que le groupe de punk qui joue à prix libre dans un squat mette en danger les revenus de Johnny Hallyday ou de groupes de musique semi-professionnels. On pourrait cependant, à juste titre, m'objecter qu'un certain nombre de textes gratuits sont diffusés sur Amazon ou Kobo, qui sont loins d'être des squats autogérés et qui, eux, ne se privent pas pour s'en servir d'argument de vente. Cela dit il me semble que le problème est dans ce cas plus lié à une question d'indépendance[3] que de gratuité.
Comme avec les pirates, je pense que c'est prendre le problème par le mauvais bout que de cibler les auteur·e·s qui diffusent gratuitement leurs textes. Il me semble que si on veut s'interroger sur la gratuité et ses conséquences, on pourrait commencer par regarder d'un peu plus près non pas les gens qui créent du contenu gratuitement mais les entreprises qui se font du beurre sur ce contenu, qu'il s'agisse d'Amazon pour les livres mais également de Facebook, Tumblr, Twitter, Wordpress, etc., ou encore des phénomènes comme le crowdsourcing, la récupération commerciale du « participatif » qui camoufle souvent un travail gratuit, etc. (Et tant qu'à faire on pourrait s'interroger sur la propriété privée des moyens de production, et conclure par Vive la sociale !, mais je m'enflamme un peu.)
Notes
[1] Ou, pour élargir hors du domaine du livre, des entreprises qui proposent un service censément « gratuit » mais où vous êtes le produit.
[2] Du moins, le fait de considérer l'auto-édition comme une possibilité de se faire de l'argent, je ne cautionne évidemment pas l'exploitation de stagiaires.
[3] De plus en plus difficile à atteindre en ces temps où, pour avoir une chance d'être lu·e, il faut passer par Amazon pour les livres et par Facebook ou Twitter pour les articles de blog.
May 5, 2015
Un début de roman (?)
Ça fait longtemps que je n'avais rien écrit, et encore moins posté d'extraits. Voici donc ce qui pourrait constituer le prologue (ou pas) d'un projet de roman... encore que je ne sois pas très convaincue par l'univers, donc je ne suis pas contre des retours, si ça vous donne envie ou au contraire si vous trouvez ça tout moisi. Il s'agit, pour une fois, d'un projet qui s'écarte de la ''fantasy urbaine'' et qui se passe dans un univers qui, sans être médiéval au sens strict est inventé de toutes pièces, et j'avoue que je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec ce genre là. Mais bon, je vous laisse juger sur pièce...
Prologue« Il n'est pas trop tard », dit, d'une voix faible, le ministre du commerce Silas de Vassarie. « Il est encore temps de faire machine arrière. »
Gladia dut se retenir pour ne pas éclater de rire. À la porte, des gardes tambourinaient et menaçaient d'entrer par la force si elle ne leur ouvrait pas. Il leur faudrait encore un peu de temps, cela dit : la porte du bureau était non seulement majestueuse, avec ses ornements décoratifs et ses dorures, mais également plutôt solide.
Gladia balaya la pièce des yeux. Elle était suffisamment spacieuse pour accueillir une bibliothèque personnelle, une commode qui renfermait, elle le savait, du matériel de papeterie et quelques bouteilles de boissons alcoolisées, un grand bureau en bois massif ainsi que plusieurs fauteuils. Le plus imposant de ceux-ci était celui du ministre, sur lequel son occupant, Silas de Vassarie était attaché par les poings et les pieds. Gladia, cependant, ne s'intéressait pas aux meubles, pas plus qu'au secrétaire personnel du ministre qui gisait, inconscient, au milieu de la pièce. Elle examinait la fenêtre aux rideaux tirés, seule autre issue à part la porte d'entrée. Elle n'avait pas besoin d'aller jeter un coup d'œil pour savoir que l'ouverture était située à une bonne centaine de mètres au-dessus du sol.
Foutues traditions elfiques, ronchonna Gladia. Cela faisait belle lurette que plus personne, à part quelques ahuris intégristes qui prétendaient vivre en communion avec Gaïa, ne songeait à habiter dans des arbres, mais il y avait toujours cette manie des hauteurs chez les aristocrates. Plus on habitait haut, plus on avait une place élevée dans la société, et le bureau des ministres se trouvaient tous ou presque au palais royal, qui était évidemment la construction la plus élevée du royaume d'Ypsili.
Cela n'était pas sans avantage : à moins que la garde royale n'ait déjà appelé un de ses dragons à la rescousse, il faudrait que les soldats arrivent à enfoncer la porte avant que Gladia ne soit interrompue.
« Il n'est pas trop tard », répéta le ministre, sur un ton implorant.
Mais il était méchamment trop tard pour faire machine arrière, songea Gladia en regardant l'homme couvert de sang. Elle avait dû le faire parler, comme elle avait fait parler beaucoup de gens avant lui. Elle voulait une confession, et elle l'avait obtenue. Elle n'avait pas eu à aller très loin : juste quelques coupures, une petite menace sur son intégrité physique, et monsieur de Vassarie s'était mis à table. Mais ces petites égratignures, même si elles pouvaient sembler dérisoires comparées aux actes de torture qu'avait pu commettre Gladia au service du roi, étaient suffisantes pour ne plus pouvoir faire machine arrière.
Sans compter qu'il y avait le contenu de la confession.
« Par les pouvoirs qui me sont conférés, commença Gladia, je vous déclare coupable de viol et de meurtre. La sentence est la mort.
— Réfléchissez, protesta le ministre, au bord des larmes. Vous avez du potentiel. Vous allez vraiment gâcher votre vie pour faire justice à une traînée ? »
Gladia dégaina sa dague. Le ministre hurla. Elle frappa d'un coup, brusque, précis, en plein cœur, puis le regarda dans les yeux alors que la vie le quittait.
« Je croyais que vous, les Hauts-Elfes, vous étiez immortels, lâcha-t-elle à son cadavre. On dirait que c'est des fadaises, hein ? »
De nouveaux coups sur la porte la ramenèrent à la réalité. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire, il était maintenant temps qu'elle se tire de là. Gladia se leva, nettoya sa lame à l'aide d'une veste qui devait valoir son salaire mensuel, et se dirigea vers la fenêtre.
Celle-ci se brisa en éclats dès qu'elle tira le rideau. La garde royale avait effectivement fait vite pour rameuter ses dragons, ou au moins un de ceux-ci. Elle s'écarta de la fenêtre afin d'éviter de se prendre une décharge de fusil éthérique dans la tête, et espéra que le dragonnier éviterait de pousser sa monture à la réduire en cendres pour ne pas mettre la vie du ministre en danger.
« Ouvrez ! hurla-t-on du côté de la porte. Au nom du roi ! »
Les coups reprirent ensuite de plus belle. Gladia les ignora et attrapa le sac à dos avec lequel elle était venue. Elle en sortit un engin étrange, une petite sphère de la taille d'un poing munie d'une goupille. Elle enfila le sac à dos et prit une grande inspiration, afin de se préparer à ce qui allait suivre. Elle réalisa alors que les coups avaient cessé, ce qui n'était pas bon signe. Cela voulait probablement dire que quelqu'un avait trouvé des explosifs. Il était temps de déguerpir.
Elle courut vers la fenêtre et écarta les rideaux. Une balle la toucha à la jambe et elle grimaça de douleur, mais elle parvint néanmoins à franchir la balustrade et à sauter dans le vide, tête la première. Alors que Gladia commençait à trouver son plan de sortie beaucoup moins attractif que lorsqu'elle l'avait préparé, elle dégoupilla la petite sphère qu'elle tenait entre les mains et la jeta.
Le petit engin avait pour nom militaire la grenade magnéto-éthérique. Elle avait été inventée trente ans plus tôt lors de la guerre contre la République de Manka. Le principe était simple : une petite capsule d'éther conçue pour émettre un puissant champ magnétique s'activait, projetant des morceaux de fers mortels dans toutes les directions. C'était, tout du moins, l'usage « normal » de l'engin. Le spécimen de Gladia différait quelque peu, puisque le mécanisme avait été modifié pour se déclencher sur quelques secondes au lieu d'une fraction. De plus, les éclats destinés à tuer avaient été retirés de l'engin. À la place, Gladia portait quelques kilos de ce métal dans son sac à dos.
L'idée était la suivante : lorsque la grenade explosait au sol, elle ne faisait pas de victimes, mais émettait un puissant champ magnétique qui ralentissait la chute du sac à dos, et de la personne qui le portait. Celle-ci s'immobilisait alors en plein air plutôt que de s'écraser par terre, puis descendait lentement à mesure que le champ magnétique disparaissait. Le dispositif n'avait, cependant, pas encore été testé dans des conditions réelles.
Il s'agissait donc d'une grande première scientifique et, comme beaucoup, elle ne se passa pas exactement comme prévu. Gladia eut d'abord l'impression qu'on lui arrachait les bras lorsque le champ magnétique s'activa ; puis elle rebondit contre le vide et fut projetée une vingtaine de mètres plus loin. Heureusement pour elle, le palais royal était entouré de jardins luxuriants, ce qui fit qu'elle s'écrasa dans l'herbe plutôt que sur des dalles en pierre.
Il lui fallut quelques secondes pour reprendre ses esprits. Elle avait mal partout : à la jambe gauche, celle qui avait été touchée par le dragonnier, d'abord, mais les bras et les dos venaient pas loin derrière, suivis de la tête et du ventre.
Elle se releva avec difficulté et retira son sac à dos, maintenant trop encombrant. Elle entendit un battement d'ailes de dragon dans son dos et décida qu'il valait mieux se mettre à courir. Sa jambe gauche protesta néanmoins, et elle dut se contenter de boiter en espérant ne pas être trop lente. Les choses ne se passaient pas exactement comme prévues, mais elle avait encore une chance d'atteindre les arbres. Là, elle pourrait espérer échapper au dragon.
Dans l'obscurité, elle n'arrivait pas trop à voir où étaient ces arbres en question. Cinquante mètres ? Cent ? Elle entendit alors les hurlements des loups, venant de quelque part vers sa gauche.
Merdasse, jura-t-elle intérieurement. Les loups du palais. Elle avait amené de quoi les repousser dans son sac, mais elle venait d'abandonner celui-ci, et il n'était pas question de faire marche arrière pour aller le rechercher. Pas avec ce dragon qui rôdait au-dessus d'elle et la guettait.
Un jet de flammes, quelques mètres devant elle, lui indiqua qu'il l'avait trouvée. Saloperies de dragons. Ils avaient une meilleure vision nocturne qu'elle, apparemment. Si elle avait été une Haute-Elfe plutôt qu'une elfe commune abâtardie, elle aurait peut-être pu partager ce don. Non pas que ça avait beaucoup aidé Silas de Vassarie.
« Les mains en l'air ! ordonna le dragonnier du haut de sa monture. Au nom du roi ! »
Gladia hésita quelques instants et évalua ses chances. Elle était blessée à la jambe, et avait laissé la plupart de ses armes dans son sac à dos. De plus, elle n'avait pas pour objectif de tuer un simple soldat qui ne faisait que son boulot. Elle n'était pas venue pour ça.
Elle leva donc les mains, lentement, et attendit que le dragon se pose devant elle. Elle perçut des cris lointains, qui semblaient se rapprocher.
« Je dois admettre », annonça-t-elle au dragonnier, qui la tenait en joue avec son fusil éthérique. « T'es plutôt doué. »
Le dragonnier releva les lunettes qui lui protégeait les yeux lorsqu'il était en vol, et afficha un air surpris.
« Gladia Courtelame ? s'étonna-t-il. C'est vous ? »
Gladia l'examina plus en détail. Il portait la tenue réglementaire de sa fonction, c'est-à-dire une armure en cuir légère marquée des armes d'Ypsili. Malgré l'obscurité, elle aurait juré ne l'avoir jamais vu. D'après son jeune âge apparent, il ne devait pas être au service du roi depuis très longtemps.
« On se connaît ? demanda-t-elle.
— Je m'appelle Artémon, expliqua le jeune homme. J'ai entendu parler de vous. »
Derrière elle, Gladia entendait des cris et des bruits de pas qui se rapprochaient. Les renforts. De quoi chasser toute idée de s'échapper en volant la monture d'Artémon. De toute façon, elle ne savait pas diriger un dragon.
« Par Gaïa, soupira le jeune homme, qu'est-ce que vous avez fait ? »
March 31, 2015
Pas tout à fait des hommes, nouvelle édition (numérique)
Un petit article pour vous annoncer la sortie d'une nouvelle version d'un « vieux » roman, Pas tout à fait des hommes.
Présentation
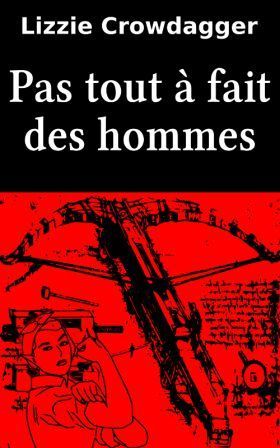
« Je voyais les elfes plus grands »
Kalia, la seule elfe de la ville à travailler dans la garde, se contente d'ordinaire d'essayer de survivre et d'éviter les ennuis... Du moins, jusqu'au jour où elle rencontre Axelle, une voleuse démoniaque qui va bouleverser sa vie.
Avant de réaliser ce qui lui arrive, Kalia va se retrouver confrontée à des orcs révolutionnaires, des nains remontés, un général belliqueux, un vampire schizophrène, une prophétie obscure, une épée sacrée, un Élu au coeur pur, ainsi qu'une multitude d'autres choses potentiellement mortelles mais au nom moins impressionnant.
Pas tout à fait des hommes est un roman de fantasy médiévale plutôt léger et humoristique, qui joue sur les clichés du genre et aborde des thématiques comme le féminisme, l'homosexualité, les violences policières et parle même de révolution.
La première version de ce roman a été diffusée sur Internet il y a maintenant pratiquement dix ans, et le livre a ensuite été auto-édité, tant en version papier qu'en numérique.
Téléchargement
Le livre est disponible dans les formats suivants :
PDF (en A5), pour imprimer ou lire sur ordinateur ;
Epub, pour lire au format numérique, par exemple sur liseuse ;
HTML, pour lire en ligne ;
Au format livret, version PDF uniquement adaptée pour une impression papier en recto-verso.
Quelques remarques sur ces différents formats. Le version Epub est sans doute celle qui a été le plus retravaillée, le but étant d'avoir quelque chose qui fasse un peu plus « pro ». En tout cas, je trouve que ça allait plutôt bien sur ma liseuse, mais n'hésitez pas si vous avez des retours à faire. La version PDF, quant à elle, est mise en page pour de l'A5, ce qui permet à la fois de l'imprimer mais aussi de le lire sur un écran de bonne taille (ordinateur, par exemple) sans trop s'abîmer les yeux. Ça reste possible de l'imprimer en A4 (ce sera juste écrit gros), mais vous allez gâcher du papier. Afin de faciliter une impression, je propose également un fichier mis en page pour imprimer en livret, c'est-à-dire sur du A4 en recto-verso, avec deux pages par feuille, et où il faut replier à la fin pour obtenir le livre. J'avoue que je suis dubitative sur la possibilité de regrouper autant de feuilles en les pliant simplement (c'est un roman entier, pas une longue nouvelle), mais peut-être qu'avec un peu d'ingéniosité vous arriverez à en faire quelque chose.
Quoi de neuf
Cette nouvelle édition n'est pas une réécriture en profondeur, il y a peu de changements majeurs. À vrai dire, la modification la plus visible est le nom de l'auteure : ce livre avait à l'origine été publié sous un autre pseudonyme, et j'avais continué à le diffuser sous ce nom, ce qui en terme de lisibilité n'est pas terrible.
Un autre objectif de cette « réédition » était d'avoir une version numérique qui soit d'une qualité un peu supérieure, puisque j'avais réalisé la version précédente à une époque où je n'avais pas de liseuse et pas d'expérience du format « livre numérique ». J'en ai évidemment profité pour corriger les coquilles que je voyais (en espérant ne pas en ajouter trop de nouvelles) et j'ai également ajouté ou supprimé quelques mots, voire quelque lignes, à des endroits, mais c'est vraiment marginal : il s'agit d'une relecture (et surtout d'une remise en page), pas d'une réécriture.
À propos du roman
Comme je l'ai dit, j'ai terminé la première version de ce roman il y a maintenant dix ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Il y a sans doute des choses que je n'écrirais pas pareil maintenant, mais l'idée était de corriger un peu le livre, pas de le réécrire.
Soyons honnête : en la relisant, j'ai trouvé un certain nombre de défauts dans cette œuvre, et je pense notamment que je voulais mettre beaucoup trop de choses dans un roman qui n'est pas très long. Il faut dire que j'ai écrit ce livre à une époque où je découvrais beaucoup de choses : le féminisme, le communisme, les débats « réforme ou révolution », l'impérialisme, le colonialisme, le rôle de la police, etc. Le résultat, c'est qu'il y a parfois une certaine confusion, des choses qui sont abordées de manière trop légère, ou au contraire des moments où la narration s'apesantit un peu trop sur certaines choses alors qu'il s'agit d'une œuvre de fiction. Le résultat, c'est qu'il y a un usage des ellipses parfois un peu exagéré et des évènements qui sont passés très rapidement alors qu'ils auraient dû être détaillés.
Je ne dis pas ça pour me flageller particulièrement ; soyons honnête, je pensais que devoir relire un texte aussi ancien serait une corvée, et ça a été en fait un véritable plaisir. À vrai dire, je pense que les défauts évoqués ci-dessus sont liés au fait que c'est, finalement, une de mes œuvres les plus ambitieuses, à cause des sujets qu'elle aborde. Sans doute que ce roman aurait gagné à être plus long, voire à faire plusieurs tomes, afin d'être à la hauteur de cette ambition. Peut-être qu'un jour j'aurai le courage d'écrire une saga de fantasy épique en sept tomes qui racontera une fresque révolutionnaire ; en attendant, Pas tout à fait des hommes, malgré ses défauts, reste un de mes livres préférés (parmi ceux que j'ai écrits).
Univers
Un certain nombre de nouvelles se déroulent dans le même univers, Erekh, notamment Sortir du cercueil et Une mine de déterrés, tous deux également inclus dans le recueil Sorcières & Zombies.
Licence
Ce roman a par ailleurs été écrit à une époque où je croyais beaucoup aux idées du libre[1], et par conséquent il est distribué sous une licence qui vous permet de le copier, le distribuer et le modifier, y compris commercialement, à condition que ce soit sous la même licence. Plus précisément, il s'agit de la Licence Art Libre.
Autrement dit : si vous pensez que ce roman serait mieux en devenant une saga de fantasy épique en sept tomes, et que vous avez du temps à perdre, vous avez le droit de le faire.
Note
[1] Je crois toujours à la pertinence du logiciel libre, par contre je suis un peu plus circonspecte sur l'intérêt d'appliquer ce genre de licence à des romans.
March 24, 2015
Relooking
Comme vous avez pu le constater, j'ai profité d'une mise à jour de Dotclear (et du fait que j'avais du mal à adapter le merdier bidouillage que j'avais fini par faire autour d'un des thèmes) pour changer l'apparence de ce site. Bon, c'est un thème livré tout fait, donc pas d'une folle originalité, mais au moins ça fait un peu de changement.



