Christophe Claro's Blog, page 64
October 25, 2016
L'indépassable horizon du ridicule: bienvenue à Jardin-Land.
 Grâce à Alexandre Jardin, l’amour est désormais à la portée des caniches, qui plus est sous forme de croquettes stylistiques. Dans son « dernier » roman, Les Nouveaux Amants, notre cardiologue des passions tente le tout pour le tout et dissèque le grand lapin sanguinolent d’une liaison vouée, tout comme son livre, à l’échec. Oui, une fois de plus, Jardin joue avec des allumettes ignifugées pour nous expliquer la Flamme, son vit, son nœud, inventant pour l’occasion un Valmont sous tweeter et une Justine sous valium. Précisons d’emblée que son roman, hélas pas assez novateur pour la collection Harlequin, s’est mis en tête de fricoter avec la forme. Oui, l’auteur a donné à son pensum l’allure extérieure d’une pièce de théâtre. Mais comment diable a-t-il réalisé ce faramineux tour de passe-passe ?
Grâce à Alexandre Jardin, l’amour est désormais à la portée des caniches, qui plus est sous forme de croquettes stylistiques. Dans son « dernier » roman, Les Nouveaux Amants, notre cardiologue des passions tente le tout pour le tout et dissèque le grand lapin sanguinolent d’une liaison vouée, tout comme son livre, à l’échec. Oui, une fois de plus, Jardin joue avec des allumettes ignifugées pour nous expliquer la Flamme, son vit, son nœud, inventant pour l’occasion un Valmont sous tweeter et une Justine sous valium. Précisons d’emblée que son roman, hélas pas assez novateur pour la collection Harlequin, s’est mis en tête de fricoter avec la forme. Oui, l’auteur a donné à son pensum l’allure extérieure d’une pièce de théâtre. Mais comment diable a-t-il réalisé ce faramineux tour de passe-passe ?Autant que vous le sachiez tout de suite : au lieu d’intituler ses chapitres « chapitre », il les intitule « scène » – son roman/théâtre comportera donc près de soixante-dix scènes, mais hélas aucun « acte », même si le rideau tombe avec la régularité d’un tranchoir à boudin. Dois-je vous spoiler l’incroyable histoire que Jardin a décidé de nous narrer aussi théâtralement ? Essayons : un écrivain parisien célèbre trompe sa femme belle mûre actrice avec une jeune et jolie métis mariée délurée de province. Ils résistent, cèdent, résistent encore, cèdent de nouveau, ce qui laisse supposer au bout d’un moment un défaut de fabrication. Précisons que le héros, Oskar Humbert – on ignore si Jardin a voulu dissimulé le mot « carambar » dans son nom… – écrit une pièce de théâtre, qu’il customise à mesure que sa passion avec Roses Violente – no comment– s’exalte et se délite. Il y a même une scène dans la suite Bovary d’un boutique-hotel, pour ceux qui ont des lettres et du temps à perdre. Mais laissons reposer la pâte du sujet, qu’éclipse sans scrupule une écriture… une écriture… comment dire ? Ici, le terme « écriture » est impropre. Car Jardin veut tellement sonder la psychologie de ses personnages, lesquels ont pourtant l’épaisseur de gaufrettes virtuelles, qu’il finit par faire de son style une entreprise coloscopique.
Bien décidé à pilonner son sujet (et le lecteur avec), Alexandre Jardin en vient à écrire comme si l’expression « pédaler dans la choucroute » était un mot d’ordre, une contrainte jubilatoire, ou pire, une technique imparable. Il met Sami et Gondis dans un pédalo et hop ! vogue la galère sur son petit lac de chou ! Mais entrons dans le vif du sujet sans prendre de gants et en restant sourd aux cris du récit malmené…
C’est désormais un fait acquis : Jardin jardine, sans doute pour ratisser large, mais sa phrase n’arrose hélas qu’elle-même. Emporté par sa plume pubère, il trousse les poncifs comme des dindes, au point de leur faire rendre farce. Sa prose est tellement acculée qu’elle ne recule devant rien. Ainsi, décrivant l’œuvre de son héros, il n’hésite pas à se fendre de ce qui doit être une phrase :
« Les pièces pressées de Humbert étaient autant de miroirs promenés le long de la route du plaisir qui déverrouille les désirs et interdit l’érosion de soi. »Je suppose naïvement que c’est le plaisir qui déverrouille, pas la route, mais qu’importe, du moment qu’on « interdit l’érosion » du moi. Les généralités, ont le sait, ne font pas peur à Jardin, et pour cause : c’est lui qui les effraie, les obligeant à grimacer. Sa science de la nature humaine, combinée à un sens bricolo de l’allégorie, donne ce genre de chef-d’œuvre :
« Une femme est comme une commode faite d’une multitude de tiroirs visibles et de tiroirs secrets renfermant eux-mêmes d’autres tiroirs qui ouvrent d’autres tiroirs… dans lesquels on trouve encore d’autres tiroirs qui excitent l’imagination ! »C’est sûr : un tiroir qui ouvre un tiroir, ça excite l’imagination. La femme, cette commode. Pratique, non ? Tout est relatif, me direz-vous. Eh bien, justement, à propos de relatives, Jardin n’a pas son pareil, sans doute parce que l’idée de caresser un qui-qui le stimule :
« Il lui fallait conserver une preuve qu’elle n’avait pas rêvé ces mots improbables qui lui confirmaient qu’il était possible, certains jours, de se désengluer du réel pour empocher sa part de bonheur. »Quel prestidigitateur ! One, je me désenglue ; two, j’empoche. Cet art consommé du simultanéisme, on la retrouve à tout moment, comme si Jardin aimait faire deux choses en même temps, sans se rendre compte qu’il les oblige ainsi à une forme brouillonne de sodomie syntaxique. Exemple (parmi cent, que dis-je ? parmi mille !) :
« Son sourire un peu crispé laissa filtrer sa répugnance pour l’inattendu, comme une alarme de son goût pour la tranquillité. »Il faut dire que ses personnages n’ont pas la psyché facile : ils sont, tour à tour, ces pauvres carnes, « puceau du vertige », « toqué d’engagement », « pétrie de lenteurs », « lustrée de lettres », « rongée de culpabilité », « avide de quiétude rectiligne », « tremblant d’émotion », « gourmande de sensualité », « englué dans le chagrin », « glacé d’horreur »… Qualifier : telle est la grande mission de Jardin, qui ne veut laisser aucun recoin de l’âme inexploré, et pour cela colle partout des étiquettes portant le nom de la chose. En plus, tout ça baigne dans la modernité : les deux amants sont tellement connectés – tweeter, facebook, whatsapp, skype – qu’on se demande pourquoi ils boudent myspace. (Mais comme ils doivent skyper discrètement, ils coupent le son et brandissent devant l’écran des feuilles avec des mots inscrits dessus – sans doute une métaphore de la façon dont Jardin conçoit l’écriture…)
Passons sur la manie interrogative qu’il partage avec Zeller, Foenkinos et quelques autres, et qui consiste à poser en permanence des questions. Bon, quand je parle de manie, je suis en deçà de la vérité, car dans ce libre, les questions, eh bien il y en a pas moins de six cents. Oui, on s’interroge énormément dans ce livre, un peu comme si on passait son temps à frapper à une porte qui serait le front du lecteur. Le plus effarant dans l’affaire, c’est qu’on sent que Jardin est content de lui, à chaque phrase, à chaque tournure de phrase, à chaque retournement de phrase. Dieu que ses phrases sont tournées ! Mais tournées vers quoi sinon l’horizon indépassable du ridicule ? Là, encore, voici les faits : « Ils avaient la faculté de se propulser l’un l’autre dans un étrange somnambulisme. » Ou encore : « Jouissant littéralement de desserrer sa bienséance… » Ou pire : « Son oreille semblait dire… » Bonus : « Oskar prit sa main qui venait de délivrer son dos. » Le pied, quoi.
Et quand ses phrases cessent de jouer à pirouette-cacahuète, c’est pour sombrer dans l’idiotie absolue, grâce à un sens de la formule qui laisse pantois : « L’amour doit être un endroit où l’on déverse sa transparence. » Avec, parfois, des envolées féministes comme on en a rarement vues : « Certains hommes font regretter aux femmes de n’être qu’elles. »
Jardin n’a peur de rien quand il s’agit d’aplatir le sens. Sa méthode est simple : plus c’est gros, plus ça passe (les enfants sont priés de ne pas essayer dans la vraie vie). Exemple : « La vie est à vivre. » (fin de la scène 15…). Je n’invente rien : la vie est à vivre ! Notre auteur doit être finalement un peu comme son personnage féminin, Roses, laquelle est – accrochez-vous – « prête à snifer l’incohérence maximale qui, seule, lui procurait un shoot suffisant de sensations ». Lui aussi a dû sentir en son tréfonds « l’émotion qui induit à penser que l’on est vivant, malgré les déceptions qui engrisaillent l’existence ». De toute façon, c’était ça ou parvenir au constat suivant: « Impossible de laisser les coudées franches à la joie très triste qui l’inondait ».
J’aimerais arrêter là, mais ça serait dommage, car vous rateriez le meilleur. Oui, car il reste dans ce roman « une cargaison d’images importunes qu’elle désirait éteindre » ! Etes-vous prêt à éteindre des cargaisons ? C’est parti ! Entrez donc ! Venez visiter « les mystérieux rouages du cœur » ! Ce n’est pas sans risque, et peut-être ne voulez-vous pas finir comme Roses, qui « noya son désappointement dans un Niagara de pensées fermes », même si l’érotisme forcément débridé auxquels se livrent les deux amants est « sans défectuosité ». Oui, parce que bon, il ne s’agirait quand même pas de « nier les turbulences à venir qui les usait par en dessous », quitte à « explorer les dédales de ses affinités avec l’humiliation ». Non, non, non, hors de question.
Mais je capitule. Je n’ai pas envie, comme Roses, d’être « emporté par une crue de larmes inarrêtables ». Bien sûr, on me rétorquera qu’il est facile de sortir des phrases de leur contexte pour les stigmatiser. Que le lecteur de ce blog me remercie plutôt de lui épargner le contexte. Ou plutôt qu’ici, texte et contexte sont inextricables, tous deux voués au dieu Charabia. En revanche, je ne vous ferai pas grâce de la dernière ligne du roman, qui se trouve être une « note de l’auteur », située en bas de page alors qu’on en était venu à douter sérieusement que la page pût tomber plus bas :
« Ecrire, c’est ouvrir mille portes. »Là, j’ai envie de dire que mille, c’est beaucoup. Surtout si elles sont déjà ouvertes. Allons, ne boudons pas notre plaisir et finissons sur une note positive, une note optimiste, un drelin-drelin nonpareil. Oui, tout n’est pas à jeter dans ce roman hormonalement déréglé. Il y a parfois des fulgurances. Bon, il n’y en a pas mille non plus. En fait, il n’y en a qu’une. Elle est facile à trouver, car elle figure à la page 20, après laquelle on commence à se pincer pour vérifier qu’on ne rêve pas. J’appelle donc à la barre LA fulgurance du livre :
« Ma sincérité est un répertoire de bourdes. »Je veux bien croire qu’Alexandre Jardin soit sincère. Ceci expliquerait cela. ________________
Alexandre Jardin, Les nouveaux amants, éd. Grasset, 19 € (non remboursables)
Published on October 25, 2016 01:06
October 24, 2016
La photo (brisée) du jour
Published on October 24, 2016 21:30
October 23, 2016
Anti-manuel de suicide
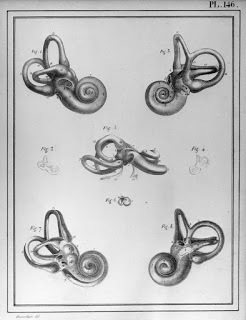 Il y a à peu près six ans, j'ai reçu un bref roman écrit par un auteur canadien (anglophone), assorti d'une lettre où l'auteur me confiait la lecture et, espérait-il, la traduction de son livre. La requête était inhabituelle.
Il y a à peu près six ans, j'ai reçu un bref roman écrit par un auteur canadien (anglophone), assorti d'une lettre où l'auteur me confiait la lecture et, espérait-il, la traduction de son livre. La requête était inhabituelle.Le hasard (ou ma négligence – surtout ma négligence) a voulu que je range le livre non sur l'étagère des livres à lire mais quelque part, perdu entre divers lexiques et inutiles dictionnaires. Est-ce moi qui ai caché le livre ou le livre qui a préféré attendre que je sois prêt? Allez savoir. Le fait est qu'il y a quelques mois, lors d'une absurde velléité de rangement, je suis tombé dessus. L'auteur s'appelle Jason Hrivnak, et son livre The Plight House.
Je l'ouvre donc, étonné, et décide de le lire. Et aussitôt me voilà… subjugué. Embarqué. C'est un livre étonnant, et ce pour de nombreuses raisons dont je vous reparlerai si vous n'êtes pas sage. Il commence ainsi:
"Le 7 mai 2006 au petit matin, mon amie d’enfance Fiona est entrée par effraction dans l’école élémentaire qu’elle et moi fréquentions il y a plus de vingt ans. Elle était vêtue de couches de vêtements élimés et portait dans un sac en toile l’intégralité de ses biens terrestres. D’une indépendance farouche, d’une nature indocile, Fiona avait passé une bonne partie des dix dernières années à vadrouiller à l’étranger. Elle avait subsisté comme elle pouvait sur trois continents, toujours en quête des drogues les plus fortes et des plus sombres déshérités. Personne ne savait qu’elle était rentrée à Toronto. Je l’imagine à la fois embellie et accablée par cette absence de responsabilité, par l’effroyable liberté de celle qui s’endort là où elle tombe et dont les points de chute sont un mystère perpétuel."Le narrateur du livre apprend, par le mère de Fiona, que celle-ci s'est suicidée. Elle fut son amie d'enfance, et surtout sa partenaire dans des jeux d'imagination déroutants, puisque tous deux avaient conçu un étrange endroit, où étaient conduites – en imagination – de retorses épreuves censées éprouver les sentiments des gens. Dès lors, le narrateur va imaginer, en hommage à Fiona, un livre, Le Livre des Epreuves, qui s'adresse à la fois au fantôme de Fiona et à tous ceux qui ont laissé un proche en finir avec la vie, afin de tester leur résistance au malheur, leur aptitude à la survie. Magnifique anti-manuel de suicide, le livre présente au lecteur, son principal allié, diverses situations, souvent incongrues, toujours pertinentes, et profondément poétiques, où il faut choisir, prendre position.
Livre poignant jusqu'à la moelle, qui vous hante et vous soutient, La maison des épreuves nage à contre-courant des pulsions mortifères jusqu'au cœur même de la volonté de vivre. Oscillant au bord du vide, face au désastre de soi, le lecteur se voit convié à un jeu de piste mental qui ne souffre pas la feinte. Lire La Maison des épreuves, c'est entrer dans un labyrinthe, où seul compte le désir d'en ressortir moins seul, moins fautif, moins blessé. Une parabole? Une fable? Plus que cela: une expérience à laquelle il est impossible de se soustraire. (Et que j'inscris sans hésitation dans le top-ten des traductions qui m'ont le plus bouleversé.) (Ceci n'est pas un teaser, mais une sommation.)_____________A paraître en janvier aux éditions de l'Ogre…
Published on October 23, 2016 22:00
October 20, 2016
Cartonner n'est pas jouer
 Mon livre va cartonner. Ne voyez dans cette phrase aucun pronostic audacieux ni quelque vaine promesse. Non, il s'agit là purement d'un exemple. D'une utilisation du verbe "cartonner". On l'emploie encore assez souvent, sans avoir devant les yeux en permanence un cube marron clair à rabats où ranger des choses en vue d'un déménagement. Cartonner, au départ, ça veut juste dire "garnir de carton". Mais très vite, ce verbe assez ingrat et bas du front, comme tout verbe formé à partir d'une matière brute et vile, va connaître d'étranges tribulations sémantiques. Cartonner, au fil du temps, va signifier des choses très diverses : critiquer; posséder sexuellement; courir un danger; entrer en collision; jouer aux cartes… Ainsi, on pouvait il y a peu se faire cartonner par la critiquer – aujourd'hui, on dit éreinter.
Mon livre va cartonner. Ne voyez dans cette phrase aucun pronostic audacieux ni quelque vaine promesse. Non, il s'agit là purement d'un exemple. D'une utilisation du verbe "cartonner". On l'emploie encore assez souvent, sans avoir devant les yeux en permanence un cube marron clair à rabats où ranger des choses en vue d'un déménagement. Cartonner, au départ, ça veut juste dire "garnir de carton". Mais très vite, ce verbe assez ingrat et bas du front, comme tout verbe formé à partir d'une matière brute et vile, va connaître d'étranges tribulations sémantiques. Cartonner, au fil du temps, va signifier des choses très diverses : critiquer; posséder sexuellement; courir un danger; entrer en collision; jouer aux cartes… Ainsi, on pouvait il y a peu se faire cartonner par la critiquer – aujourd'hui, on dit éreinter. En fait, l'usage de cartonner au sens de décrocher le pompon est assez récent – et n'est pas sans lorgner également du côté forain. Imaginez un stand de tir dans une foire. Carabine à plomb en main, vous visez un petit carré de carton, cible de toutes vos espérances. Dans le mille? Bingo. Vous êtes en train de gagner. Et voilà notre "cartonner" qui devient synonyme de succès – et comme par hasard, ce sens apparaît dans les années 1980…
Que retenir de tout cela? Eh bien, que le succès est lié à une certaine conception de l'objectif à atteindre. Qu'il ne peut être atteint que si l'on a en tête une cible. Si vous voulez que votre livre se vende, imaginez votre lecteur avant, et mettez-lui du plomb dans l'aile, le bon plomb dans la bonne aile. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est ici assez loin du fameux "échouer mieux" de Beckett. Il faudrait d'ailleurs trouver un terme, un verbe qui soit le contraire de ce "cartonner" et qui puisse désigner l'écriture d'un livre dès lors qu'elle s'est affranchie de toute "visée".
Je propose: bredouiller. Une sorte de mix entre "rentrer bredouille" et "bégayer". Essayons pour voir. Eh, tu sais quoi? Mon livre va bredouiller. Oui. Je trouve que c'est mieux. Plus proche de la langue, de la langue bifide, saliveuse, patraque, fiévreuse, que du carton, dans lequel finira de toute façon le livre au bout de trois mois quand le libraire le retournera à l'éditeur.
Published on October 20, 2016 21:30
Stéphane Bouquet: la stupeur d'exister
 Parfois, on ne sait pas comment parler des livres, tant on a l'impression qu'ils parlent d'eux-mêmes, que la parole qui la hante et les traverse n'a pas besoin de nos scories verbales. J'ai lu Vie commune, de Stéphane Bouquet, comme tous ses précédents livres, à savoir: en proie à. En proie à quoi? Mais faut-il trouver un sujet à cette sujétion? On peut juste être "en proie à", puisque ici la poésie s'empare de, traite la, revient aux.
Parfois, on ne sait pas comment parler des livres, tant on a l'impression qu'ils parlent d'eux-mêmes, que la parole qui la hante et les traverse n'a pas besoin de nos scories verbales. J'ai lu Vie commune, de Stéphane Bouquet, comme tous ses précédents livres, à savoir: en proie à. En proie à quoi? Mais faut-il trouver un sujet à cette sujétion? On peut juste être "en proie à", puisque ici la poésie s'empare de, traite la, revient aux.Les textes de Bouquet exigent une forme d'abandon attentif très particulier. Une tristesse qui est aussi une joie dépassée s'y promène. Il y a l'un et le multiple, soi et les autres, son corps pour seule passerelle, mais aussi un rêve d'empathie, une frêle tentative de dialogue. Le livre s'ouvre par un poème intitulé "En guise d'excuse", et d'emblée Bouquet nous entraîne dans l'expérience du "rejet" – au sens formel, puisque son vers, quoique fluide, subit la contrainte du "retour à la ligne", comme si son dire excédait l'espace alloué. L'émotion, alors, naît de ce souffle étiré qui semble se contracter puis s'élance à nouveau, relance les dés, comme on croise et décroise les jambes pour signifier qu'on a envie de courir mais que, non, on va rester, là, et parler, tenter de parler. J'y sens l'influence d'une certaine poésie américaine, travaillant la métrique pour réinventer de nouveaux déplacements langagiers.
"l'original. De toute façonMais Vie commune comporte aussi ce vers: "Je déclare la solitude ouverte", phrase qu'il faut entendre dans toute sa prometteuse multiplicité. Et le fait est que, tout en étant agité de replis, d'écarts, Vie commune est aussi le livre des rencontres altérées, proche en cela, bien sûr, des pièces de Tchekhov. On s'y côtoie, et même si on y baise aussi, ce côtoiement s'efforce de jeter les fondations d'une sociabilité déchue. Oui, je sais, ce n'est pas très clair, dit comme ça. Ce qui est clair, en revanche, c'est cet au-delà du romantisme qui fait dire à Bouquet:
mes amis j'écris de moins en moins de poésie. J'ajoute juste
des mots à des jours
en espérant y trouver la raison de surpasser l'odeur intense
de solitude qui
me stagne sans arrêt sous les bras et puis re-salves
d'encouragement
des troubadours intérieurs: continue, continue d'entrelacer
ton vers à la seule vérité
qui soit et la stupeur d'exister."
"en sont restées là. C'est cela l'essentiel: se vautrer dans laSe vautrer dans la forme: parfois, on ne sait pas comment parler des livres, tant on a l'impression qu'ils parlent d'eux-mêmes, que la parole qui la hante et les traverse n'a pas besoin de nos scories verbales. Bouquet, dans ce livre composé de trois poèmes, une "pièce" et trois "portraits", parvient à chanter/traduire sans le moindre trémolo la rigueur d'exister, le besoin de désirer et l'attrait des circonstances. Regardez, tout est dit, ici:
forme
idéale ou provisoirement idéale. Bien sûr pendant ce temps,"
"de raison valable. Un jourLes plus beaux textes sont des méduses – et Bouquet le rappelle et le prouve une fois de plus.
les méduses à leur tour ont trouvé que leur forme
convenait aux circonstances."
___________Stéphane Bouquet, Vie commune, éd. Champ Vallon, 14 €
Published on October 20, 2016 12:42
October 18, 2016
Qu'y a-t-il hors du charnier natal ?
"Décidément, l'être est bouillie, bouillie tiède, il ne tient pas la route, un désastre l'habite et le trémousse qui l'empêche de coaguler. S'il durcit, il se fendille aussitôt, puis éclate, se répand, se disperse. Je n'ai quant à moi aucune envie de camper ad vitam et nauseam dans la tente de mon être, qui ferme mal, et par laquelle s'engouffre le vent – ah, le vent, qu'il soit du midi ou de la désolation, il s'engouffre, piaille – écoutez, il se rue dans la fragile quechua de l'ego, regardez, il en gifle les pans qui tremblent telles les parois d'une panse gavée de vide.
Quoi? Suis-je vide? Suis-je creux? Mais qui voudrait être plein, plein à craquer, de soi et des autres, d'humeurs et d'idées, ballonné d'autrui et d'espoirs à la manière d'une sainte en grès crevassé que visite sans cesse un nuage de touristes pestilentiels?
Je me suis toujours senti immensément troué, plus pertinent dans mes déchirures que dans mes coutures."
(Extrait de mon prochain livre, Hors du charnier natal ,à paraître aux éditions Inculte le 4 janvier 2017)
Published on October 18, 2016 08:26
October 13, 2016
Raymond Federman, une traduction à prendre ou à laisser
 A mes heures perdues (!), quand mes petits loisirs d'oisif nanti m'en laissent le temps, je traduis le roman de Raymond Federman, Take it or leave it, son dernier grand roman encore inédit en français, paru aux Etats-Unis en 1976. Tout Federman ayant été traduit jusqu'ici, à ma connaissance, grâce entre autres à l'obstination, Laure Limongi, et de quelques autres, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin, d'autant que ce texte-là est, comment dire? In-sa-tia-ble. Absolument insatiable.
A mes heures perdues (!), quand mes petits loisirs d'oisif nanti m'en laissent le temps, je traduis le roman de Raymond Federman, Take it or leave it, son dernier grand roman encore inédit en français, paru aux Etats-Unis en 1976. Tout Federman ayant été traduit jusqu'ici, à ma connaissance, grâce entre autres à l'obstination, Laure Limongi, et de quelques autres, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin, d'autant que ce texte-là est, comment dire? In-sa-tia-ble. Absolument insatiable.J'en ai traduit environ un quart, je crois, et à chaque fois que je m'y colle, c'est un plaisir pyrotechnique, une valse à mille trois cents temps, une folle partie de poker qui se joue avec des grenades à fragmentation, ça pense ça danse ça déconne ça bouleverse ça fonce, autant dire que c'est une fête iconoclaste d'une rare liberté. Federman voulait "écrire un livre pareil à un nuage qui change en avançant" et il a amplement réussi. Je lui avais promis de le traduire, et son âme qui repose en paix commence, je crois, à s'impatienter.
Le seul hic, c'est que je n'ai pas encore trouvé d'éditeur français pour cette traduction en cours… Si vous êtes éditeur, considérez donc ce post comme une petite annonce dans la plus pure tradition. C'est, littéralement, A prendre ou à laisser… Je recommence, cette fois-ci en mettant les formes:
TRADUCTEUR EXPÉRIMENTÉ, 54 ANS, BARBU, MARIÉ, QUATRE ENFANTS ET UNE CHATTE RÉPONDANT AU DOUX NOM DE SALAM,VIVANT À PARIS ET EN HAUTE-MARNE, AIMANT LA BONNE CHÈRE,LES LIVRES, LES SPORTS DE COMBAT(MAIS VUS DE TRES LOIN),LE PING-PONG ET LE BIBLOQUETCHERCHE ÉDITEUR SÉRIEUX, CENT ANS MAXI,FRAIS, DISPOS ET CONSENTANT,AYANT DÉJÀ PUBLIÉ DES LIVRES (OÙ ON S'EN FOUT DE L'HISTOIRE),AIMANT LE SAUT EN PARACHUTE ET LES DIGRESSIONS,DÉSIREUX DE PUBLIER SA TRADUCTIONDU ROMAN DE RAYMOND FEDERMAN, TAKE IT OR LEAVE IT. TARIF CORRECT. SEULE CONDITION REQUISE:ETRE UN PEU FOU.N'HÉSITEZ PAS ME CONTACTER ENTRE 5H30 DU MATIN ET 23H59.
Published on October 13, 2016 21:30
L'incroyable vérité sur l'affaire du prix Dylan de littérature attribué à Bob Nobel (sic)
 L'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan a provoqué pas mal de remous hou hou. Un peu partout, dans la presse et sur les réseaux, chacun y est allé de son admiration ou de son indignation. Les éditeurs font la gueule: rien à vendre, ou si peu. Les journalistes se réjouissent: rien à lire mais une putain de polémique. Ça et là, des questionnements incroyables: qu'est-ce que la littérature? L'oral, l'écrit, des paroles des paroles. Certaines pensées, quasi nécrologiques, vont aux autres favoris, qui, moins doués en guitare, ont pourtant une œuvre-papier conséquente à leur actif. Plusieurs se réjouissent de ce choix, qui hissent la chanson au rang d'œuvre et rappellent que Homère était bassiste. On nous dit que Brassens l'aurait mérité. Que Dylan est Rimbaud.2.0. D'aucuns, moins posthumes, ont une pensée émue pour Leonard Cohen. Et puis, de toute façon, Pynchon ne serait pas venu le chercher, ce prix de 800 000 euros et des poussières de lauriers. Rushdie, bon prince, se réjouit du résultat des courses. Joyce Carol Oates aussi, à sa façon. Coup de com? Nostalgie? Peu importe. On en parle.
L'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan a provoqué pas mal de remous hou hou. Un peu partout, dans la presse et sur les réseaux, chacun y est allé de son admiration ou de son indignation. Les éditeurs font la gueule: rien à vendre, ou si peu. Les journalistes se réjouissent: rien à lire mais une putain de polémique. Ça et là, des questionnements incroyables: qu'est-ce que la littérature? L'oral, l'écrit, des paroles des paroles. Certaines pensées, quasi nécrologiques, vont aux autres favoris, qui, moins doués en guitare, ont pourtant une œuvre-papier conséquente à leur actif. Plusieurs se réjouissent de ce choix, qui hissent la chanson au rang d'œuvre et rappellent que Homère était bassiste. On nous dit que Brassens l'aurait mérité. Que Dylan est Rimbaud.2.0. D'aucuns, moins posthumes, ont une pensée émue pour Leonard Cohen. Et puis, de toute façon, Pynchon ne serait pas venu le chercher, ce prix de 800 000 euros et des poussières de lauriers. Rushdie, bon prince, se réjouit du résultat des courses. Joyce Carol Oates aussi, à sa façon. Coup de com? Nostalgie? Peu importe. On en parle. L'important, c'est que, Dylan or not Dylan, un lecteur, un jour, se réveille, regarde autour de lui et se dise, en se frottant les yeux, que les honneurs, aussi dotés, aussi éclairés, aussi embrumés, aussi manipulés, aussi lucides, aussi provocateurs, aussi surprenants, aussi décalés, aussi révolutionnaires, aussi saucissons soient-ils, ne sont que des couronnes mortuaires collées à coup de bienveillant merlin sur les fronts conséquemment bovins des humbles prétendants à la vanité tarifée. "Les honneurs déshonorent", écrivait Flaubert. Qui brigue la couronne lèche le trône. Ô lévrier, tu as battu le lapin.
Bien sûr, on aurait été content (pour eux, leur famille, leur compte en banque) que Oates ou Rushdie ou De Lillo, puisque les rumeurs butinaient du côté américain, l'aient, cette récompense. Mais qu'apporte-t-elle, au final, cette douteuse doudoune d'or, hormis du grain-grain d'encre à moudre par la prudente presse ou de quoi rassurer les hiniques héritiers?
(Nota bene; Dylan a été plus entendu (écouté? diffusé?) par la terre entière que tous les écrivains réunis dans la liste d'attente de ce fumeux Nobel – il est apparemment plus populaire qu'un de ses prédécesseurs, Tomas Tranströmer – "Un beuglement toutes les deux minutes. Les yeux lisaient droit dans l’invisible." Ce Nobel ne lui vaudra guère de nouveaux lecteurs/auditeurs, on s'en doute. Claude Simon, du fond de sa terre, le suppute aisément.)
De grâce, n'usez pas vos crocs inutilement sur le Dylanobel. La saison des prix littéraires ne fait que commencer en France. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises-Kinder. Sachez juste que les plus beaux livres qui paraissent actuellement en France, la presse n'en parlera pas, presque pas. Ils sont publiés par des discrets éditeurs, des ninjas, des poètes. Vous ne verrez que l'iceberg à paillettes qu'ont concocté pour vous les éditeurs les plus en vue, les attachés de presse les plus pugnaces, les journalistes les plus au fait des enjeux, les diffuseurs les plus efficaces, les présentateurs télé les mieux coiffés. Hormis votre menacé libraire ou un proche audacieux, personne ne vous indiquera où les dés sont vraiment lancés. Il vous faudra errer dans les rayons, renifler, tâter, compulser, hésiter, hésiter encore, hésiter mieux – fuir les bandeaux rouges.
On vous aura prévenu: l'inestimable n'a pas de prix.
Published on October 13, 2016 11:08
October 12, 2016
Le palais des peines perdues: "Témoin", de Sophie G. Lucas
 Bon, aujourd'hui, c'est le Nobel côté lettres. On va donc plutôt vous parler de choses sérieuses. Du poète américain objectiviste Charles Reznikoff, par exemple, et de son impressionnant Témoignage, où il travaille à partir de "rapports d'audience de tribunaux amenés à juger aussi bien de conflits de voisinage ou de succession que d'accidents du travail ou de faits divers atroces" – et ce pour bâtir une chorale du désastre avec des matériaux bruts. Ou plutôt non, parlons d'un livre qui lui rend hommage à sa façon, puisque l'auteur a voulu perpétuer l'approche de Reznikoff et a "suivi des procès en correctionnelle au Tribunal de Grande Instance de Nantes de septembre 2013 à janvier 2014". Ainsi est né Témoin, de Sophie G. Lucas, que publient ces jours-ci les éditions de la contre-allée.
Bon, aujourd'hui, c'est le Nobel côté lettres. On va donc plutôt vous parler de choses sérieuses. Du poète américain objectiviste Charles Reznikoff, par exemple, et de son impressionnant Témoignage, où il travaille à partir de "rapports d'audience de tribunaux amenés à juger aussi bien de conflits de voisinage ou de succession que d'accidents du travail ou de faits divers atroces" – et ce pour bâtir une chorale du désastre avec des matériaux bruts. Ou plutôt non, parlons d'un livre qui lui rend hommage à sa façon, puisque l'auteur a voulu perpétuer l'approche de Reznikoff et a "suivi des procès en correctionnelle au Tribunal de Grande Instance de Nantes de septembre 2013 à janvier 2014". Ainsi est né Témoin, de Sophie G. Lucas, que publient ces jours-ci les éditions de la contre-allée.Retranscrire est une chose. Scander en est une autre. Ici, les propos retenus/détenus – que ce soit ceux de l'accusé, de la victime, du juge, des témoins… – ont subi une sorte de catalyse, et les voilà ré-agencés au gré d'un récitatif qui souligne leur âpreté tout en laissant voir l'os, un récitatif où ce qui est dit est ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ne peut changer – hors jugement, donc. L'auteur-témoin devenu greffier, entre autres détails, de l'insaisissable. Travail de précision, où les voix luttent contre leur propre souffle, où l'aveu et le déni, les faits et les absences, la colère et l'abandon ne cessent d'échanger leurs intensités:
"Il est sec et mince. Petit. Ramassé. Il y a lui. Il y a sa femme. Il n'y a pas la fille. Il a abusé de sa fille. Elle avait sept ans. Aujourd'hui elle est majeure. Il est tremblant à la barre. Un an avec sursis. Il repart avec sa femme. Elle lui porte sa veste. Sa femme. Elle a ce geste. La mère de la fille. Elle a un geste. Pour. Lui. Ils sont ensemble. Le père et la mère. La mère et le père. Ils traversent le tribunal. Ils sont serrés l'un contre l'autre. Le père. La mère."Au fil des pages, par brefs blocs, des destins pris dans le cadre judiciaire, l'alcool, le vol, la récidive, les excuses, les justifications, l'impuissance, la tristesse, la rage, le besoin, des hommes pour la plupart, bien sûr, violences, abus, disputes… La phrase souvent réduite au mot, à la force et la fébrilité du mot venu cacher la forêt des pulsions. Ici, on "parle avec [ses] nerfs", ça "dérape", on "n'est plus cet homme-là" et "peut-être c'est bien de m'arrêter".
Mais entre ces quarante-sept moments de vie au bord de la bascule, Sophie G. Lucas tisse un autre fil, expose une autre histoire, celle de son père, ou plutôt l'histoire lacunaire de ses liens avec un père absent, mort puis vivant, menant plusieurs vies, semant ici et là les enfants comme des petits poucets négligeables, un père qui "n'est pas quelqu'un de bien", qui "était plusieurs personnes". En le convoquant au tribunal des souvenirs et témoignages, l'auteur accomplit un geste fort, intime, violent. Il fallait que s'avance une foule en désastre, fracturée, pour que puisse se préciser, entre deux témoignages, la silhouette insaisissable du père:
"Il m'arrive de ne voir dans le box que des enfants perdus. Je voudrais croire qu'ils ne sont que des enfants perdus. Même ceux qui sont censé être des hommes. Certains n'ont connu que la prison ou les institutions depuis l'adolescence. Mon père a été enfermé dans une maison de correction. L'Abbaye de Fontevrault."En moins de cent pages, à l'économie et au ciseau, Sophie G. Lucas s'attaque, littéralement, au vif du sujet, à ce qui fait, qu'à vif, il chute, et chute encore, laissant des mots, après l'écho des coups, comme ce père impossible, "homme nombreux", pénombreux, auquel elle consacre dix-huit chapitres intitulés "La longue peine" – rendant au mot de "peine" son sens fort, son sens poignant.
_________Sophie G. Lucas, Témoin, éditions de la contre-allée (collection la sentinelle), 12 €
Published on October 12, 2016 23:20
October 11, 2016
Béziers, expert es-hontes
 Grâce à Robert Ménard, qui n'est pas fasciste sinon ça se saurait, une affiche au message on ne peut plus clair vient de fleurir dans les rues de Béziers, dont la facture, graphiquement pauvre, nous laisse à penser que, depuis la France de Vichy, les xénophobes publicistes sont à la ramasse. Mais le message est direct: "Ils arrivent". Ce "ils", qu'élucide assez vite le sous-titre "les migrants", est censé réveiller en l'habitant de Beziers la panique idoine en cas d'invasion extra-terrestre, apparemment. Pas lui annoncer qu'il aura l'occasion d'exercer cette fameuse hospitalité française. "Ils". Ça veut dire: l'autre. Pourquoi pas "demain les chiens", tant qu'on y est? Et ce "Ça y est" ! Le contraire haineux du fameux "A ça ira, ça ira"… On admirera au passage la nature en apparence purement informative, qui pourrait presque faire penser que le maire de Béziers annonce l'arrivée de joyeux forains auxquels il convient de réserver un bel accueil. L'humour de droite, quoi. Histoire que la chose reste légale. Vous remarquerez que sur l'affiche les "ils" sont de dos ou de profils, ils sont devant nous. On peut donc encore agir. On comprend le message: c'est à nous de leur tourner le dos. Ou de les pousser ailleurs.
Grâce à Robert Ménard, qui n'est pas fasciste sinon ça se saurait, une affiche au message on ne peut plus clair vient de fleurir dans les rues de Béziers, dont la facture, graphiquement pauvre, nous laisse à penser que, depuis la France de Vichy, les xénophobes publicistes sont à la ramasse. Mais le message est direct: "Ils arrivent". Ce "ils", qu'élucide assez vite le sous-titre "les migrants", est censé réveiller en l'habitant de Beziers la panique idoine en cas d'invasion extra-terrestre, apparemment. Pas lui annoncer qu'il aura l'occasion d'exercer cette fameuse hospitalité française. "Ils". Ça veut dire: l'autre. Pourquoi pas "demain les chiens", tant qu'on y est? Et ce "Ça y est" ! Le contraire haineux du fameux "A ça ira, ça ira"… On admirera au passage la nature en apparence purement informative, qui pourrait presque faire penser que le maire de Béziers annonce l'arrivée de joyeux forains auxquels il convient de réserver un bel accueil. L'humour de droite, quoi. Histoire que la chose reste légale. Vous remarquerez que sur l'affiche les "ils" sont de dos ou de profils, ils sont devant nous. On peut donc encore agir. On comprend le message: c'est à nous de leur tourner le dos. Ou de les pousser ailleurs.Voici une des nombreuses réponses graphiques qu'on peut trouver actuellement sur les réseaux sociaux:

Reste à voir si la population de Beziers laissera longtemps l'affiche honteuse conçue par Ménard en l'état. C'est un bon test, il me semble. Si elle n'est pas conchiée ou fracassé intégralement et partout dans la semaine qui suit, alors les autres villes sauront qu'elles peuvent aller plus loin dans la surenchère xénophobe, et pas seulement d'un point de vue graphique.
Il est temps de chanter, je crois: "Si j'avais un marteau…"
Published on October 11, 2016 13:32
Christophe Claro's Blog
- Christophe Claro's profile
- 12 followers
Christophe Claro isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.




