Christophe Claro's Blog, page 23
August 23, 2022
Musée Marilyn, Jour 1
August 13, 2022
Du bon usage du rétablissement, et de la vie sauve de Rushdie
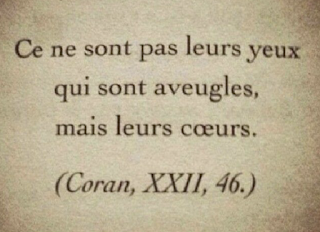 A Salman Rushdie, dont j’ai eu la chance et l’honneur de traduire deux livres, Furie et Shalimar le Clown, je souhaite un prompt rétablissement. Son écriture gourmande, généreuse, est de celles qui vitalisent et réjouissent. Cet homme a traversé l’enfer pendant des années et se rétablir a été sans nul doute une de ses permanentes préoccupations : se rétablir dans l’espace littéraire, dans la vie intime, la vie publique. A Hadi Matar, je souhaite également un prompt rétablissement. D’abord, dans la raison, qui aurait dû lui apprendre la distance qui sépare une idée aberrante, conditionnée par des dogmatiques, d’un geste violent. Dans la foi, ensuite, s’il estime en avoir une digne de son geste hideux, car il s'est renversé par son geste, jusqu'à se nier à son insu aux yeux de son dieu. On ne sait rien pour l’instant de ses intentions, mais qu’il sache que son geste les a rendu caduques : il peut frapper l’homme, pas les livres. Au contraire d’un arbre, qui ne donnera plus si on l’abat, l’écrivain est tout entier épars dans ses livres, abattez-le, poignardez-le, vous n’empêcherez pas ses fruits de, tout simplement, être. La fatwa lancée contre Rushdie concerne également ses traducteurs et ses éditeurs. Certains d’entre eux ont été assassinés, blessés, menacés. Mais surtout, avons-nous envie de dire, tous ceux et celles qui le lisent devraient se sentir concernés par la fatwa, qui ne vient pas d’un dieu mais d’un mufti, se disant « interprète » de la loi musulmane. Nous autres, traducteurs et traductrices, qui savons plus ou moins ce que signifient « interpréter », nous sommes déterminés à être plus Rushdie que muftis. Dont acte. Dont parole, aussi.
A Salman Rushdie, dont j’ai eu la chance et l’honneur de traduire deux livres, Furie et Shalimar le Clown, je souhaite un prompt rétablissement. Son écriture gourmande, généreuse, est de celles qui vitalisent et réjouissent. Cet homme a traversé l’enfer pendant des années et se rétablir a été sans nul doute une de ses permanentes préoccupations : se rétablir dans l’espace littéraire, dans la vie intime, la vie publique. A Hadi Matar, je souhaite également un prompt rétablissement. D’abord, dans la raison, qui aurait dû lui apprendre la distance qui sépare une idée aberrante, conditionnée par des dogmatiques, d’un geste violent. Dans la foi, ensuite, s’il estime en avoir une digne de son geste hideux, car il s'est renversé par son geste, jusqu'à se nier à son insu aux yeux de son dieu. On ne sait rien pour l’instant de ses intentions, mais qu’il sache que son geste les a rendu caduques : il peut frapper l’homme, pas les livres. Au contraire d’un arbre, qui ne donnera plus si on l’abat, l’écrivain est tout entier épars dans ses livres, abattez-le, poignardez-le, vous n’empêcherez pas ses fruits de, tout simplement, être. La fatwa lancée contre Rushdie concerne également ses traducteurs et ses éditeurs. Certains d’entre eux ont été assassinés, blessés, menacés. Mais surtout, avons-nous envie de dire, tous ceux et celles qui le lisent devraient se sentir concernés par la fatwa, qui ne vient pas d’un dieu mais d’un mufti, se disant « interprète » de la loi musulmane. Nous autres, traducteurs et traductrices, qui savons plus ou moins ce que signifient « interpréter », nous sommes déterminés à être plus Rushdie que muftis. Dont acte. Dont parole, aussi.
August 9, 2022
Avec le temps va
 Si j’allais dans le temps, si dans le temps je savais aller, m’en aller, dans le passé je glisserais, me coulerais, en divers points et croisées du temps, dans tous les ici et les là qui forment cette constellation d’impossibles étoiles à partir de laquelle feindre de lire le passé. A partir de laquelle le relier à d’autres passés. Dans le passé lointain, le passé écarté, celui qui ne me comprend ni ne me voit pas. Dans le passé invinciblement dépassé où jamais je n’ai marché du vivant de ma vie, j’irais d’un pas égal, sans attirer l’attention, afin que les futurs morts ne sentent jamais sur moi l’odeur de l’autre temps, mon relent de présent différent. Un pas devant l’autre, comme on marche dans la rue, j’irais, dans le temps doux et figé d’autrefois, la longue rue du fini. J’irais chargé, de choses, dans mes grandes poches ou dans un sac. Je les déposerais, ces choses, les laisserais aussi bien ici que là, des choses de mon temps à venir. Dans le passé des gens pour qui mourir n’est qu’avenir, guère plus, je laisserai ces choses du temps autre, en espérant qu’un jour elles passent à l’attaque, et se prennent d’amour pour ceux et celles qui, par hasard ou curiosité, les découvriraient. Je me vois poser une lampe électrique sur la table de nuit d’un meunier de mille huit cent vingt, et dans la besace du voleur de onze cent trente glisser un téléphone portable, dans la caisse à jouets de la fillette d’un comte de mille six cent trente enfouir un réveille-matin, sur une pierre dans la grotte du chasseur néanderthalien un sachet de cocaïne, dans la bibliothèque d’un lettré du temps de Marignan (1515) un roman de gare ou de Flaubert. Si j’allais et venais dans le temps, je ferais d reviendrais dans mon clair présent et j’attendrais. J’attendrais qu’il se passe quelque chose qui atteste que ces gestes par moi accomplis n’ont pas été vains, pas anodins. Je serais patient. Je serais impatient. J’attendrais d’entendre la musique des morts, des morts imperceptiblement contrariés.
Si j’allais dans le temps, si dans le temps je savais aller, m’en aller, dans le passé je glisserais, me coulerais, en divers points et croisées du temps, dans tous les ici et les là qui forment cette constellation d’impossibles étoiles à partir de laquelle feindre de lire le passé. A partir de laquelle le relier à d’autres passés. Dans le passé lointain, le passé écarté, celui qui ne me comprend ni ne me voit pas. Dans le passé invinciblement dépassé où jamais je n’ai marché du vivant de ma vie, j’irais d’un pas égal, sans attirer l’attention, afin que les futurs morts ne sentent jamais sur moi l’odeur de l’autre temps, mon relent de présent différent. Un pas devant l’autre, comme on marche dans la rue, j’irais, dans le temps doux et figé d’autrefois, la longue rue du fini. J’irais chargé, de choses, dans mes grandes poches ou dans un sac. Je les déposerais, ces choses, les laisserais aussi bien ici que là, des choses de mon temps à venir. Dans le passé des gens pour qui mourir n’est qu’avenir, guère plus, je laisserai ces choses du temps autre, en espérant qu’un jour elles passent à l’attaque, et se prennent d’amour pour ceux et celles qui, par hasard ou curiosité, les découvriraient. Je me vois poser une lampe électrique sur la table de nuit d’un meunier de mille huit cent vingt, et dans la besace du voleur de onze cent trente glisser un téléphone portable, dans la caisse à jouets de la fillette d’un comte de mille six cent trente enfouir un réveille-matin, sur une pierre dans la grotte du chasseur néanderthalien un sachet de cocaïne, dans la bibliothèque d’un lettré du temps de Marignan (1515) un roman de gare ou de Flaubert. Si j’allais et venais dans le temps, je ferais d reviendrais dans mon clair présent et j’attendrais. J’attendrais qu’il se passe quelque chose qui atteste que ces gestes par moi accomplis n’ont pas été vains, pas anodins. Je serais patient. Je serais impatient. J’attendrais d’entendre la musique des morts, des morts imperceptiblement contrariés.
August 6, 2022
Graciano, ou la lente violence
July 28, 2022
Malheureusement, il reste la langue (1)
 "Ce n'est pas à son vers plus ou moins long qu'on flaire le poète ou qu'on le reconnaît. C'est à la façon – forcément seule – dont la page qu'il a salie sue du vrai ou pas. C'est une odeur qui ne trompe pas." — Cédric Demangeot Que s’est-il passé pour que la notion de style, ou d’écriture – chacun y apportera son distinguo – soit devenue, sinon obscène, du moins déplacée, sous l’effet d’une pression censément honorable, celle du réel, ou du moins d’un pseudo-réalisme, lui-même garant d’un ancrage dans le social (voire le sociétal) ? Dit plus simplement, que s’est-il passé pour qu’on estime que l’actuel, afin d’être restitué, devait l’être « simplement », c’est-à-dire sans recourir à ce qu’on estime être des « artifices » ? Même Aragon, délaissant le surréalisme pour chanter l’élan communiste, n’avait pas renoncé à la scansion. Et il n’est pas certain que Lautréamont n’ait rien dit de son époque dans ses chants. Certes, l’époque subit d’opportunes mutations, des voix se délient, des crimes autrefois institutionnalisés et des abus naguère tolérés sont désormais mis à jour et à l’index. Mais ce n’est pas parce que les combats d’aujourd’hui sont très clairement désignés que la langue, qui est souvent le premier relais de leur persistance, se doit de les projeter et les décliner sur la page. Je ne dis pas – cela va de soi – qu’elle doit les taire, loin de là, mais elle ne doit pas perdre de vue que sa seule façon de faire résistance est le détour, et non la fronde ou le calque. Si la littérature se met à tout simplement dire et répéter, quelle que soit la noblesse des causes qu’elle met en avant, elle n’est que perroquet, et rate sa cible en ne visant qu’elle. Dénoncer ne veut pas dire accuser, de même que cerner ne veut pas dire désigner. Dès qu’on assigne à la littérature le devoir de traiter des thèmes – l’inceste, l’inégalité, le machisme, l’injustice –, on fait de ces thèmes des épouvantails et de la littérature une tribune. Un livre n’est pas un podium où défilent les girouettes de l’indignation. Ecrire n’est pas dire, aussi intense que soit le désir de dire. Il ne s’agit pas non plus de troubler ses eaux pour les faire paraître plus profondes, mais d’opérer une ligne de partage entre le thème et son traitement. Si le traitement est décalqué du thème, il n’en est que son ombre et se livre alors à une opération de pure redondance. Ecrire consiste précisément à brouiller, défaire, laisser s’ébattre les zones d’ombre, jouer des ambiguïtés, afin d’éviter un moralisme préfabriqué – ce qui ne veut pas dire attiser des feux douteux ni prêcher un faux boiteux. Un écrivain n’a ni droit ni devoir – son affaire n’est pas républicaine. En revanche, s’il n’est pas capable de penser une forme, de l’inventer ou de la décaler, de la briser ou de la moquer, qu’a-t-il besoin d’écrire ? Le vieux débat de la forme et du fond est une arnaque forgée à peu de frais : c’est par la forme que l’écrivain peut accéder à un fond qui lui-même n’est qu’un agrégat de formes. Nous sommes des monstres de langage. Les fondements mêmes de nos sociétés sont des golems de langage. Nous ne savons que parler et par la parole tuer, asservir, condamner, exiler, nier, moquer, louer, duper, etc. L’écriture, telle que l’écrivain la prend à sa base, pue et pas qu’un peu, et c’est avec cette puanteur qu’il doit, non pas diffuser des odeurs de rose ou dissiper des relents de fumier, mais travailler, juste travailler la forme de cette puanteur. J’ai l’air de dire ce qu’il faut et ne faut pas, mais en vérité je ne sais pas. J’erre, comme plus d’un, dans le marécage de l’écriture, son bouseux dédale. Rien n’est simple, hors l’obscène. Mais cessons de louer tel ou tel livre parce qu’il « aborde », « traite », « « prend à bras le corps », « offre un panorama », « lève des lièvres », « dénonce », etc. L’arc qu’il faut bander, la flèche qu’il faut pointer : que sa corde soit notre propre nerf, que son empan soit un morceau d’os de notre corps. Quant à la cible, cessons d’en voir partout. Ou plutôt voyons-les partout, en nous, tels ces coquillages accrétés sur le mollusque de notre conscience (oui, je sais, cette image est ridicule, mais sans ridicule la littérature deviendrait procès-verbal). Qui se met à sa table d’écriture avec des intentions, des moulins à abattre, des causes à défendre, des sujets à débattre, risque de rater l’enjeu majeur, celui de sa propre langue qui lui vient de ses parents, de ses maîtres, des publicités des mots d’ordre des œuvres qui l’ont autant informé que déformé. J’utilise l’arme même qui me vise. Je préfère le savoir. Je n’ai rien à dire et tout à écrire. Tout, c’est-à-dire fort peu, l’inutile sismographie de mes perceptions, la vaine dérégulation de mes pensées, le fort peu pertinent rebond de mes intuitions. Mais à cette sismographie, à cette régulation, à ce rebond, je veux pouvoir opposer une forme – une force étayée par autant de faiblesse qu’il faudra –, une « façon », qui me permette de comprendre les arcanes de tout façonnage. Je ne peux, ne sais rien appréhender sans appréhension. L’arme même que j’utilise me vise.
"Ce n'est pas à son vers plus ou moins long qu'on flaire le poète ou qu'on le reconnaît. C'est à la façon – forcément seule – dont la page qu'il a salie sue du vrai ou pas. C'est une odeur qui ne trompe pas." — Cédric Demangeot Que s’est-il passé pour que la notion de style, ou d’écriture – chacun y apportera son distinguo – soit devenue, sinon obscène, du moins déplacée, sous l’effet d’une pression censément honorable, celle du réel, ou du moins d’un pseudo-réalisme, lui-même garant d’un ancrage dans le social (voire le sociétal) ? Dit plus simplement, que s’est-il passé pour qu’on estime que l’actuel, afin d’être restitué, devait l’être « simplement », c’est-à-dire sans recourir à ce qu’on estime être des « artifices » ? Même Aragon, délaissant le surréalisme pour chanter l’élan communiste, n’avait pas renoncé à la scansion. Et il n’est pas certain que Lautréamont n’ait rien dit de son époque dans ses chants. Certes, l’époque subit d’opportunes mutations, des voix se délient, des crimes autrefois institutionnalisés et des abus naguère tolérés sont désormais mis à jour et à l’index. Mais ce n’est pas parce que les combats d’aujourd’hui sont très clairement désignés que la langue, qui est souvent le premier relais de leur persistance, se doit de les projeter et les décliner sur la page. Je ne dis pas – cela va de soi – qu’elle doit les taire, loin de là, mais elle ne doit pas perdre de vue que sa seule façon de faire résistance est le détour, et non la fronde ou le calque. Si la littérature se met à tout simplement dire et répéter, quelle que soit la noblesse des causes qu’elle met en avant, elle n’est que perroquet, et rate sa cible en ne visant qu’elle. Dénoncer ne veut pas dire accuser, de même que cerner ne veut pas dire désigner. Dès qu’on assigne à la littérature le devoir de traiter des thèmes – l’inceste, l’inégalité, le machisme, l’injustice –, on fait de ces thèmes des épouvantails et de la littérature une tribune. Un livre n’est pas un podium où défilent les girouettes de l’indignation. Ecrire n’est pas dire, aussi intense que soit le désir de dire. Il ne s’agit pas non plus de troubler ses eaux pour les faire paraître plus profondes, mais d’opérer une ligne de partage entre le thème et son traitement. Si le traitement est décalqué du thème, il n’en est que son ombre et se livre alors à une opération de pure redondance. Ecrire consiste précisément à brouiller, défaire, laisser s’ébattre les zones d’ombre, jouer des ambiguïtés, afin d’éviter un moralisme préfabriqué – ce qui ne veut pas dire attiser des feux douteux ni prêcher un faux boiteux. Un écrivain n’a ni droit ni devoir – son affaire n’est pas républicaine. En revanche, s’il n’est pas capable de penser une forme, de l’inventer ou de la décaler, de la briser ou de la moquer, qu’a-t-il besoin d’écrire ? Le vieux débat de la forme et du fond est une arnaque forgée à peu de frais : c’est par la forme que l’écrivain peut accéder à un fond qui lui-même n’est qu’un agrégat de formes. Nous sommes des monstres de langage. Les fondements mêmes de nos sociétés sont des golems de langage. Nous ne savons que parler et par la parole tuer, asservir, condamner, exiler, nier, moquer, louer, duper, etc. L’écriture, telle que l’écrivain la prend à sa base, pue et pas qu’un peu, et c’est avec cette puanteur qu’il doit, non pas diffuser des odeurs de rose ou dissiper des relents de fumier, mais travailler, juste travailler la forme de cette puanteur. J’ai l’air de dire ce qu’il faut et ne faut pas, mais en vérité je ne sais pas. J’erre, comme plus d’un, dans le marécage de l’écriture, son bouseux dédale. Rien n’est simple, hors l’obscène. Mais cessons de louer tel ou tel livre parce qu’il « aborde », « traite », « « prend à bras le corps », « offre un panorama », « lève des lièvres », « dénonce », etc. L’arc qu’il faut bander, la flèche qu’il faut pointer : que sa corde soit notre propre nerf, que son empan soit un morceau d’os de notre corps. Quant à la cible, cessons d’en voir partout. Ou plutôt voyons-les partout, en nous, tels ces coquillages accrétés sur le mollusque de notre conscience (oui, je sais, cette image est ridicule, mais sans ridicule la littérature deviendrait procès-verbal). Qui se met à sa table d’écriture avec des intentions, des moulins à abattre, des causes à défendre, des sujets à débattre, risque de rater l’enjeu majeur, celui de sa propre langue qui lui vient de ses parents, de ses maîtres, des publicités des mots d’ordre des œuvres qui l’ont autant informé que déformé. J’utilise l’arme même qui me vise. Je préfère le savoir. Je n’ai rien à dire et tout à écrire. Tout, c’est-à-dire fort peu, l’inutile sismographie de mes perceptions, la vaine dérégulation de mes pensées, le fort peu pertinent rebond de mes intuitions. Mais à cette sismographie, à cette régulation, à ce rebond, je veux pouvoir opposer une forme – une force étayée par autant de faiblesse qu’il faudra –, une « façon », qui me permette de comprendre les arcanes de tout façonnage. Je ne peux, ne sais rien appréhender sans appréhension. L’arme même que j’utilise me vise.
July 19, 2022
Tristan Mertens: l'instinct des ricochets
 Sans les éditions isabelle sauvage, il manquerait certainement quelque chose à la poésie contemporaine. Et la collection ‘présent (im)parfait’ est gage d’intenses rencontres. C’est le cas avec ce premier recueil de Tristan Mertens, intitulé lieu l’autre, un recueil dont la langue, parce que discrètement « déboitée » – suite à l’erre d’un je dans les plis d’une nature dont le secret peut-être est perdu – conserve une fluidité blessée. Les séquences sont brèves à la façon d’un souffle inquiet, soucieux de se ménager, le verbe tentant parfois de s’allier des évanescences (« je marche ma disparition), mais toujours pour revenir à quelque chose de carné (« moderne / au même crâne même / feu »), et parfois la phrase s’arrête, comme méfiante de tout élan (« la mer comme on quitte la mer / comme on //// retourne dans le papier »), préférant marquer un blanc (un hiatus ?) avant de resurgir autre, riche de cette apnée. Des poèmes de Tristan Mertens se dégage une sensation double : celle d’une voix venue poser des pierres grâces auxquelles traverser des gués de langue, celle d’une cadence ne voulant pas renoncer aux silences, aux brisures. Quand l’intime s’avance, c’est pétri d’une volonté de partage : Aujourd’hui tu reviens J’ai rangé sans trop savoir mes maladies mes amitiés mourantes le frein carnivore qui me consomme patiemment sans trop savoir pourquoi j’ai vu dans mon ventre tes ongles tes cheveux blancs ton sang profond la tristesse de préserver son cœur vu des idées des idées mauvaises des idées de moi – je veux te voir emporter tout Les vers font cascade, partagés entre désir d’absence (le mot « retiration », pris au vocabulaire de l’imprimerie, devient ici comme le pendant païen d’une dormition) et celui de vivre un ‘ensemble’ (« viens par moi derrière les lèvres / puiser ce qu’écarte le jour »). Une trajectoire, en cinquante pages, allant de l’ombre à peut-être la lumière. ___________________ Tristan Mertens, lieu l’autre, éditions isabelle sauvage, 14 €
Sans les éditions isabelle sauvage, il manquerait certainement quelque chose à la poésie contemporaine. Et la collection ‘présent (im)parfait’ est gage d’intenses rencontres. C’est le cas avec ce premier recueil de Tristan Mertens, intitulé lieu l’autre, un recueil dont la langue, parce que discrètement « déboitée » – suite à l’erre d’un je dans les plis d’une nature dont le secret peut-être est perdu – conserve une fluidité blessée. Les séquences sont brèves à la façon d’un souffle inquiet, soucieux de se ménager, le verbe tentant parfois de s’allier des évanescences (« je marche ma disparition), mais toujours pour revenir à quelque chose de carné (« moderne / au même crâne même / feu »), et parfois la phrase s’arrête, comme méfiante de tout élan (« la mer comme on quitte la mer / comme on //// retourne dans le papier »), préférant marquer un blanc (un hiatus ?) avant de resurgir autre, riche de cette apnée. Des poèmes de Tristan Mertens se dégage une sensation double : celle d’une voix venue poser des pierres grâces auxquelles traverser des gués de langue, celle d’une cadence ne voulant pas renoncer aux silences, aux brisures. Quand l’intime s’avance, c’est pétri d’une volonté de partage : Aujourd’hui tu reviens J’ai rangé sans trop savoir mes maladies mes amitiés mourantes le frein carnivore qui me consomme patiemment sans trop savoir pourquoi j’ai vu dans mon ventre tes ongles tes cheveux blancs ton sang profond la tristesse de préserver son cœur vu des idées des idées mauvaises des idées de moi – je veux te voir emporter tout Les vers font cascade, partagés entre désir d’absence (le mot « retiration », pris au vocabulaire de l’imprimerie, devient ici comme le pendant païen d’une dormition) et celui de vivre un ‘ensemble’ (« viens par moi derrière les lèvres / puiser ce qu’écarte le jour »). Une trajectoire, en cinquante pages, allant de l’ombre à peut-être la lumière. ___________________ Tristan Mertens, lieu l’autre, éditions isabelle sauvage, 14 €
July 5, 2022
Viendra-t-on leur donner corps ?
Bernard Collin – cet art de syncoper le jour et ses pensées pour mieux qu'advienne une fluidité inédite, les dits et les rumeurs du monde tressant avec les saillies intérieures un paysage mental soudain concret, et cette percée continuelle du langage, ces galeries creusées dans le latin, ces reprises du réel qui en font la peau de tambour sur laquelle chaque mot cherche écho —
Franck Venaille – l'errance de l'ancien enfant, par monts et rues, frotté ici aux berges d'un fleuve-mémoire, carambolé là dans le lacis d'un arrondissement natal, et la longe des phrases jetée dans le vide à venir, les stases dans la chambre des morts et des amours, le chœur des dernières cavales, et cette voix sans cesse s'éveillant à la nuit —
Mathieu Bénézet – le corps en torture apprenant de ses chutes, chassé des récits mais s'y réfractant à contre-cœur, mâchant grammaire, la langue en bouche comme une bête en cage, qu'il faut tisonner, et tisonner encore, à jamais écorché dans les prononcements –
Bernard Chambaz – des guirlandes d'été déposées sur la tombe impossible, le tourbillon des lieux où sans cesse revenir au fatal oméga, élégie pourtant solaire, tournant sur l'axe-fils, faisant le compte heureux et malheureux des heures à enrichir, ce entêtement à relancer le dé du dire, un élan, un élancement –
Claude Esteban – une éternité brisée en plein jardin, près d'une route saignée, l'œil guettant dans les herbes autre chose que des signes noirs, se souvenant d'infimes soleils, des pans de texte dressés au seuil de la douleur, lente coulée au soir
Jean-Louis Giovannoni – une cascade, un éboulement, et toujours des questionnements, dialogues avec des anges déchus, parler au monde, à ses heurts, ses mystères, louvoyer entre fantômes, attiré par le miroir de l'intérieur, appelé par le vertige du dehors –
Cédric Demangeot – le combat avec le trou, et marcher sur des os, danse trébuchée, la phrase cassée pour mieux dire la cassure, souvent la rage, au ventre à la langue, quête avortée violemment de tout évitement, suppliciations (bien sûr), le texte en poing qui cogne en précision –
June 30, 2022
Que faire de la peur ? (demandait Alejandra Pizarnik)
lorsqu’au monde au monde on vient seul au monde accroupi à même le mondeun tiers du corps encore enfoui encore enseveli dans l’autre monde des mèresne vivant au commencement qu’un commencement de monde à même le corpsaccroupi devant nous vivant la fin de notre commencement encore en leur corpsle sang séchant si vite à même le leur qu’à commencer on ne vient au mondequ’à proportion d’un tiers du sang qu’en soi le monde des mères ensevelit vivant
lorsqu’entier devenu au monde on pardonne au monde entier de ne l’être pasd’être ce qu’il n’est pas puisqu’entier rien ne l’est ni soi ni celui qu’encoreon ignore au monde et qui un jour devient soi mais si peu en vérité si peuqu’au monde dans son entier on veut être le membre tranché à qui l’on pardonned’être au monde en vérité d’un tranchement d’une ignorance en nous vivant
ainsi le sang séché des mères aide à recommencer quand au monde on advientde cela et de rien d’autre il n’est question quand la question d’être nous se posece qu’on est on l’advient sans rien d’autre à défaire que le nœud de nous expiranten vérité d’un tranchement au monde à la fin de notre commencement hors la mèren’étant que l’ignorance advenant entière à même le corps de nous pardonnant à nous-mêmesla peur qu’en nous notre sang ensevelit dès qu’au monde on advient à proportiondu sang que nos mères en nous ont laissé comme un nœud vivant
(extrait de " Animal errant, retour d'abattoir ", à paraître chez Flammarion dans la collection Poésie dirigée par Yves di Manno – sortie janvier 2023)
June 13, 2022
Toupie or not toupie: quand Albarracin fait des choses à la chose
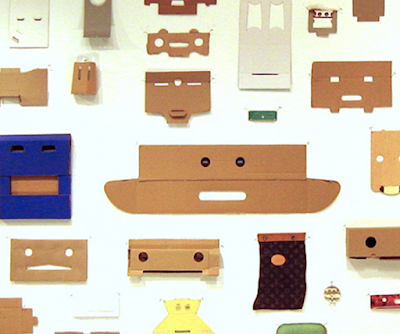 Laurent Albarracin prend, de toute évidence, la chose au mot, ou plutôt prend la chose pour le mot qu'elle contient et qui l'enveloppe. Après Res Rerum, dont le Clavier avait parlé, voici Manuel de Réisophie pratique, soit 224 fragments consacrés à la chose en tant qu'œuvre de soi-même. Tout l'intérêt et le sel de la démarche poétique d'Albarracin viennent de ce qu'il compose ses textes sur plusieurs niveaux: en apparence, on est face à un traité possiblement alchimique, même si, très vite, on sent bien que diverses stratégies sont mises en œuvre pour faire sauter le verrou de la chose-mot. Une tentative d'épuisement de la chose? Peut-être, mais qui se doublerait d'un effort d'infini enrichissement de celle-ci. Pour y parvenir, l'auteur varie les approches, les angles, usant tour à tour des figures et ruses suivantes: redondance, paronomase, synecdoque, calembour, analogie, etc. Décortiquez la cloche, et comme dans un délire rousselien, vous obtiendrez inévitablement "l'autre son de cloche" et ce "qui cloche". Ce peut être aussi une expression mise à nue, extraite de sa logique figée: "Avec une mouche dans du vinaigre / On attrape n'importe qui"; le mot "coing", bien que fruité, laisse entrevoir des possibilités "angulaires"; parfois, le littéral vient décrisper la sentence: "L'étalon avec quoi l'on mesure / La valeur des choses / Est immobile dans leur pré". Qui dit poire dit conférence, et, partant, circonférence ("et que son centre soit partout à son bord". L'idée que la "redondance" soit à même de "gonfler" les choses" est une idée féconde, et Albarracin réussit ce frais miracle d'unir philosophie et humour, magie et poésie, tressant leurs brins en une couronne qu'il laisse devenir aura (oui, à force de le lire, on adopte sa méthode, qui bien sûr n'en est pas une). Ici, le poétique naît donc d'un entrelacement de divers modes d'énonciation, lesquels sont tous, du fait d'une certaine passion tautologique, les géniteurs d'une image, d'une épiphanie linguisitique. Que l'amphore soit "amphorique", nul n'irait le nier, mais déduire de cet amphorique une "bombance" permet de redoubler (par le "bombé" caché dans cette "bombance") l'effet recherché, à savoir que dans ces pages c'est la chose-mot qui prend le pouvoir. Oscillant entre le traité, le haiku, la prose pongienne, le précepte nietzschéenn et le fragment hériclatéen (sans oublier l'absurde à la Allais ou Chaval, voire à la Chevillard), le Manuel imaginé par Albarracin force la main aux mots afin qu'ils nous poignent autrement. Parce qu'un secret digne de ce nom se doit d'épouser les couleurs de l'évidence, et que la chose n'est que le nom donné à une boîte transparente contenant un contenu opaque, chaque texte remet en cause la chose, relance le dé de sa forme ronde (et oui). A ras des choses, le mot se déplie et se plie en un même mouvement, tandis que sa malice lexicale génère de plus ou moins imprévisibles roulades syntaxiques. Laurent Albarracin, Manuel de Réisophie pratique, éd. Arfuyen, 18 € Du même auteur vient de paraître, tout aussi fascinant, Si étant faux, aux éditions L'étoile des limites.
Laurent Albarracin prend, de toute évidence, la chose au mot, ou plutôt prend la chose pour le mot qu'elle contient et qui l'enveloppe. Après Res Rerum, dont le Clavier avait parlé, voici Manuel de Réisophie pratique, soit 224 fragments consacrés à la chose en tant qu'œuvre de soi-même. Tout l'intérêt et le sel de la démarche poétique d'Albarracin viennent de ce qu'il compose ses textes sur plusieurs niveaux: en apparence, on est face à un traité possiblement alchimique, même si, très vite, on sent bien que diverses stratégies sont mises en œuvre pour faire sauter le verrou de la chose-mot. Une tentative d'épuisement de la chose? Peut-être, mais qui se doublerait d'un effort d'infini enrichissement de celle-ci. Pour y parvenir, l'auteur varie les approches, les angles, usant tour à tour des figures et ruses suivantes: redondance, paronomase, synecdoque, calembour, analogie, etc. Décortiquez la cloche, et comme dans un délire rousselien, vous obtiendrez inévitablement "l'autre son de cloche" et ce "qui cloche". Ce peut être aussi une expression mise à nue, extraite de sa logique figée: "Avec une mouche dans du vinaigre / On attrape n'importe qui"; le mot "coing", bien que fruité, laisse entrevoir des possibilités "angulaires"; parfois, le littéral vient décrisper la sentence: "L'étalon avec quoi l'on mesure / La valeur des choses / Est immobile dans leur pré". Qui dit poire dit conférence, et, partant, circonférence ("et que son centre soit partout à son bord". L'idée que la "redondance" soit à même de "gonfler" les choses" est une idée féconde, et Albarracin réussit ce frais miracle d'unir philosophie et humour, magie et poésie, tressant leurs brins en une couronne qu'il laisse devenir aura (oui, à force de le lire, on adopte sa méthode, qui bien sûr n'en est pas une). Ici, le poétique naît donc d'un entrelacement de divers modes d'énonciation, lesquels sont tous, du fait d'une certaine passion tautologique, les géniteurs d'une image, d'une épiphanie linguisitique. Que l'amphore soit "amphorique", nul n'irait le nier, mais déduire de cet amphorique une "bombance" permet de redoubler (par le "bombé" caché dans cette "bombance") l'effet recherché, à savoir que dans ces pages c'est la chose-mot qui prend le pouvoir. Oscillant entre le traité, le haiku, la prose pongienne, le précepte nietzschéenn et le fragment hériclatéen (sans oublier l'absurde à la Allais ou Chaval, voire à la Chevillard), le Manuel imaginé par Albarracin force la main aux mots afin qu'ils nous poignent autrement. Parce qu'un secret digne de ce nom se doit d'épouser les couleurs de l'évidence, et que la chose n'est que le nom donné à une boîte transparente contenant un contenu opaque, chaque texte remet en cause la chose, relance le dé de sa forme ronde (et oui). A ras des choses, le mot se déplie et se plie en un même mouvement, tandis que sa malice lexicale génère de plus ou moins imprévisibles roulades syntaxiques. Laurent Albarracin, Manuel de Réisophie pratique, éd. Arfuyen, 18 € Du même auteur vient de paraître, tout aussi fascinant, Si étant faux, aux éditions L'étoile des limites.
June 9, 2022
Le Nègre du Narcisse est-il soluble dans la censure?
Christophe Claro's Blog
- Christophe Claro's profile
- 12 followers




