Leçons de lâexil de deux Viennois et une Pragoise
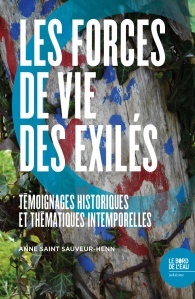 Trois destins extraordinaires sont au centre du livre dâAnne Saint Sauveur-Henn, Les forces de vie des exilés, témoignages historiques et thématiques intemporelles (Ed. Le Bord de lâeau, 2021). Un jeune Viennois, déporté à 13 ans, subit le pire que lâon puisse imaginer (à Auschwitz puis Dachau) et trouve la force de sauver une orpheline tout en lui cachant, pour la préserver, que ses parents sont morts en déportation et quâil nâest pas le père biologique. A partir de 1949, il restera en Amérique du Sud. Autre Viennois, Fritz Kalmar, juriste de formation, prend conscience de sa judaïté à travers les persécutions et est contraint de quitter lâAutriche en 1938, sâinstallant en Bolivie où il fonda en 1941 la Fédération des Autrichiens libres. Lenka Reinerová, elle, est née à Prague mais dans une famille germanophone. Elle aussi se découvre juive en 1938 et échappe aux persécutions en sâexilant, dâabord à Paris. En septembre 1939, avec lâentrée en guerre de la France, elle est considérée comme suspecte, ressortissante dâune nation ennemie, et internée à la prison de la Roquette. Elle parvient à quitter lâEurope en 1941, en sâinstallant elle aussi aux Amériques, au Mexique où elle fait vivre la langue allemande et la culture tchèque (elle fonde Freies Deutschland, dâobédience communiste, avec Heinrich Mann, puis un journal tchèque en espagnol). Ces trois personnes vivent plus de 90 ans et surmontent les douleurs de lâexil, notamment par lâécriture et la transmission : Fritz Kalmar publie cinq livres entre 86 et 96 ans, Lenka Reinerová neuf livres entre 67 et 91 ans !
Trois destins extraordinaires sont au centre du livre dâAnne Saint Sauveur-Henn, Les forces de vie des exilés, témoignages historiques et thématiques intemporelles (Ed. Le Bord de lâeau, 2021). Un jeune Viennois, déporté à 13 ans, subit le pire que lâon puisse imaginer (à Auschwitz puis Dachau) et trouve la force de sauver une orpheline tout en lui cachant, pour la préserver, que ses parents sont morts en déportation et quâil nâest pas le père biologique. A partir de 1949, il restera en Amérique du Sud. Autre Viennois, Fritz Kalmar, juriste de formation, prend conscience de sa judaïté à travers les persécutions et est contraint de quitter lâAutriche en 1938, sâinstallant en Bolivie où il fonda en 1941 la Fédération des Autrichiens libres. Lenka Reinerová, elle, est née à Prague mais dans une famille germanophone. Elle aussi se découvre juive en 1938 et échappe aux persécutions en sâexilant, dâabord à Paris. En septembre 1939, avec lâentrée en guerre de la France, elle est considérée comme suspecte, ressortissante dâune nation ennemie, et internée à la prison de la Roquette. Elle parvient à quitter lâEurope en 1941, en sâinstallant elle aussi aux Amériques, au Mexique où elle fait vivre la langue allemande et la culture tchèque (elle fonde Freies Deutschland, dâobédience communiste, avec Heinrich Mann, puis un journal tchèque en espagnol). Ces trois personnes vivent plus de 90 ans et surmontent les douleurs de lâexil, notamment par lâécriture et la transmission : Fritz Kalmar publie cinq livres entre 86 et 96 ans, Lenka Reinerová neuf livres entre 67 et 91 ans !
Anne Saint Sauveur-Henn propose un livre original en deux parties. Dans la première, elle a rédigé une lettre à chaque nonagénaire, citant parfois des courriels que ceux-ci lui ont adressés. Elle met en exergue la façon dont, chacun à sa manière, ils ont su non seulement faire face à des épisodes traumatisants, mais aussi développer des valeurs fortes qui les guideront tout le restant de leur vie. Câest ce quâelle nomme les « forces de vie » et dans la seconde partie du livre, elle tente de tirer de ces destins quelques considérations sur ce qui fait la richesse dâune vie humaine. Pour cela elle reprend les écrits de Boris Cyrulnik sur la résilience et utilise la métaphore du métabolisme pour montrer comment ces périodes critiques (déportation, assassinat, expériences proches de la mort, exil, emprisonnements, trahisonsâ¦) sont « digérés » par les sujets.
Si parfois des passages sont discutables, lâouvrage se lit avec beaucoup dâintérêt et parfois même dâémotion. Parmi les extraits détonants avec la qualité de lâensemble, lâauteure évoque par exemple une « montée des extrêmes » (p. 124), comme si lâextrême droite et la gauche de la gauche avaient les mêmes propos sur les politiques dâasile, alors quâelle relate avec bienveillance et admiration les actions entreprises par un Cédric Herrou à la frontière franco-italienne. Autre passage étonnant, entre Albert Einstein et Arnold Schönberg, cités pour illustrer la richesse de lâapport des exilés aux Ãtats-Unis, on trouve un troisième homme : Henry Kissinger, pourtant à la tête de lâopération Condor mettant lâAmérique centrale et lâAmérique du Sud à feu et à sang, responsable des bombardements secrets au Viêt Nam et auteur, bien que juif, de propos relevant dâun antisémitisme crasse.
Le mérite du livre est dâabord de nous faire découvrir ces trois parcours de vie mais aussi de nous proposer ces réflexions sur les « héros ordinaires » que sont par exemple ces « justes » qui ont sauvé des Juifs. ll nâest pas certain que « solidarité », « adaptation » et « valeurs » soient des idées très originales pour faire face à la pandémie (le texte date dâailleurs un peu car avec les tests nous ne sommes plus face à un « ennemi indétectable »), mais câest autour des blessures et leur mémoire que le livre a le plus à offrir. On lit ainsi :
« Pour un individu comme pour une collectivité, rien ne permet dâoublier la blessure, on ne peut que la métaboliser et donc intégrer la souffrance dans son histoire en la transformant par lâusage de la pensée et de la parole, forces de vie. Globalement, la parole se fait témoignage, pour soi ou pour dâautres : lâidentité humaine est essentiellement narrative. » (p. 133)
Les « forces de vie » des exilé.e.s pourraient nous aider à préparer un monde plus juste.
Anne Saint Sauveur-Henn, Les forces de vie des exilés, témoignages historiques et thématiques intemporelles (Ed. Le Bord de lâeau, 2021)
Jérôme Segal's Blog
- Jérôme Segal's profile
- 4 followers



