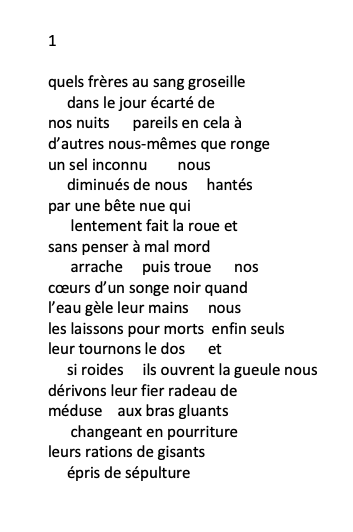Christophe Claro's Blog, page 30
August 18, 2020
Faire chemin (avec Philippe Denis)
 [© Jacques Capdeville]
[© Jacques Capdeville]
Rien de tel qu'une rentrée littéraire pour parler d'autre chose. Pour qu'autre chose parle, à l'écart, hors la meutes des piles, là où la langue apprend à contourner le bruit. On vous parlera donc aujourd'hui d'un précieux volume – Chemins faisant –, anthologie personnelle du poète Philippe Denis, publié par les éditions Le Bruit du Temps (et ici je remercie le libraire de La Friche qui m'a offert ce volume, comme une évidence à vocation fulgurante).
Chemins faisant se veut, en 304 pages, une traversée de l'œuvre discrète de Philippe Denis. On a là quelque chose de précieux, comme le sont souvent ces travaux de sonde, de coupe, ces choix opérés par l'auteur lui-même. Qu'on pense par exemple à Capitaine de l'angoisse animale, de Franck Venaille, ou à Des laines qui éclairent, de Pascal Commère. Ce sont là des livres tectoniques qui font de nous d'attentifs voyageurs: au fil des pages, on assiste, de nouveau novice, comme en un présent étiré, à des germinations, des rayonnements. Ainsi, donc, de la trajectoire de Philippe Denis, lequel, dès 1974, s'avance sur le terrain miné de la langue. Partant d'une vibration entre caillou et papillon – entre intemporel et éphémère –, mais sans aspirer à une entreprise d'obédience pongienne, Denis s'avance dans un rapport blessé au réel et, plus proche en cela d'un Bernard Noël (je me trompe peut-être), explore et risque sa position au monde, où il importe de "taire la langue"; non pas faire profession de silence, mais exprimer un violent sentiment de déportement, comme si écrire était travailler un retrait aussi nécessaire que consenti: "plus d'absence est ce que nous choisissons". Il y a bien sûr, dans tout retrait, le risque d'un état larvaire, la tentation du froid. La conscience, à seulement affleurer, offre prise aux ombres, mais c'est précisément dans la compagnie des limbes que peut se développer une acuité nouvelle: "Vigilance de vivre / — sous la courbure du sommeil."
 Dès lors, il s'agit de peindre autour de soi un paysage, minimal et peut-être suffisant: un champ, une prairie, un sentier, une demeure. Confier le soi à très peu d'éléments, c'est donner sens à sa dissolution. Chez Denis, le soi est comme une tache d'ombre qui cherche à mieux survivre dans un monde aux reflets instables. Paysage, donc sensation, ou plutôt image: à force de dépouillement, le poète peut enfin, en peintre japonais, en "saisonnier du vide", inscrire le précaire dans son discret miracle: "Une goutte de rosée / bague / le tremblement de l'herbe." Pas le brin d'herbe, mais son tremblement: l'inattendu demeure observable. Le sensible, aussi fragile soit-il, trouve sa forme, même éparse: "des lambeaux de coq / crépitent / dans les enclos".
Dès lors, il s'agit de peindre autour de soi un paysage, minimal et peut-être suffisant: un champ, une prairie, un sentier, une demeure. Confier le soi à très peu d'éléments, c'est donner sens à sa dissolution. Chez Denis, le soi est comme une tache d'ombre qui cherche à mieux survivre dans un monde aux reflets instables. Paysage, donc sensation, ou plutôt image: à force de dépouillement, le poète peut enfin, en peintre japonais, en "saisonnier du vide", inscrire le précaire dans son discret miracle: "Une goutte de rosée / bague / le tremblement de l'herbe." Pas le brin d'herbe, mais son tremblement: l'inattendu demeure observable. Le sensible, aussi fragile soit-il, trouve sa forme, même éparse: "des lambeaux de coq / crépitent / dans les enclos".La vie, on le sent, est danger, la mort s'y profile, et par défiance du vif c'est au vu qu'on s'attache. "Où tu t'absentes / de ta vie, / je te vois / aux prises / avec l'image." Ainsi, la poésie se vit comme une membrane intérieure, charnelle, dont on veillera à dire les pulsations. "Je longe mon souffle": c'est là l'invention d'un nouveau rapport à ce qui peut se dire. Si le soi est superflu, il convient d'en tirer la leçon d'une distanciation. Ici, Denis est exactement rimbaldien, comme en témoigne ces simples mots: "l'image m'emploie". Artisan-funambule, aussi, quand il écrit: "patiemment / entre deux vides, / je couds / une ligne."
Au fil des textes choisis par l'auteur, on suit donc cette ligne, tremblée mais ferme, on voit et on entend la phrase aspirer à quelque affranchissement, et c'est allégé et néanmoins plus terrien que jamais qu'il évoque le désir de connaître une "joie d'insecte devant le trou", ou fait ce constat à la fois philosophique et concret: "je ronge pour avancer", constat qui s'accompagne d'une précision :"je ne fais qu'un avec l'obstacle". Est-ce enfin communion, apaisement? Avec les années, Denis tend vers l'aphorisme, sans pourtant que l'énoncé s'installe dans la formule; là encore, on est dans le trait de pinceau, le senti isolé ("sensation de froid ou d'écrire"). S'il y a apaisement, il n'est pas indexé au moindre renoncement, comme le scandent puissamment les textes de Mœurs de césure". On est de nouveau dans la lutte. Etat des lieux, postures et résistances au réel, ce dernier mastiqué jusque dans l'allitération: auge/bauge, pitance/pire, suture/couture. Denis continue de ronger l'obstacle et d'imposer sa patiente ruade. "Pas de travail d'appui. / Au pays de l'effroi les fondations / sont obsolètes." Jeté au vide, menacé d'éboulement, on peut toujours faire une force de l'égarement. Il suffit, nous dit le poète, d'"être féériquement seul". Chemins faisant, Philippe Denis a changé la perdition en expérience, la fissure en tracé.
______________
Philippe Denis, Chemins faisant, poèmes 1974-2014, choisis par l'auteur, préface de John E. Jackson, Le Bruit du Temps, 304 pages, 8 € (2018)
August 16, 2020
Blague à part
 "C'est un fou. Il entre dans un bar. Au comptoir, il y a une féministe, un écolo et un ayatollah. Le fou se frotte les yeux et dit: "Ça alors, une réunion d'ayatollahs!"
"C'est un fou. Il entre dans un bar. Au comptoir, il y a une féministe, un écolo et un ayatollah. Le fou se frotte les yeux et dit: "Ça alors, une réunion d'ayatollahs!"Si cette bague ne nous fait pas rire, c'est normal. Le fou n'est pas fou, il est juste Garde des Sceaux.
August 13, 2020
Transition: la joie des Jolas (avant la gaule de De Gaulle)
Pas très loin de chez moi, à vol de bergeronnette dans un village assez calme du nom de Colombey-les-deux-églises se dresse une maison portant le nom de Boisserie et qui accueille moult visiteurs venus rendre hommage à son ancien proprio le Général. Oui: De Gaulle himself. Il y a aussi derrière cette maison une grand croix de granit de 44 mètres de haut qui chante la Lorraine à tous les cerfs en train de bramer un peu plus bas…
 Naguère, les pontes du RPR venaient s'y poser une fois par an et se gaver de gibier aussi faisandé qu'eux au restau du coin, souillant le vert paysage de leur fat cortège de véhicules noirs. Assez peu gaulliste dans l'âme, je dois dire que mon intérêt pour cette célèbre "Boisserie" en était resté au degré zéro de la passion touristique. Mais voilà qu'une habitante de mon village, la discrète mais surprenante Aurélie Chenot, par ailleurs correspondante au Journal de la Haute-Marne, débarque un jour chez moi et me fait part d'un long reportage qu'elle compte publier dans le supplément du dimanche dudit journal, et ce en trois livraisons. Mes ouïes béèrent séant. Soudain, la Boisserie n'était plus le seul fief d'un président-militaire doté des pleins pouvoirs, d'une police secrète, d'une seule chaîne de télévision, et dont toute l'information était contrôlée par l'Etat (je me permets de paraphraser Rio ne répond plus…). Non, la Boisserie avait un passé autre, antérieur au grand proprio gradé
Naguère, les pontes du RPR venaient s'y poser une fois par an et se gaver de gibier aussi faisandé qu'eux au restau du coin, souillant le vert paysage de leur fat cortège de véhicules noirs. Assez peu gaulliste dans l'âme, je dois dire que mon intérêt pour cette célèbre "Boisserie" en était resté au degré zéro de la passion touristique. Mais voilà qu'une habitante de mon village, la discrète mais surprenante Aurélie Chenot, par ailleurs correspondante au Journal de la Haute-Marne, débarque un jour chez moi et me fait part d'un long reportage qu'elle compte publier dans le supplément du dimanche dudit journal, et ce en trois livraisons. Mes ouïes béèrent séant. Soudain, la Boisserie n'était plus le seul fief d'un président-militaire doté des pleins pouvoirs, d'une police secrète, d'une seule chaîne de télévision, et dont toute l'information était contrôlée par l'Etat (je me permets de paraphraser Rio ne répond plus…). Non, la Boisserie avait un passé autre, antérieur au grand proprio gradé2
Dans l'article incroyablement fouillé écrit par Aurélie Chenot, on apprend que la Boisserie était habité par deux locataires discrets, Eugène et Maria Jolas, qui dirigèrent entre autres activités la cultissime revue Transition. C'est en 1927 – sept ans avant que le lieu soit acheté par le contempteur de la chienlit – que ce couple s'installe à Colombey. Transition? Oui, la revue qui publié en épisodes, tout au long d'une décennie, l'œuvre dernière de Joyce, Finnegans Wake. Lorrain de quasi naissance – né dans le New Jersey, le petit Eugène est parachuté en France à l'âge de deux ans… –, l'infatigable Jolas
 ne cessera d'aller et venir entre New York, Paris et Colombey. Sa découverte du surréalisme, en 1923, sera le début d'une belle galaxie d'amitiés (Eluard, Péret, Desnos, Soupault) ainsi que d'une œuvre protéiforme, puisqu'il sera à la fois critique, éditeur, écrivain et traducteur…
ne cessera d'aller et venir entre New York, Paris et Colombey. Sa découverte du surréalisme, en 1923, sera le début d'une belle galaxie d'amitiés (Eluard, Péret, Desnos, Soupault) ainsi que d'une œuvre protéiforme, puisqu'il sera à la fois critique, éditeur, écrivain et traducteur…Quand on lit le reportage d'Aurélie Chenot, on a le vertige. Moi, en tout cas, je l'ai. J'apprends ainsi que si j'étais né un peu plus tôt, j'aurais pu croiser, en allant acheter mon pain à Colombey, Sherwood Anderson. J'aurais pu, en faisant un saut à Saint-Dizier, passer voir l'imprimeur de la revue Transition, André Bruillard. Ô Champagne pouilleuse, dire que j'ignorais que l'ombre de Joyce planait sur tes moelleux coteaux ! Dire que j'ignorais qu'à quelques sauts de chevreuil de chez moi se tramait, il y a un siècle, la "revolution of the word", prôné par le malicieux Jolas!
3
Au sommaire de Transition, on trouvait alors des noms de haute instance: Perse, Ball, Michaud, Queneau, Artaud (!), Nin, H. Miller, sans compter des peintres qui enrichissaient la revue d'illustrations: Klee, Miro, Picasso, Kandinsky, Man Ray, Duchamp. S'adossait entre autres à une thèse de Céline Mansani qui porte sur la revue des Jolas, Aurélie Chenot rend enfin un fort et revigorant hommage à Maria Jolas.

 Cette dernière traduisit, accrochez-vous, aussi bien Fargue que Roussel, Desnos, Vitrac, Paulhan. Le couple a également – re-accrochez-vous – La Métamorphose de Kafka. En 1932, Maria Jolas a fondé une école bilingue, est devenue proche de l'auteur d'Ulysse, s'est occupée de Lucia (la fille de Joyce). Tout aussi dévolue et inlassable que son époux, Maria Jolas ne cesse de prodiguer son intelligence et sa générosité, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Après la mort de son mari, elle traduisit Bachelard (un voisin, il est de Bar-sur-Aube) et Sarraute, qui fut sa voisine à Chérence, dans le Val d'Oise, où Maria acheta en 1950 une maison.
Cette dernière traduisit, accrochez-vous, aussi bien Fargue que Roussel, Desnos, Vitrac, Paulhan. Le couple a également – re-accrochez-vous – La Métamorphose de Kafka. En 1932, Maria Jolas a fondé une école bilingue, est devenue proche de l'auteur d'Ulysse, s'est occupée de Lucia (la fille de Joyce). Tout aussi dévolue et inlassable que son époux, Maria Jolas ne cesse de prodiguer son intelligence et sa générosité, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Après la mort de son mari, elle traduisit Bachelard (un voisin, il est de Bar-sur-Aube) et Sarraute, qui fut sa voisine à Chérence, dans le Val d'Oise, où Maria acheta en 1950 une maison.Je pourrais aussi vous parler de la fille aînée du couple, Betsy Jolas, grande compositrice âgée aujourd'hui de 94 ans, mais le mieux, je crois, est de se tourner vers Aurélie Chenot et de lui dire:
"Please, faites un livre de toute cette formidable matière (les trois livraisons de l'article sont par ailleurs abondamment illustrées), même un petit livre, bref, faites en sorte qu'un jour, en passant devant la Boisserie, des promeneurs haut-marnais ou autres disent : Tiens, c'est là qu'un temps l'esprit international poétique a rayonné. C'est là d'où un jour a explosé noir sur blanc ce mot qui chamboula tout: riverrun…"
Editeurs, s'il vous reste un soupçon de curiosité, décrochez votre téléphone, appelez Aurélie Chenot, et veillez à ce que, de cette enquête remarquable, naisse un ouvrage indispensable. Quant à moi, maintenant, quand je prends ma voiture pour aller acheter du pain à Colombey, je guette dans le rétro la silhouette spectrale de Sherwood Anderson, que j'imagine souriant à des vieilles pommes ridées, les meilleurs selon lui…
August 10, 2020
Animal errant (extrait)
Voir le jour: avant-première ce soir à Paris
Ce soir, lundi 10 aoûtvenez nombreux à l'avant-premièredu film de Marion Laine:
Voir le jour
à l'UGC Ciné Cité Les Hallesen présence de la réalisatrice et de plusieurs actrices du film (Sandrine Bonnaire, Aure Atika…)


July 29, 2020
A la recherche du temps de fignoler
 Emmanuel Ruben a sûrement raison de vouloir défendre le statut des écrivains (dans une tribune parue dans le Libé du 29 mai), mais j’avoue que j'ai du mal à le suivre dans sa façon de s’y prendre. Non seulement parce qu’il est difficile, voire impossible, de regrouper sous une même bannière des gens qui écrivent des choses aussi différentes qu’un recueil de poèmes, une thèse sur les grenouilles et un manuel de brossage des ongles (ce que Pierre Jourde a très bien souligné dans une de ses récentes chroniques libres), mais surtout, et c’est là où je tique, parce que Ruben me semble user d'une rhétorique foireuse. Sa tribune s’adresse en effet à Macron, à son premier ministre et au ministre de la culture. Or que leur demande-t-il ? Ceci :
Emmanuel Ruben a sûrement raison de vouloir défendre le statut des écrivains (dans une tribune parue dans le Libé du 29 mai), mais j’avoue que j'ai du mal à le suivre dans sa façon de s’y prendre. Non seulement parce qu’il est difficile, voire impossible, de regrouper sous une même bannière des gens qui écrivent des choses aussi différentes qu’un recueil de poèmes, une thèse sur les grenouilles et un manuel de brossage des ongles (ce que Pierre Jourde a très bien souligné dans une de ses récentes chroniques libres), mais surtout, et c’est là où je tique, parce que Ruben me semble user d'une rhétorique foireuse. Sa tribune s’adresse en effet à Macron, à son premier ministre et au ministre de la culture. Or que leur demande-t-il ? Ceci :« Quel art et quelle littérature souhaitez-vous pour la France ? »
Excuse-me, mais je me fous de savoir quelle littérature veut le président et ses commis ! Toujours selon Ruben, il faudrait éviter d’en arriver à une « littérature de rentiers qui ne se préoccupent pas de leurs ventes et qui exercent l’écriture comme un hobby ? » Mais ça veut dire quoi ? Ça désigne qui ? Quelle frange des auteurs ? Le pire est à venir : quand Ruben demande à notre cher président ce qu’il veut (ou ne veut pas ?) :
« Voulez-vous d’un art exercé par des artistes qui cumulent plusieurs métiers – enseignant à gauche, répondant à droite à des commandes – et n’ont plus la force de se consacrer, le soir, à ce qui nous donne, à nous, Français, la joie de vivre et la force de penser ? »
On croit rêver, franchement. Déplorer qu’un écrivain ne puisse pas vivre de sa plume, passe encore, mais en faire le portrait d’un pauvre cumulard qui, quand le soleil se couche, est épuisé et ne peut que regarder l’inspiration lui dire bye-bye ? Ah, si Kafka avait pointé à Pôle Emploi, quels chefs-d’œuvre il aurait écrit, au lieu de s’user la santé à jouer les ronds de cuir ! Quiconque ressent la nécessité d’écrire sait qu’il doit s’arranger avec le réel. Et sait aussi que le temps et l’énergie d’écrire n’iront pas de soi. Soyons lucides : le fameux « il ou elle se consacre entièrement à l’écriture » qu’on trouve parfois au dos des livres est une sinistre farce. Aucun écrivain ne passe dix heures à sa machine sept jours sur sept, sauf s’il a des délais imposés ou juste des choses à dire (ou les deux). L’écriture exige du temps de non-écriture, d’autres pratiques d’écriture (la traduction, par exemple, ou la rédaction d’articles critiques…). C'est inquantifiable. On peut passer dix ans sur un roman et accoucher d'une bouse. Ou écrire un livre lumineux en six semaines. Mais pourquoi s’obstiner à demander à Macron ce qu’il veut ? Je cite :
« Voulez-vous des artistes et des auteurs qui refusent toute vie familiale et se sacrifient pour un métier qui les rémunère si mal ? »
Non mais oh ! personne n’oblige personne à avoir une vie familiale, encore moins à la sacrifier. Je suis de moins en moins Ruben dans sa rhétorique : « nous, Français », « la joie de vivre », « vie familiale »… Ah, tous ces hommes qui ont refusé la mort dans l'âme de torcher leur gamin pour terminer de trousser leur sonnet… Et en plus, nous dit-il, nous autres écrivains (c’est-à-dire, je suppose, lui, moi, Alexandre Jardin, Homère et Robert Mercier, l’auteur de Comment analyser les gens…), nous ne pouvons pas vivre aussi dignement que des intermittents ! Ben non. C'est comme ça. On ne fait pas le même métier. Mon temps n'est pas comptabilisable.
Mais ce n’est pas tout. Croire qu’aider les écrivains à mieux s’occuper de leur famille (et à écrire mieux et plus sereinement) permettrait de donner à « la France […] l’art et la littérature qu’elle mérite : des livres seraient meilleurs car les auteurs auraient le temps de les fignoler », ça veut dire quoi ? La littérature que mérite la France ? Le temps de fignoler ? Là, je me pince. On ne peut pas à la fois réclamer une amélioration du statut d’auteur et penser sincèrement que mieux rémunéré on écrive mieux, qui plus est pour faire plaisir à la mère-patrie ! Certains livres seraient mal écrits parce que leur auteur n'a pas eu le temps de les fignoler? Ouf! Enfin une explication cool. Je comprends mieux mon impression à la lecture de certains romans, maintenant.
Je suis d’accord pour qu'un auteur touche un pourcentage décent sur les revenus perçus lors de la vente d’un livre: ça tombe sous le sens. Quant aux aides, elles existent, et le CNL fait ce qu’il peut, franchement. Et je ne parle pas des résidences d’auteur et autres opportunités. Mais est-il besoin de faire miroiter à un président et deux ministres une aura first-class comme celle que leur propose Ruben en fin de tribune :
« En 2021, il vous appartiendra de devenir les nouveaux Protecteurs des Arts et des Lettres et de graver vos noms vis-à-vis de ceux de Charlemagne, François Ier, André Malraux ou Jack Lang. »
C’est de l’humour, j’ose espérer… De Charlemagne à Macron : ou comment sauver la littérature ! Mieux fignoler pour mieux écrire ? Un peu de sérieux…
Je ne suis pas en train de défendre je ne sais quel statut de l’écrivain maudit, mais peut-être appartient-il, dans une faible mesure du moins, à l’écrivain de ne pas trop faire de courbettes devant le pouvoir, de ne pas lui demander quelles œuvres il attend, de ne pas écrire pour la France, etc. Peut-être devons-nous même espérer ne pas devenir ni nous prendre pour des représentants de la littérature, d'autant plus que nous ne faisons pas tous le même métier (désolé…) ? Une fois de plus, je le précise : le « combat » que mène Emmanuel Ruben (et les co-signataires de sa tribune) part sans doute d’un agacement légitime. Oui, c’est sans doute vrai, écrire des livres qui se vendent peu rapporte peu. Oui, c’est possible, si on travaille le jour, le soir on est fatigué. Oui, c’est imaginable, quand on a des enfants, on a moins de temps pour fignoler un paragraphe que la France mérite. Oui, c’est vrai, écrire ce post sur mon blog ne me rapporte rien, c'est vraiment injuste, mais je doute sincèrement que promettre à Macron qu’il verra un jour son nom gravé à côté de celui de Charlemagne boostera mes ventes ou m’empêchera de rater une page sur deux quand j’écris.
Au début de sa tribune, Ruben cite Primo Levi : « Comme toute autre activité utile, écrire mérite salaire. » A mon tour de citer Levi :
« Nous devons bien peser notre décision avant de déléguer à quelqu’un d’autre le pouvoir de juger et de vouloir à notre place.
July 20, 2020
Eric Reinhardt, prosatier
 A lire le nouveau livre d'Eric Reinhardt, Comédies françaises, on a la gênante impression que l'art romanesque s'est arrêté en 1920, a dormi pendant cent ans d'un sommeil repu et légèrement hébété, puis, sans doute dérangé par un bruit de vaisselle inopiné, s'est réveillé pour reprendre son cours tranquille, sans trop lever le nez de l'assiette de son oreiller. Bien que né de la dernière pluie, et comme elle susceptible de tricoter quelques jolis arc en ciel dès que s'ébroue le soleil du style, Reinhardt sait à peu près tout faire avec une phrase, sauf bien sûr nous convaincre de sa nécessité. Il a le chic pour trousser des phrases brèves comme des alexandrins coupés en deux par une serpette poétique: "Dehors, la nuit, à peine." (p.19) Mais il sait aussi imiter les Inconnus et leur tube "Et vice versa" dans de longues séquences où le sens affamé se mord la queue en croyant se gratter la tête: "De la même façon, tout désir pour qui que ce fût du monde réel avait entièrement disparu, comme si sa libido lui avait été confisquée par l'évaporation de son inconnue, et par l'attente désormais illusoire de sa réapparition." Reinhardt aurait pu écrire: "Il ne bandait plus pour personne depuis qu'elle était partie et n'était pas prête de revenir", mais non, c'eût été trop facile, et il est quand même plus fanfreluchant d'imaginer qu'une évaporation puisse confisquer une libido, même si, d'un point de vue chimique, la chose est assez improbable.
A lire le nouveau livre d'Eric Reinhardt, Comédies françaises, on a la gênante impression que l'art romanesque s'est arrêté en 1920, a dormi pendant cent ans d'un sommeil repu et légèrement hébété, puis, sans doute dérangé par un bruit de vaisselle inopiné, s'est réveillé pour reprendre son cours tranquille, sans trop lever le nez de l'assiette de son oreiller. Bien que né de la dernière pluie, et comme elle susceptible de tricoter quelques jolis arc en ciel dès que s'ébroue le soleil du style, Reinhardt sait à peu près tout faire avec une phrase, sauf bien sûr nous convaincre de sa nécessité. Il a le chic pour trousser des phrases brèves comme des alexandrins coupés en deux par une serpette poétique: "Dehors, la nuit, à peine." (p.19) Mais il sait aussi imiter les Inconnus et leur tube "Et vice versa" dans de longues séquences où le sens affamé se mord la queue en croyant se gratter la tête: "De la même façon, tout désir pour qui que ce fût du monde réel avait entièrement disparu, comme si sa libido lui avait été confisquée par l'évaporation de son inconnue, et par l'attente désormais illusoire de sa réapparition." Reinhardt aurait pu écrire: "Il ne bandait plus pour personne depuis qu'elle était partie et n'était pas prête de revenir", mais non, c'eût été trop facile, et il est quand même plus fanfreluchant d'imaginer qu'une évaporation puisse confisquer une libido, même si, d'un point de vue chimique, la chose est assez improbable.Quand on n'a rien dire, et encore moins à écrire, le mieux est de pratiquer le délayage extensif. De mouliner ad nauseam. N'importe quelle situation (ouvrir une porte, s'asseoir sur un tabouret…) peut donner lieu à un passage anthologique pour peu qu'on fasse mousser la syntaxe. Evidemment, cela ne met pas à l'abri du ridicule, il est même possible que cela favorise sa pousse: "Il était resté invisible, aussi insignifiant que les zébrures d'un passage piéton. Et encore! Les zébrures, même si on ne les regarde pas, on les voit!" Ici, le point d'exclamation joue le rôle d'un coup de coude donné à soi-même, ce qui exige une certaine souplesse acrobatique, certes, mais donne l'impression d'un auteur qui se lâche, se relit, et se commente ironiquement pour faire passer la pilule de son inanité.
Pour Reinhardt, écrire consiste souvent à dire deux fois les choses, ce qui lui permet d'arriver à 476 pages, avantage non négligeable. "Saint-Maurice n'était pas seulement une ville très peu connue, dont généralement personne n'avait même jamais entendu parler […]" (p. 60). Un peu plus imaginatif qu'un Jean Dutourd, plus discrètement ampoulé qu'un Florian Zeller, sans doute travaillé par d'inavouées pulsions lagardo-michardiennes, Reinhardt sait attifer le banal pour le rendre plus seyant: "Aucun autre lieu que la salle de spectacle, à part peut-être le lit, le lit où l'on rêve, le lit où l'on fait l'amour, le lit où l'on accouche, le lit où l'on est malade et le lit où l'on meurt (mais dans le lit il n'y a pas d'art, juste de l'humain), aucun autre lieu que la salle de spectacle nous fait mieux saisir ce que c'est que la vie, que d'être en vie, que d'être un être humain […]." Et le lit où l'on fait des listes? Il aurait pu quand même mentionner le lit où l'on ronfle.
Ah, j'allais oublier les sensations. Pour l'auteur de Comédies françaises, la sensation est précieuse, car elle permet d'allonger la sauce à défaut de lui donner du goût: "La joie affluait dans sa gorge, et jusque dans sa bouche, en provenance de son plexus solaire embrasé, et imprégnait son haleine d'un arrière-goût de fraise, de fer brûlé, et de noisettes […]." Ah, remugle, que de crimes on commet en ton nom… Ceci dit, qu'espérer d'un personnage qui "vivait la queue de la comète de sa glaçante déréliction", qu'excite "la foudroyante instantanéité du rapprochement charnel" ? Qu'attendre d'un paragraphe qui commence par ce douteux octosyllabe: "Il faut faire savoir les choses."
Bref, si vous aimez les romans secoués par une irrépressible pulsion syntaxico-masturbatoire, si vous êtes en mesure de vous "laisser submerger par le désenchantement", si vous aussi trouvez qu'il n'y a rien "de plus poétique, dans une ville, que la rue, c'est-à-dire la distinction entre la voie et le trottoir", n'hésitez pas. Avec Reinhard, vous allez faire un sacré voyage au pays "des magnifiques remous de la vie". Allez, bonne chance!
________________________Eric Reinhardt, Comédies françaises, Gallimard, 22 € – à (dis)paraître le 20 août
July 7, 2020
Dépecer le lecteur (et l'exténuer de saveurs inacceptables) — sur Cédric Demangeot (1)

"Ce n'est pas à son vers plus ou moins long qu'on flaire le poète ou qu'on le reconnaît. C'est à la façon – forcément seule – dont la page qu'il a salie sue du vrai ou pas. C'est une odeur qui ne trompe pas."Cette phrase de l'écrivain Cédric Demangeot, on est plus que tenté de l'appliquer à son travail de sape et d'éclat. Mais encore faudrait-il définir ce dangereux "suer du vrai". S'agit-il d'une sensation ressentie à la lecture, du fruit d'un labeur assigné à la page? Dans le cas de Demangeot, la réponse va de soi, ou plutôt elle part du soi, dilacérant ce qu'il en reste pour mieux déraciner au passage les frêles fables du langage. A le lire, on pense très vite à Artaud, non que Demangeot soit dans l'imitation ou la vénération de ce dernier, mais il y a quelque chose, dans sa préhension intransigeante des mots-douleur, dans son décapage des rythmes, ses amputations de vers et son choix toujours cinglant d'un terme-totem, qui font qu'on s'aventure avec lui dans un paysage-panique à la hauteur (tonale) de Suppôts et Suppliciations, et qu'on apprend à choir différemment dans ce terrible "trou d'être" – dont parle dans Parafe le poète Auxeméry.
Pour entrer dans la poésie de Demangeot, il faut lire Une inquiétude , recueil de textes écrits entre 1999 et 2012, soit treize années consacrées à l'élaboration d'un "baroque intérieur", expression qui dit assez à quelles torsions Demangeot se voue. La première partie d'Une inquiétude, sommairement intitulée "marges", pourrait passer, à première et rapide vue, pour une suite d'aphorismes, de réflexions forgée, pensées jetées:"les hommes sont mal compatibles", … "on m'a mal nettoyé", … "on m'a coupé la tête — c'est noté. Malheureusement, il reste la langue", mais très vite le lecteur comprend qu'il s'agit, pour reprendre des expressions issues de Michaux, d'épreuves-exorcismes visant à une connaissance par les gouffres. Au prix d'une sincérité baudelairienne, Demangeot met son cœur-barbaque à nu, dévoilant ainsi par le déchirement ce qu'est sa poétique intempestive. Qu'il exige qu'on lise Tortel, encense Turner ou démolisse Ponge, qu'il fasse état de ses inaptitudes et ses détestations, c'est toujours hanté-cahoté par une exigence qui, ne regardant que lui, finit par forer son regard en nous— et là, on ne peut que citer ce passage absolu et nécessaire qui remet les choses à leur place impossible :
"Il faut désoler, dépecer le lecteur. Le traîner dans la boue de sa vie qu'il ne connaît pas. Le traîner dans les morts, dans la cendre du jour, dans les riens du vrai. Il faut le passer au crible de son propre mal. Il faut l'inquiéter, l'enduire de terre soir et matin, l'exténuer de saveurs inacceptables. Il faut le haïr comme un frère, le torturer jusqu'à ce qu'il se reconnaisse un corps et qu'il se fasse enfin la violence de vivre à une plus haute intensité que celle qu'il est habituellement capable de supporter. Alors le livre peut être refermé et même jeté: il aura fécondé, plus qu'il ne pouvait."Qu'on n'aille pas imaginer que le vers de Demangeot, aussi rongé cassé fibré soit-il, se laisse aller à quelque complaisance que ce soit. Les images qu'il pétrit et concentre accèdent très vite – bardo-staccato– à une réalité sonore et sidérante:
"Ou: sirène harnachée druCe sont là fleurs du mal d'une espèce menaçante. La poésie-demangeot, sans doute attenante à d'intimes charniers, et aussi jaculatoire qu'elle soit, reste dépourvue de toute visée édifiante. Morale noire, donc atroce. Si chacune de ses pages se besogne pour "suer du vrai", c'est parce qu'il n'a pas peur de piétiner ses souffrances intimes pour – du douloureux compost par ce piétinement produit – extraire, brin mâché après brin mâché, une "épopée de l'impuissance". Semblable à un Franck Venaille qu'on aurait plongé dans l'acide de la déréliction, Demangeot ne laisse jamais sa déliquescence intime appauvrir son lexique incandescent, il tient bon dans la chute et mord la disparition de son être sans état d'âme. Entier quoique morcelé à chaque page, il imprime à ses vers furioso une intensité bouleversante, propre à retourner les défunts :
à la mâture et qu'on déchire
entière du flanc blanc jusqu'à
la base éboussolée de l'œil
avec un soin de poissonnier
pour en jeter le résidu
dans la saumure des sargasses"
"Laideur des longs travaux de mortTrivial parce qu'attaché au temps sale du corps, cynique à la mesure d'une déjà-mort-déjà-œuvrante, géométrique dans son décompte de nos crasses vanités, cet écrivain convulsif et précis qui sait plier le simple pour en extraire du composite, fier orphelin de Walser, Musil et Bernhard, est la hache la plus impitoyable dont nous ayons besoin pour briser en nous, en la farce qu'est notre nous, l'immensité de toute mer gelée.
dans le bas-ventre creux des fils."
___________________-
Cédric Demangeot, Une inquiétude, coll. Poésie/Flammarion dirigée par Yves di Manno, 2013
De la gorge en poésie
 Avant de risquer la mort sur la page, le poème vit son limbe entre sang et souffle. Sang: donc pulsation, tempo. Souffle: épreuve du vide. Bernard Noël, dans La chute des temps : "la voix ne ressemble à rien / elle est le tremblement de la chair molle / sa fragilité faite invisible / l'homme s'oublie dans cette fumée d'air / il imagine et voit l'imaginé / il est une fois / desserre ta gorge / une goulée de temps est douce / dans le tombeau suinte une source". Une goulée de temp: chaque contraction de la glotte libère des unités de langage.
Avant de risquer la mort sur la page, le poème vit son limbe entre sang et souffle. Sang: donc pulsation, tempo. Souffle: épreuve du vide. Bernard Noël, dans La chute des temps : "la voix ne ressemble à rien / elle est le tremblement de la chair molle / sa fragilité faite invisible / l'homme s'oublie dans cette fumée d'air / il imagine et voit l'imaginé / il est une fois / desserre ta gorge / une goulée de temps est douce / dans le tombeau suinte une source". Une goulée de temp: chaque contraction de la glotte libère des unités de langage.Maîtrise et sauvagerie, afin d'autrement éructer. Tenir l'avant-note, "jusqu'à ce que la syntaxe vive du réel" – écrit Auxeméry dans Parafe – "inscrive / & les figures & les voix (…) // dans le boyau de glaise, de la brèche / vers la fosse, dans la gorge qui engendre, & passant / de l'obscur vers l'obscur, traverse / la plage de lumière". Si naguère la bouche était d'ombre, on comprend que la gorge, elle, soit de nuit, de la nuit, qu'elle n'ait d'autre choix que de faire l'épreuve du "gratte-glotte" (Auxeméry, dans Failles).
 © Cédric DemangeotLa gorge, on l'a dit, est passage, et parce que liée au souffle, elle a accointance avec le vide. La possibilité du poème est indissociable du silence, et le vide est la forme que prend le silence dans le corps du poème. Le poème naît avec ses poches de vide, il les met en scène. Cédric Demangeot: "Le vers est ce qui se produit à chaque fois que le corps entrave le trajet de la langue – à chaque fois que la langue trébuche sur le corps – et le poème est le son de la chute ensemble de ces deux morceaux que l'Histoire a séparés" (in Une inquiétude). L'entrave, le trébuchement: c'est ce qui fait qu'un poème vit de ses crevasses, vit parmi les trous. Un enjambement est, littéralement, un enjambement. Le corps passe par dessus son propre vide, il casse le souffle pour mieux l'articuler, et lancer la langue plus loin.
© Cédric DemangeotLa gorge, on l'a dit, est passage, et parce que liée au souffle, elle a accointance avec le vide. La possibilité du poème est indissociable du silence, et le vide est la forme que prend le silence dans le corps du poème. Le poème naît avec ses poches de vide, il les met en scène. Cédric Demangeot: "Le vers est ce qui se produit à chaque fois que le corps entrave le trajet de la langue – à chaque fois que la langue trébuche sur le corps – et le poème est le son de la chute ensemble de ces deux morceaux que l'Histoire a séparés" (in Une inquiétude). L'entrave, le trébuchement: c'est ce qui fait qu'un poème vit de ses crevasses, vit parmi les trous. Un enjambement est, littéralement, un enjambement. Le corps passe par dessus son propre vide, il casse le souffle pour mieux l'articuler, et lancer la langue plus loin._______________Biblio:Claude Adelen, Légendaire (1969-2005), Flammarion, 2009 (le texte ici cité figure dans le recueil Légendaire, paru en 1977)Bernard Noël, La chute des temps, Flammarion, 1983Jean Paul Auxeméry, Parafe, Flammarion, 1994Auxeméry, Failles / traces, Flammarion, 2017Cédric Demangeot, Une inquiétude (1999-2012) Flammarion, 2013
June 30, 2020
Du déboulonnage en général (et des généraux)
 Pourquoi toute cette levée de boucliers devant d’éventuels déboulonnages ou badigeonnages de statues ? Bon, je pense que tout le monde serait d’accord pour ne pas laisser en place une statue de Hitler devant le Crillon s’il y en avait une (autant se débarrasser direct du point Godwin…) Et personne n'a trouvé scandaleux de mettre à bas les statues de Staline. En revanche, telle autre statue d’un type ayant sûrement accompli quelque chose de chouette ou d'important mais ayant par ailleurs proféré de belles horreurs ou de tristes conneries semble mériter de trôner au vu et au su de tous et toutes. La raison : il est dans le camp des gentils (l'Histoire a tranché…), et on ne va pas le descendre de son podium de pierre sous prétexte qu’il a dit une connerie ou même fait une connerie (mais comme dire c'est faire…).
Pourquoi toute cette levée de boucliers devant d’éventuels déboulonnages ou badigeonnages de statues ? Bon, je pense que tout le monde serait d’accord pour ne pas laisser en place une statue de Hitler devant le Crillon s’il y en avait une (autant se débarrasser direct du point Godwin…) Et personne n'a trouvé scandaleux de mettre à bas les statues de Staline. En revanche, telle autre statue d’un type ayant sûrement accompli quelque chose de chouette ou d'important mais ayant par ailleurs proféré de belles horreurs ou de tristes conneries semble mériter de trôner au vu et au su de tous et toutes. La raison : il est dans le camp des gentils (l'Histoire a tranché…), et on ne va pas le descendre de son podium de pierre sous prétexte qu’il a dit une connerie ou même fait une connerie (mais comme dire c'est faire…).Bref, on entrevoit le fond du problème : ce n’est pas la décision de statufier tel ou tel grand homme (ou telle ou telle grande femme, mais là c'est plus rare, bizarre…), non, le problème, c’est de statufier. Autrement dit d’honorer de façon durable (ou d’une façon qui imite le durable) qui que ce soit, étant admis que qui que ce soit n’est jamais pur à cent pour cent. D’où le paradoxe que rencontrent nos sociétés, qui adorent honorer, et ce pour la bonne raison que l’honneur a l’avantage de « grandir » la personne honorée et de nier ses côtés puants.
Que voit-on? Eh bien, dès qu’on touche à un « honoré », les belles âmes poussent des hauts cris, non parce qu’elles ignorent que ledit honoré était pas tout blanc (encore que…), mais parce qu’on touche à la notion d’honneur, et qu’elles tiennent à cette notion par dessus tout, car elle vaut blanchiment. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d’un moment, la statue ne célèbre plus la mémoire d’un grand homme, mais l'amnistie d'éventuelles fautes par le déni. La statue est rarement ambiguë. On aurait du mal à imaginer une statue de Céline tenant dans une main une plume et dans l’autre une caricature de juif (re-bonjour Godwin). De même, une statue honnête de Chirac devrait le montrer se boucher le nez devant un petit Arabe dont il caresserait bien sûr la tête. Compliqué. Les partisans du déboulonnage, bizarrement, sont considérés comme des effaceurs de mémoire, alors que ce sont les pro-statues qui, si l'on y réfléchit bien, font acte d’amnésie (volontaire ou pas).
N’est-il pas temps de se demander si la statuaire ne serait pas, comme les pyramides, non seulement un art du passé, mais une stratégie visant à nous faire croire qu’il y a des hommes cent pour cent honorables ? Evidemment, si on déboulonne les statues, si on change les noms de rues, on enclenche probablement un processus traumatique. Bien sûr, in fine, tout ça est sûrement à rattacher au fameux débat : faut-il distinguer l’homme de l’œuvre. Débat qui renvoie la notion d’honneur à ce qu’elle est, à savoir ni plus ni moins un coup de force. Je célèbre donc j’absous…
Christophe Claro's Blog
- Christophe Claro's profile
- 12 followers