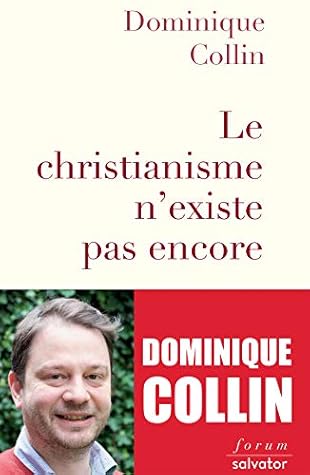Kindle Notes & Highlights
Au point qu’il serait plus juste de dire, comme Péguy déjà l’avait deviné, que nous sommes devenus « inchrétiens » plutôt que « postchrétiens ». Péguy ajoutait que, puisque l’« inchrétien » se situe totalement en-dehors du christianisme, il ne peut pas y rentrer… Revenant
Parce que Kierkegaard jugeait qu’un christianisme sans Évangile n’est qu’un simulacre inventé par les chrétiens eux-mêmes pour n’avoir pas à conformer leur vie à la parole du Christ.
En ce sens, et en attente d’approfondissements ultérieurs, l’Évangile n’est pas le message fondateur d’une tradition religieuse particulière (ici, le christianisme) possédant ses croyances et ses normes (rituelles ou morales) qu’une qualité de la parole elle-même quand elle s’adresse à quelqu’un pour lui dire qu’il est possible d’exister autrement.
C’est pourquoi je tente ici d’écrire une espérance : non seulement l’avenir du christianisme n’est pas écrit, mais son avenir n’est pas à la mesure de son passé puisqu’il n’existe pas… encore.
Malgré leurs généreuses intentions, un certain nombre d’entreprises « pastorales » oublient ce que Péguy disait : « L’inchrétien ne peut pas rentrer dans le christianisme.
Avec Kierkegaard il est possible de penser que l’inexistance du christianisme permet bien mieux d’espérer en la possibilité de son avènement que la restauration d’une chrétienté chimérique. (Encore faut-il comprendre que si le monde n’est plus chrétien, c’est peut-être parce qu’il ne l’a jamais été…)
Nous ne savons plus très bien ce qu’est la foi parce que nous l’avons remplacée par un assentiment plus ou moins convaincu à une doctrine ou ce que nous appelons, sans conviction, la spiritualité ou, plus paresseusement encore, la recherche de sens.
Alors, s’il nous faut penser l’inexistance du christianisme, ce n’est pas pour hâter son effondrement, ni pour convaincre qu’il vaudrait mieux s’en passer (comme si le christianisme devait être dépassé et remplacé par une « sagesse » ou un « humanisme » d’inspiration chrétienne) mais pour faire grandir notre foi en ses ressources infinies, ressources que ne lui offrent ni son histoire, ni sa doctrine, ni son organisation planétaire, ni même le pape mais les opérations mêmes qui rendent possibles pour quelqu’un d’exister enfin : croire, aimer et espérer.
Le christianisme d’appartenance est un prête-nom et un malentendu.
Une tradition monumentale, voilà ce qui définit peut-être le mieux un christianisme d’appartenance. Les monuments de pierre que sont les églises ou les temples ainsi que l’accumulation des œuvres produites par tant de siècles « chrétiens » font facilement croire que le christianisme est un phénomène religieux et culturel qui satisfait à l’idée que l’on se fait d’une religion.
Si le Christ n’est pas le fondateur du christianisme, il en est la fondation vivante en
Être chrétien, c’est croire en la possibilité que l’événement ouvert par la parole de l’Évangile puisse aussi devenir un événement pour moi.
Si nous ne connaissons un événement que parce qu’il nous arrive, de même nous ne connaissons le Christ que par la foi et non par l’histoire (qui, à la limite, ne peut atteindre qu’un certain Jésus de Nazareth, dont, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose…), pas plus que par tradition et encore moins par naissance.
tout cela est inutile pour la foi vivante, vraie et simple, au meilleur sens du terme, car son moteur n’est pas la curiosité, mais la soif ».
il faut penser que l’amour réitère le passé plus qu’il ne le conserve.
Le mythe est tenace mais le Nouveau Testament témoigne que les premiers chrétiens vivaient, non pas dans l’attente de la fin des temps, mais dans l’urgence que commande le temps de la fin, c’est-à-dire le temps qui met un point final à toute autre manière de vivre le temps qui ne serait pas attente du Christ et de son Évangile.
Le malheur du christianisme fut justement de perdre cette conscience de vivre dans le temps de la fin et de s’installer dans le temps de la succession, le temps linéaire, le temps compté, le temps qui lutte pour sa survie en cherchant à s’immortaliser dans le dur (les églises) et dans la durée (la tradition).
Ils sont déçus parce que le christianisme actuel ne correspond pas, ou trop peu ou trop mal, à l’étalon temporel grâce auquel ils jugent le christianisme authentique. Aux yeux des conservateurs, le christianisme actuel s’est fourvoyé en pactisant avec la modernité triomphante ; pour les progressistes, au contraire, le christianisme actuel déçoit par sa frilosité et son incapacité à s’adapter à cette même modernité.
Je pense que l’histoire oblige aujourd’hui le christianisme à penser pour lui-même ce que jusqu’ici il annonçait plutôt aux autres. »
Mais puisque la christianité nous est encore largement énigmatique (car, comme nous le verrons, invraisemblable et impossible), il faut la penser comme toujours à venir, encore inimaginable et désirable, comme le Royaume dont elle est l’autre nom.
En effet, l’Évangile met en échec le besoin de convaincre car on ne peut faire triompher la douceur avec les armes de la violence. Tout prosélyte est narcissique : il veut faire croire en la supériorité de sa cause. En revanche, celui qui suit la Voie aborde la rencontre avec cette présupposition : que l’autre est peut-être plus proche du Royaume que lui-même…
Une première exigence apparaît alors : le christianisme n’existe que d’être la proclamation de l’Évangile. Cela devrait aller de soi, pourtant non.
Ce qui revient à émettre cette hypothèse : la parole chrétienne, quand bien même serait-elle conforme à ce que dit l’Évangile (laissons pour l’instant la question de savoir ce qu’il dit), ne répond pas nécessairement à l’exigence d’être annoncée comme Évangile, c’est-à-dire comme son étymologie nous l’indique, à la manière d’une « heureuse nouvelle » ou, comme j’aime à le traduire, d’une « parole d’encouragement ». Pour
Commençons par dire que la parole dysangélique prive le christianisme de toute possibilité d’à-venir. Elle le nie donc en rendant sa signification impossible (au sens strictement négatif).
Une vraie trahison est moins une opposition qu’une correction (en ce sens, Judas est le disciple le plus « proche » du Christ) : le christianisme ne s’oppose pas à l’Évangile mais le voudrait plus accordé à son désir.
Qu’est-ce que ces paroles difficiles à entendre signifient sinon que l’Évangile ne devient une heureuse nouvelle que pour celui qui ose se déprendre de lui-même, celui qui abandonne la sécurité que lui offrent le vraisemblable et le possible, qui ose tourner le dos au moi qu’il est pour oser s’aventurer en direction du soi qu’il pourrait devenir (non pas en puissance ou potentiel mais comme possible). Le moi : l’illusion qui me fait croire que je suis quelqu’un. Le soi : qui je suis en vérité et qui, pour cette raison, n’existe pas… encore.
Évitons un contre-sens : la bondieuserie dont il sera ici question ne vise pas ce qu’on appelle les dévotions dites « populaires », comme le chapelet ou les pèlerinages, mais une forme de religiosité narcissique qui peut très bien coexister à l’intérieur de tout chrétien.
Seule la foi en la Résurrection fonde le sens de notre existence singulière, sans laquelle la vie ne serait que la vie et la mort n’en serait que la négation.
Par cette parole « impossible », le Christ nous fait passer de l’identité (le moi égale ses possibilités ; l’homme est ce qu’il fait) à l’altérité (devenir soi est impossible pour le moi sinon par la grâce de l’Autre).
Or, l’amour de Dieu se révèle à ce qu’il aime le non-aimable. Et le signe que cet amour a été accueilli comme justification première de l’existence n’est autre que l’amour du prochain qui, d’étranger qu’il nous apparaît d’abord, devient un frère.
Nous verrons que le langage de la bondieuserie n’est que « mépris de la grâce et de son lent travail », comme le disait Péguy.
Ou encore : le christianisme d’appartenance est, sans vouloir forcer sur le jeu de mots, l’accusé de déception qu’il oppose à l’Évangile.
Le christianisme d’appartenance reste malgré tout en rapport à l’Évangile, quand bien même il en serait la trahison : en effet, par la déception qu’il s’applique à compenser, il prouve que l’Évangile n’est pas son produit.
La croyance apaise la déception en fabriquant un imaginaire plus incroyable que le réel décevant tandis que la foi accentue la déception afin de l’ouvrir à ce dont le désir déçu ne s’attendait même pas.
Autrement dit, le chrétien ne semble plus très bien savoir ce qu’il entend par croire ; d’autant qu’il est pris entre un conservatisme qui sait qu’il croit et un progressisme qui croit qu’il sait.
Essentiellement ceci : le Crucifié-Relevé, relevé en tant que Crucifié, est la figure de la déception vivante qui met en échec le besoin pour les êtres humains de se donner un messie qui leur épargnerait la dureté du réel.
En un sens, la foi commence quand tout espoir mondain est perdu.
L’idée de messianisme recouvre ainsi une croyance en ce moi qui ne veut pas mourir, tout en le maintenant dans la même temporalité que la vie mortelle
La Résurrection n’est pas la revanche du Christ sur ses persécuteurs (de quel droit alors aurait-il pu nous inviter à aimer nos ennemis et à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal ?), mais le sens toujours actuel du pardon donné d’avance.
Qu’on en juge : toutes ces manières de parler discréditent la foi pour rendre nos adhésions plus compatibles avec nos humaines attentes et donc moins décevantes.
Une foi déçue est une croyance qui accuse.
La croyance voudrait un réel qui soit autre ; la foi nous y fait vivre, autrement.
Jésus n’interroge pas Marthe comme le catéchisme enseignait jadis les enfants. Jésus s’adresse à quelqu’un pour l’inviter à répondre de lui-même (à répondre de ce qui le concerne) tandis que le catéchisme vérifie qu’une croyance a bien été assimilée, quelle que soit la personne à qui il est enseigné.
Comme d’autres religions (et il faut ajouter les religions « profanes » comme le communisme), le christianisme a été tenté de s’imposer, de considérer ses opinions plus vraies que celles des autres, de prétendre à l’universel tout en faisant de l’impérialisme. En revanche, la foi comme langage invite à la liberté : « Et toi, crois-tu cela
Fondamentalement, la croyance est calcul : elle mise sur elle-même pour remporter un bénéfice.
La modernité est née de ce divorce dont nous payons toujours les pots cassés : d’un côté, la croyance se confond désormais avec la bondieuserie, n’alimente plus que les besoins religieux des individus ou sert de caution à l’ordre moral ; de l’autre, la raison, fière de sa légitimité et de sa puissance, assujettit la nature et l’histoire à la domination de l’homme.
Jusqu’à rendre possible l’athéisme (en ce sens, l’athéisme est le produit d’un christianisme sans foi).
C’est ainsi que la croyance conduit nécessairement soit à l’incrédulité (une croyance sans preuve est en péril), soit à la crédulité (le minimum de vraisemblance, à commencer par l’utilité vraisemblable qu’on peut tirer de l’incroyable).
Mais un christianisme qui serait partagé entre incrédulité et crédulité, n’aurait rien en commun avec l’Évangile. Car l’Évangile est fiable uniquement parce qu’il est promesse de vie bonne (une telle une promesse ne se soutient que d’être tenue par celui qui est le « Vivant » et vérifiée dans la manière dont elle change la vie) ; il n’est pas ce catéchisme de croyances toutes plus incroyables les unes que les autres. « Faites confiance à l’Évangile » : telle est la parole inaugurale du Christ dans l’évangile de Marc.
D’ailleurs, nous trouvons dans l’évangile de Marc la formule même de l’acte de foi quand le père qui demande à Jésus de venir en aide à sa foi s’écrie : « Je crois, viens en aide à ma non-foi » (littéralement, Marc parle de non-foi, apistia, et non, comme dans la plupart des traductions qui édulcorent, de « peu de foi »).