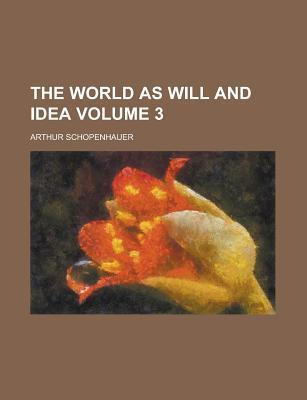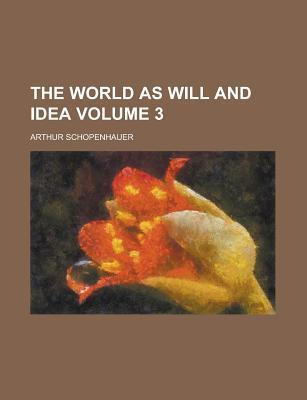Sans nous lasser, nous courons de désir en désir ; en vain chaque satisfaction obtenue, en dépit de ce qu’elle promettait ne nous satisfait point, le plus souvent ne nous laisse que le souvenir d’une erreur honteuse ; nous continuions à ne pas comprendre, et nous voilà à poursuivre encore de nouveaux désirs.
Et cela va toujours ainsi, à l’infini, à moins, chose plus rare, et qui déjà réclame quelque force de caractère, à moins que nous ne nous trouvions en face d’un désir que nous ne pouvons ni satisfaire ni abandonner ; alors nous avons ce que nous cherchions, un objet que nous puissions en tout instant accuser, à la place de notre propre essence, d’être la source de nos misères ; dès lors, nous sommes en querelle avec notre destinée, mais réconciliés avec notre existence même, plus éloignés que jamais de reconnaître que cette existence même a pour essence la douleur, et qu’un vrai contentement est chose impossible.
De toute cette suite de réflexions naît une humeur un peu mélancolique, l’air d’un homme qui vit avec un seul grand chagrin, et qui dès lors dédaigne le reste, petites douleurs et petits plaisirs ; c’est déjà un état plus noble, que cette chasse perpétuelle à des fantômes toujours changeants, qui est l’occupation de la plupart.
La satisfaction, le bonheur, comme l’appellent les hommes, n’est au propre et dans son essence rien que de négatif ; en elle, rien de positif. Il n’y a pas de satisfaction qui d’elle-même et comme de son propre mouvement vienne à nous ; il faut qu’elle soit la satisfaction d’un désir. Le désir, en effet, la privation, est la condition préliminaire de toute jouissance. Or avec la satisfaction cesse le désir, et par conséquent la jouissance aussi. Donc la satisfaction, le contentement, ne sauraient être qu’une délivrance à l’égard d’une douleur, d’un besoin ; sous ce nom, il ne faut pas entendre en effet seulement la souffrance effective, visible, mais toute espèce de désir qui, par son importunité, trouble notre repos, et même cet ennui, qui tue, qui nous fait de l’existence un fardeau.
Maintenant, c’est une entreprise difficile d’obtenir, de conquérir un bien quelconque ; pas d’objet qui ne soit séparé de nous par des difficultés, des travaux sans fin ; sur la route, à chaque pas, surgissent des obstacles. Et la conquête une fois faite, l’objet atteint, qu’a-t-on gagné ? rien assurément, que de s’être délivré de quelque souffrance, de quelque désir, d’être revenu à l’état où l’on se trouvait avant l’apparition de ce désir.
Le fait immédiat pour nous, c’est le besoin tout seul, c’est-à-dire la douleur. Pour la satisfaction et la jouissance, nous ne pouvons les connaître qu’indirectement ; il nous faut faire appel au souvenir de la souffrance, de la privation passées, qu’elles ont chassées tout d’abord. Voilà pourquoi les biens, les avantages qui sont actuellement en notre possession, nous n’en avons pas une vraie conscience, nous ne les apprécions pas ; il nous semble qu’il n’en pouvait être autrement ; et en effet, tout le bonheur qu’ils nous donnent, c’est d’écarter de nous certaines souffrances. Il faut les perdre, pour en sentir le prix ; le manque, la privation, la douleur, voilà la chose positive, et qui sans intermédiaire s’offre à nous.
Telle est encore la raison qui nous rend si douce la mémoire des malheurs surmontés par nous : besoin, maladie, privation, etc. ; c’est en effet notre seul moyen de jouir des biens présents. Ce qu’on ne saurait méconnaître non plus, c’est qu’en raisonnant ainsi, en égoïste (l’égoïsme, au reste, est la forme même de la volonté de vivre), nous goûtons une satisfaction, un plaisir, du même ordre, au spectacle ou à la peinture des douleurs d’autrui.
Tout bonheur est négatif, sans rien de positif ; nulle satisfaction, nul contentement, par suite, ne peut être de durée ; au fond ils ne sont que la cessation d’une douleur ou d’une privation, et, pour remplacer ces dernières, ce qui viendra sera infailliblement ou une peine nouvelle, ou bien quelque langueur, une attente sans objet, l’ennui.
la vie humaine, comme tout phénomène, n’en est qu’une manifestation, –se réduit à un effort sans but, sans fin. Ce caractère d’infinité, on le retrouve sur tous les points de cet univers où elle s’exprime ; à commencer par les formes les plus générales de la réalité visible, l’espace et le temps sans bornes, et jusqu’à la plus achevée de ses manifestations, la vie, l’effort humain.
on a peine à croire à quel point est insignifiante, vide de sens, aux yeux du spectateur étranger, à quel point stupide et irréfléchie, de la part de l’acteur lui-même, l’existence que coulent la plupart des hommes ; une attente sotte, des souffrances ineptes, une marche titubante, à travers les quatre âges de la vie, jusqu’à ce terme, la mort, en compagnie d’une procession d’idées triviales.
Voilà les hommes : des horloges ; une fois monté, cela marche sans savoir pourquoi ; à chaque conception, à chaque engendrement, c’est l’horloge de la vie humaine qui se remonte, pour reprendre sa petite ritournelle, déjà répétée une infinité de fois, phrase par phrase, mesure par mesure, avec des variations insignifiantes.
Un individu, un visage humain, une vie humaine, cela n’est qu’un rêve très court de l’esprit infini qui anime la nature, de cette opiniâtre volonté de vivre, une image fugitive de plus, qu’en jouant elle esquisse sur sa toile sans fin, l’espace et le temps, pour l’y laisser durant un moment, –moment qui, au regard de ces deux immensités, est un zéro, –puis l’effacer et faire ainsi place à d’autres. Pourtant, et c’est là dans la vie ce qui est fait pour donner à réfléchir, chacune de ces esquisses d’un moment, chacune de ces boutades se paie ; la volonté de vivre dans toute sa fureur, des souffrances sans nombre, sans mesure, puis au bout un dénouement longtemps redouté, inévitable enfin, cette chose amère, la mort, voilà ce qu’elle coûte. Et voilà pourquoi le seul aspect d’un cadavre nous rend si brusquement sérieux.
La vie de chacun de nous, à l’embrasser dans son ensemble d’un coup d’œil, à n’en considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie ; mais quand il faut, pas à pas, l’épuiser en détail, elle prend la tournure d’une comédie. Chaque jour apporte son travail, son souci ; chaque instant, sa duperie nouvelle ; chaque semaine, son désir, sa crainte ; chaque heure, ses désappointements, car le hasard est là, toujours aux aguets pour faire quelque malice ; pures scènes comiques que tout cela.
Mais les souhaits jamais exaucés, la peine toujours dépensée en vain, les espérances brisées par un destin impitoyable, les mécomptes cruels qui composent la vie entière, la souffrance qui va grandissant, et, à l’extrémité du tout, la mort, en voilà assez pour faire une tragédie.
On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture par la dérision ; elle y met toutes les douleurs de la tragédie ; mais, pour ne pas nous laisser au moins la dignité du personnage tragique, elle nous réduit, dans les détails de la vie, au rôle du bouffon.
Toutefois, si empressés que soient les soucis, petits et grands, à remplir la vie, à nous tenir tous en haleine, en mouvement, ils ne réussissent point à dissimuler l’insuffisance de la vie à remplir une âme, ni le vide et la platitude de l’existence, non plus qu’ils n’arrivent à chasser l’ennui, toujours aux aguets pour occuper le moindre vide laissé par le souci.
De là vient que l’esprit de l’homme, n’ayant pas encore assez des soucis, des chagrins et des occupations que lui fournit le monde réel, se fait encore de mille superstitions diverses un monde imaginaire, s’arrange pour que ce monde lui donne cent maux et absorbe toutes ses forces, au moindre répit que lui laisse la réalité ; car ce répit, il n’en saurait jouir.
L’homme se fabrique, à sa ressemblance, des démons, des dieux, des saints ; puis il leur faut offrir sans cesse sacrifices, prières, ornements pour leurs temples, vœux, accomplissements de vœux, pèlerinages, hommages, parures pour leurs statues, et le reste. Le service de ces êtres s’entremêle perpétuellement à la vie réelle, l’éclipse même ; chaque événement devient un effet de l’action de ces êtres ; le commerce qu’on entretient avec eux remplit la moitié de la vie, nourrit en nous l’espérance, et, par les illusions qu’il suscite, nous devient parfois plus intéressant que le commerce des êtres réels.
C’est là l’effet et le symptôme d’un besoin vrai de l’homme, besoin de secours et d’assistance, besoin d’occupation pour abréger le temps ; sans doute souvent le résultat va directement contre le premier de ces besoins, puisque, en chaque conjoncture fâcheuse ou périlleuse, il nous fait consumer un temps et des ressources qui auraient leur emploi ailleurs, en prières et offrandes ; mais il n’en est que plus favorable à l’autre besoin, grâce à ce commerce fantastique avec un monde rêvé ; c’est là le bénéfice qu’on tire des superstitions, et il n’est pas à dédaigner.
Il suffit d’être sorti des rêves de la jeunesse, de tenir compte de l’expérience, de la sienne et de celle des autres, d’avoir appris à se mieux connaître, par la vie, par l’histoire du temps passé et du présent, par la lecture des grands poètes, et de n’avoir pas le jugement paralysé par des préjugés trop endurcis, pour se résumer les choses ainsi : le monde humain est le royaume du hasard et de l’erreur, qui y gouvernent tout sans pitié, les grandes choses et les petites ; à côté d’eux, le fouet en main, marchent la sottise et la malice ; aussi voit-on que toute bonne chose a peine à se faire jour, que rien de noble ni de sage n’arrive que bien rarement à se manifester, à se réaliser ou à se faire connaître ; qu’au contraire l’inepte et l’absurde en fait de pensée, le plat, le sans-goût en fait d’art, le mal et la perfidie en matière de conduite, dominent, sans être dépossédés, sauf par instants.
Et quant à la vie de l’individu, toute biographie est une pathographie ; car vivre, en règle générale, c’est épuiser une série de grands et petits malheurs ; chacun, d’ailleurs, cache de son mieux les siens, sachant bien qu’en les laissant voir il exciterait rarement la sympathie ou la pitié, et presque toujours la satisfaction ; n’est-on pas tout content de se voir représenter les maux dont on est épargné ?
Mais au fond, on ne trouverait peut-être pas un homme, parvenu à la fin de sa vie, à la fois réfléchi et sincère, pour souhaiter de la recommencer, et pour ne pas préférer de beaucoup un absolu néant. Au fond et en résumé, qu’y a-t-il dans le monologue universellement célèbre de Hamlet ? Ceci : notre état est si malheureux qu’un absolu non-être serait bien préférable. Si le suicide nous assurait le néant, si vraiment l’alternative nous était proposée « d’être ou ne pas être », alors oui, il faudrait choisir le non-être, et ce serait un dénouement digne de tous nos vœux (a consummation devoutly to be wish’d).
« Il n’est pas un homme à qui il ne soit arrivé plus d’une fois de souhaiter de n’avoir pas à vivre le lendemain. » En sorte que cette brièveté de la vie, dont on se plaint tant, serait encore ce que la vie a de mieux. Si l’on nous mettait sous les yeux à chacun les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l’épouvante nous saisirait ; prenez le plus endurci des optimistes, promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarets, les cabinets où les chirurgiens font des martyrs ; à travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à esclaves ; sur les champs de bataille, et sur les lieux d’exécution ; ouvrez-lui toutes les noires retraites où se cache la misère, fuyant les regards des curieux indifférents ; pour finir, faites-lui jeter un coup d’œil dans la prison d’Ugolin, dans la Tour de la Faim, il verra bien alors ce que c’est que son meilleur des mondes possibles.
Peut-être il en est de la vie comme de toutes les mauvaises étoffes ; tout le faux brillant est du côté de l’endroit ; ce qui est en piteux état est caché ; ce qui peut faire de l’effet, donner dans l’œil, on le met en montre, et plus on est loin de posséder le vrai contentement, plus on veut passer, dans l’opinion d’autrui, pour un homme heureux.
D’ailleurs, en dépit de tous ces mensonges, les souffrances peuvent s’accroître, et le fait est quotidien, jusqu’à nous faire souhaiter avec passion cette chose, la plus redoutée d’ordinaire, la mort.
D’ailleurs, en dépit de tous ces mensonges, les souffrances peuvent s’accroître, et le fait est quotidien, jusqu’à nous faire souhaiter avec passion cette chose, la plus redoutée d’ordinaire, la mort. Alors, quand le destin veut montrer tout ce qu’il peut, il ferme au malheureux jusqu’à cette issue, et, le jetant aux mains d’ennemis en furie, le tient là dans un atroce, un long martyre, sans ressource. Qu’il appelle maintenant, le pauvre supplicié, ses dieux à son secours ! Il reste en proie à sa destinée ; et la destinée ne fait pas grâce. Eh bien, cette situation de l’homme perdu sans ressource, c’est l’image même de notre impuissance à rejeter loin de nous la volonté, notre personne n’en étant que la réalisation objective.
Si une puissance étrangère est incapable de changer cette volonté ou de la supprimer, elle ne l’est pas moins de la délivrer de ses tourments ; ses tourments tiennent à l’essence de la vie, et la vie est la manifestation de la volonté. Toujours, en ce sujet capital comme en tout, l’homme se voit ramené à lui-même. En vain il se fabrique des dieux, pour les prier, pour leur soutirer des biens que seule l’énergie de son vouloir peut lui acquérir.
Si les sanyasis, les martyrs, les saints de toute confession et de tout nom, ont supporté volontiers, de bon cœur, leur martyre, c’est que chez eux la volonté de vivre s’était elle-même supprimée ; alors seulement la lente destruction de l’apparence revêtue par cette volonté pouvait leur paraître bienvenue.
l’optimisme, quand il n’est pas un pur verbiage dénué de sens, comme il arrive chez ces têtes plates, où pour tous hôtes logent des mots, est pire qu’une façon de penser absurde ; c’est une opinion réellement impie, une odieuse moquerie, en face des inexprimables douleurs de l’humanité. –Mais il ne faut pas aller croire que la foi chrétienne soit favorable à l’optimisme ; bien au contraire, dans les Évangiles, le monde et le mal sont pris quasi comme termes synonymes.
Le thème sur lequel la volonté, par ses actes divers, exécute des variations, c’est la pure satisfaction des besoins qui, en l’état de santé, résultent nécessairement de l’existence même du corps ; ce corps déjà les exprime ; et ils se ramènent à deux points : conservation de l’individu, propagation de l’espèce. C’est par rapport à eux seulement que les motifs les plus variés ont prise sur la volonté et engendrent les actes les plus multiples. Chacun de ces actes n’est qu’une preuve, un exemple de la volonté qui se manifeste dans son ensemble par ces besoins.
L’homme, dès qu’il commence à se connaître, se voit occupé à vouloir, et en règle générale son intelligence demeure en un rapport constant avec sa volonté. Il commence par chercher à bien connaître les objets de sa volonté, puis les moyens d’y atteindre. Alors il voit ce qu’il a à faire, et d’ordinaire ne cherche à rien savoir d’autre. Il agit, peine ; la conscience qu’il a, de travailler toujours à la fin que poursuit sa volonté, le tient en haleine et en train ; sa pensée s’occupe au choix des moyens. Telle est la vie de presque tous les hommes ; ils veulent, ils savent ce qu’ils veulent, ils le recherchent avec assez de succès pour échapper au désespoir, assez d’échecs pour échapper à l’ennui avec ses suites.
De là une certaine allégresse, ou du moins une paix intérieure, où ni richesse ni pauvreté n’ont pas grand chose à voir ; le riche ni le pauvre ne jouissent de ce qu’ils ont, car, on a vu pourquoi, leurs biens ne les touchent que négativement ; ce qui les tient en cet état, c’est l’espoir des biens qu’ils espèrent comme prix de leurs peines. Ils travaillent donc, vont de l’avant, sérieux, l’air important même ; tels les enfants appliqués à leur jeu.
–C’est par exception seulement qu’une telle vie voit son cours troublé, l’intelligence s’étant affranchie du service de la volonté, et s’étant mise à considérer l’essence même de l’univers, d’une façon générale ; elle aboutit alors, soit, pour satisfaire le besoin esthétique, à un état contemplatif, soit, pour satisfaire le besoin moral, à un état d’abnégation.
Mais la plupart des hommes fuient, leur vie durant, devant le besoin, qui ne les laisse pas s’arrêter, réfléchir. Au contraire, souvent la volonté en eux s’exalte jusqu’à une affirmation extraordinairement énergique du corps, d’où sortent des appétits violents, de puissantes passions ; alors l’individu ne s’en tient pas à affirmer sa propre existence, il nie celle de tous les autres, et tâche de les supprimer dès qu’il les trouve sur son passage.
La conservation du corps à l’aide de ses propres forces est encore un degré bien humble de l’affirmation de la volonté ; et si, librement, elle s’en tenait là, on pourrait admettre qu’à la mort, avec ce corps, la volonté dont il était le vêtement s’éteint. Mais déjà la satisfaction du besoin sexuel dépasse l’affirmation de l’existence particulière, limitée à un temps si court, va plus loin, et par delà la mort de l’individu, jusqu’à une distance infinie, affirme la vie.
Ce qui nous révèle encore dans le penchant des sexes l’affirmation décidée, la plus énergique, de la vie, c’est que pour l’homme de la nature, comme pour la bête, il est le terme dernier, la fin suprême de l’existence. Son premier objet, à cet homme, c’est sa propre conservation ; quand il y a pourvu, il ne songe plus qu’à la propagation de l’espèce ; en tant qu’il obéit à la pure nature, il ne peut viser à rien de plus. La nature donc, ayant pour essence même la volonté de vivre, pousse de toutes ses forces et la bête et l’homme à se perpétuer.
Cela fait, elle a tiré de l’individu ce qu’elle voulait, et reste fort indifférente devant son trépas, car pour elle qui, pareille à la volonté de vivre, ne s’occupe que de la conservation de l’espèce, l’individu est comme rien.
Les organes virils sont, plus qu’aucun des appareils extérieurs du corps, soumis à la seule volonté, et point à l’intelligence.
les organes virils sont le vrai foyer de la volonté, le pôle opposé au cerveau, qui représente l’intelligence, l’autre face du monde, le monde comme représentation. Eux, ils sont le principe conservateur de la vie, et qui lui assure l’infinité du temps.
Au contraire, l’intelligence rend possible la suppression de la volonté, son salut par la liberté, le triomphe sur le monde, l’anéantissement universel.
la volonté de vivre, quand elle s’affirme, doit comprendre sa situation à l’égard de la mort ; la mort ne lui fait pas obstacle, car elle est déjà enveloppée dans l’idée de la vie et en fait partie, contrebalancée qu’elle s’y trouve par son opposé, la génération, c’est-à-dire la promesse, la garantie, donnée à la volonté de vivre, d’une vie aussi longue que le temps, en dépit de la disparition des individus.
l’homme qui avec pleine réflexion prend le parti d’affirmer résolument la vie, peut regarder sans crainte la mort en face. N’y revenons donc pas. Pour la majorité des hommes, sans y bien réfléchir, ils adoptent cette situation, et affirment avec constance la vie. Le monde est là aussi qui reflète cette affirmation, avec ses individus innombrables, dans un temps infini, un espace sans bornes, au milieu de souffrances sans limites, entre la naissance et la mort, dans une chaîne illimitée de générations.