Christophe Claro's Blog, page 35
November 13, 2019
Balai et serpillière: à propos d'une certaine "lettre à une sorcière autoproclamée"
 En lisant la chronique de Luc Le Vaillant – « Lettre à une sorcière autoproclamée » – dans le Libération du 11 novembre, j’ai cru un moment à une parodie, une farce. Il faut dire que cette « adresse ricanante à une descendante énamourée des réprouvées des siècles passés qui, elle, ne risque plus l’inquisition ni le bûcher »– ainsi qu’est sous-titrée cette lettre – n’y va pas par quatre chemins. En gros, le propos semble le suivant : La référence que font certaines féministes aux sorcières serait grotesque, dans la mesure où, aujourd’hui, les femmes ne risquent plus le bûcher et sont largement écoutées. Comme preuve de cette saine immunité et comme témoignage de cette vaste audience, Luc Le Vaillant n’a guère d’arguments à avancer hormis les chiffres de vente du livre de Mona Chollet, La Puissance invaincue des femmes. A ses yeux, les « 100 000 exemplaires » vendus de ce livre devraient suffire à rendre risibles les revendications des femmes. On a envie de lui dire que si ce genre d’équation lui semble éloquente, doit-on en déduire que les 500 000 exemplaires du Suicide français de Zemmour devraient suffire à convaincre les fachos que leur cause est largement gagnée d’avance ?
En lisant la chronique de Luc Le Vaillant – « Lettre à une sorcière autoproclamée » – dans le Libération du 11 novembre, j’ai cru un moment à une parodie, une farce. Il faut dire que cette « adresse ricanante à une descendante énamourée des réprouvées des siècles passés qui, elle, ne risque plus l’inquisition ni le bûcher »– ainsi qu’est sous-titrée cette lettre – n’y va pas par quatre chemins. En gros, le propos semble le suivant : La référence que font certaines féministes aux sorcières serait grotesque, dans la mesure où, aujourd’hui, les femmes ne risquent plus le bûcher et sont largement écoutées. Comme preuve de cette saine immunité et comme témoignage de cette vaste audience, Luc Le Vaillant n’a guère d’arguments à avancer hormis les chiffres de vente du livre de Mona Chollet, La Puissance invaincue des femmes. A ses yeux, les « 100 000 exemplaires » vendus de ce livre devraient suffire à rendre risibles les revendications des femmes. On a envie de lui dire que si ce genre d’équation lui semble éloquente, doit-on en déduire que les 500 000 exemplaires du Suicide français de Zemmour devraient suffire à convaincre les fachos que leur cause est largement gagnée d’avance ? Mais ce qui me choque le plus dans l’adresse de Luc Le Vaillant, c’est avant tout son ton, son lexique, sa rhétorique. Sa façon de « croquer » certaines femmes, en cherchant à les caricaturer ou les dénigrer. Par exemple, traiter Inna Shevchenko de « batailleuse à seins nus » – ça ne vole pas très haut, pas plus haut en tout cas que Neuhoff disant de Huppert qu’elle est « sexy comme une biscotte ».Mais aussi : réduire Jacqueline Sauvage au statut de « flingueuse de mari tortionnaire ». C’est quoi, son problème, à Luc Le Vaillant ? Il trouve que les femmes en font trop ? Ne se rebellent pas comme il faut ? Prennent les mauvaismodèles ? Oui, parce que, hein, franchement, les sorcières, c’était autre chose, nous dit-il, « elles payaient souvent de leur vie une révolte qui n’était pas en peau de lapin ». Pourquoi utiliser le temps de l’imparfait ? Les chiffes des féminicides, c’est de la « peau de lapin » ? Les femmes sont des lapins, c’est ça qu’il veut dire en fait ? Les écorchées quotidiennes apprécieront.
Non, franchement, en lisant cette lettre, je me disais : c’est une parodie. Sinon, c’est trop caricatural. La condescendance masculine y est trop flagrante – « Chère démone d’aujourd’hui »… « Chère petite sœur de Circé et de Médée »… Et puis, cette façon paternaliste de s’adresser aux femmes : « Je comprends volontiers qu’il faille s’inventer des modèles rebelles, et se la raconter un peu. »Se la raconter un peu ?! Luc Le Vaillant trouve que les femmes « se la racontent un peu » ?! Oui, car aux yeux de saint Luc, la bataille des femmes a été gagnée, et toute autre forme d’agitation est donc vaine et ridicule. « Tu fais des enfants si tu veux et avec qui tu veux », serine-t-il. Là, on a envie de lui dire d’aller prendre un petit cours de sociologie en accéléré avant d’assener de pareilles bêtises. Je doute que les femmes violées qui se retrouvent enceintes aient la même perception de ce magique « si tu veux ». Mais ce n’est pas tout. « Ta voix est aujourd’hui écoutée, chantée, célébrée. Elle est socialement admise et majoritairement applaudie. » Majoritairement ?! Mais dans quel monde vit Luc Le Vaillant ?! Autrefois, les sorcières, « [o]n les jetait à l’eau pour voir si elles flottaient » – du passé, quoi. Oui bon, peut-être que 220 000 femmes victimes de violences physiques et les cent cinquante femmes assassinées par an ont échappé à la torture par l’eau ou à la noyade, mais ce qui est sûr c’est qu’elles ont, blessées ou mortes, du mal à "flotter".
J’arrête là, car chaque phrase de la lettre de Luc Le Vaillant me semble hallucinante de bêtise et de malveillance. En tout cas, sa missive démontre – si besoin était – que la parole des femmes a dû mal à faire son chemin. Parce que le problème, de toute évidence, ce n’est pas seulement que les femmes parviennent à dire ce qu’elles ont à dire, mais qu’elles soient entenduespar les hommes. C’est-à-dire que les hommes – tous les hommes – s’interrogent en leur for intérieur – leur fortin intériorisé – sur leur mode de penser et d’agir, et ce dans les moindres détails. Si les hommes, en plus de questionner leur virilité, ne s’interrogent pas sur leur réaction souvent crispée face aux propos des femmes, s’ils continuent de penser que l’abus est du côté de la dénonciation féministe et non à chercher dans le particulier de leurs comportements, la cause humaine n’avancera guère.
Toutes les femmes ou presque ont une « histoire d’abus » à raconter. Les hommes devraient prendre la mesure de ce fait plutôt que de trouver "exagéré" ou "déplacé" que certaines se mettent "seins nus" – puisque, paraît-il, elles ne risquent plus rien, et ne seront pas, elles, "brûlées" pour ça. Mais en fait, si : on les brûle encore. Au troisième degré. Tous les jours. Au fer à repasser. A la cigarette. Au chalumeau. (Que je sache, la Biafine n’est pas à ce jour une réponse suffisante à la domination masculine.) « Tes plaintes contemporaines sont recueillies par de vertueux accusateurs médiatiques et amplifiées par la vox populi qui répercute tout et son contraire », écrit pour finir Luc Le Vaillant. On a plutôt envie de dire : leurs plaintes contemporaines sont systématiquement accueillies par cette morgue machiste que rien ne semble pouvoir flétrir. Luc Le Vaillant fait à un moment allusion à Adèle Haenel qui, selon lui, déplorerait que la justice soit trop « précautionneuse ». Est-il besoin d’expliquer à Le Vaillant ce que ce « précautionneux » recouvre dans les faits ? La précaution : n’est-ce pas là ce que l’homme exige de la femme depuis toujours ? Autrement dit : "Fais attention, hein. Ne te la raconte pas. C’est à nous de te raconter. " Chanson connue, air nauséabond.
Tout ce « matriarcat millénariste » donne envie à Le Vaillant « d’enfourcher [son] balai » ! Je pense personnellement qu’il pourrait faire un meilleur usage de cet ustensile domestique.
Published on November 13, 2019 00:54
October 22, 2019
Bartleby à Zurich
 L’imitation de Bartleby : En choisissant ce titre, l’auteur – Julien Battesti – nous invite à songer à un autre livre, vieux de plus de cinq siècles, L’imitation de Jésus-Christ, qui exhortait ses lecteurs à mettre leurs pas dans ceux du fils de Dieu en embrassant une vie ascétique, à l’écart du monde. En ce sens, on peut dire que le personnage de Melville – Bartleby – incarne, à sa manière, un cas d’écartement extrême, où le retrait s’accomplit par le refus de bouger plutôt que par la volonté de se retirer. Bartleby est un être préférant ne pas. En cela, peut-on lui envisager des imitateurs ? Le livre de Battesti, je crois, préfère ne pasaborder la question frontalement, et opte donc pour une approche sans doute subtile, et plus conforme au modèle dont il recherche les avatars. C’est un livre qui procède de façon interstitielle, afin de conserver sa légèreté et sa liberté.
L’imitation de Bartleby : En choisissant ce titre, l’auteur – Julien Battesti – nous invite à songer à un autre livre, vieux de plus de cinq siècles, L’imitation de Jésus-Christ, qui exhortait ses lecteurs à mettre leurs pas dans ceux du fils de Dieu en embrassant une vie ascétique, à l’écart du monde. En ce sens, on peut dire que le personnage de Melville – Bartleby – incarne, à sa manière, un cas d’écartement extrême, où le retrait s’accomplit par le refus de bouger plutôt que par la volonté de se retirer. Bartleby est un être préférant ne pas. En cela, peut-on lui envisager des imitateurs ? Le livre de Battesti, je crois, préfère ne pasaborder la question frontalement, et opte donc pour une approche sans doute subtile, et plus conforme au modèle dont il recherche les avatars. C’est un livre qui procède de façon interstitielle, afin de conserver sa légèreté et sa liberté.Au début du livre, le narrateur est allongé sur le dos, « étendu à plat », et l’on pense bien sûr au Grégoire Samsa de Kafka et à son « dos aussi dur qu’une carapace ». Il faut dire que le narrateur a choisi cette position pour des raisons thérapeutiques, afin de soulager les douleurs que lui inflige une triple hernie discale. Cette « station » horizontale, qu’il qualifie lui-même d’ascèse, il la rompt un jour pour se livre à des recherches sur un livre mystérieux intitulé Exit, recherches qui vont s’avérer stériles, mais qui auront pour conséquence, googlisme oblige, à tomber sur une « association pour le droit de mourir dans la dignité » du nom de Exit. Cette découverte l’amènera très vite à se pencher sur le cas de Michèle Causse, cette écrivaine et traductrice qui opta pour le suicide assisté en 2010, le jour de son anniversaire.
On le voit, le cheminement de la pensée de Battesti, bien qu’en apparence capricieux, suit en réalité un itinéraire très réfléchi, en dédoublant chacune de ses étapes. Le repos sur le dos se double d’une dimension ascétique ; la femme qui lui parle du mystérieux livre s’appelle Dolie, un mot qui en latin renvoie à la douleur, au chagrin ; le livre en question s’intitule, on l’a dit, Exit, et il est censé traiter de l’exode dans la monde moderne sous forme romancée ; l’association qui œuvre pour le suicide assisté s’appelle Exit ; celle à laquelle s’adressa Michèle Causse s’appelle, elle, Dignitas ; quant à l’écrivaine féministe, qui souffrait d’ostéoporose et a passé les dernières années de sa vie allongée, elle était également traductrice, entre autre de Bartleby, et ici le lecteur se rappellera qu’à la fin de la nouvelle de Melville, le personnage de Bartleby gît « recroquevillé au pied d’un mur, immobile, amaigri » (Battesti) – mort. Ascèce, douleur, exode, dignité, et pour finir, stase.
Mais le livre de Battesti ne se réduit pas un jeu de piste métaphorique ou philosophique, car, comme je l’ai dit, il procède de façon interstitielle, par écarts et vagabondages, allant d’une piste à l’autre sans jamais faire peser sur son propos le fardeau de la démonstration. Son récit de la nouvelle de Melville, le portrait en pointillé qu’il brosse de Michèle Causse, ses réflexions sur la théologie, sa théorie sur la figure de Moïse dans Bartleby, le film éponyme de Ronet qu’il évoque, son voyage à Zurich pour aller visiter l’association Dignitas : autant de « stations » auxquelles il nous convie afin de nous rendre plus sensible sa démarche. Capable de disséquer une vertu théologale autant que de commenter une fondue au fromage, conjurant les ombres de Djuna Barnes comme celles de Deleuze, Battesti montre avec ce livre qu’une pensée, pour peu qu’elle soit rhizomatique, est capable de créer sa forme propre, une forme ouverte, organique, généreuse et accueillante, et toujours surprenante._________________________Julien Battesti, L’imitation de Bartleby, éd. Gallimard, Coll. L’Infini, 12 €
Published on October 22, 2019 07:47
August 21, 2019
En librairie aujourd'hui (et peut-être aussi demain…)
 "L'Histoire des tables tournantes et des esprits frappeurs n’a été pas écrite uniquement avec le sang des mages et le jus des fées. Elle a été exposée, publiée, photographiée, moulée, reproduite, imprimée, chantée, transformée en ce qu’on voulait qu’elle soit et c’est tant mieux ma foi. Des volumes entiers lui ont été consacrés, aussi indigestes que des catéchismes pâtissiers, des pages entières d’approche indicible mais commentée. L’histoire, d’ailleurs, est fidèle à sa renommée bancale, à son aura truquée. Car d’emblée, à peine le voile déchiré, le rideau écarté, la table ébranlée, les puissances psychiques s’étaient signalées par leur maîtrise imparfaite de la supercherie. Elles avaient beau secouer le corps des médiums, s’incarner en manchon gluant, deviner les âges et les liaisons, réciter des épopées, il y avait toujours un moment où le décor branlait, où une bougie enflammait un rideau, des fils jusqu’alors invisibles s’emmêlaient dans les chevelures et les bijoux, quelqu’un arrachait quelque chose, et la soirée s’achevait en gifles et en reproches comme si convoquer les morts relevait désormais de la scène de ménage. On aurait dit que les morts, surpris dans leur retraite par des appels incessants et comme étonnés d’être à ce point regrettés, bâclaient leur retour sur la scène des vivants. Ils semblaient tour à tour maladroits, farceurs, timides, empêtrés dans leur gaze ou déformés par l’hésitation. Que leur voulait-on ? Ils ne reviendraient jamais pour de bon, c’était fini pour eux ici-bas, ils habitaient désormais des limbes en perpétuelle expansion, où toutes les époques se confondaient en un fastidieux brassage, à quoi bon se donner la peine de faire de brefs caméos. Ils n’avaient rien à dire à ceux qui respiraient sans y penser, pensaient sans en tirer les conséquences, n’agissaient que pour agir. Leurs préoccupations étaient autres désormais, et on aurait voulu qu’ils reprennent de la substance, qu’ils reviennent sous forme de voix, s’octroient un épisode de chair, et tout ça pour quoi ? Pour que des assis en cercle frissonnent, pour les éblouir ou les affliger par d’inutiles révélations ? "
"L'Histoire des tables tournantes et des esprits frappeurs n’a été pas écrite uniquement avec le sang des mages et le jus des fées. Elle a été exposée, publiée, photographiée, moulée, reproduite, imprimée, chantée, transformée en ce qu’on voulait qu’elle soit et c’est tant mieux ma foi. Des volumes entiers lui ont été consacrés, aussi indigestes que des catéchismes pâtissiers, des pages entières d’approche indicible mais commentée. L’histoire, d’ailleurs, est fidèle à sa renommée bancale, à son aura truquée. Car d’emblée, à peine le voile déchiré, le rideau écarté, la table ébranlée, les puissances psychiques s’étaient signalées par leur maîtrise imparfaite de la supercherie. Elles avaient beau secouer le corps des médiums, s’incarner en manchon gluant, deviner les âges et les liaisons, réciter des épopées, il y avait toujours un moment où le décor branlait, où une bougie enflammait un rideau, des fils jusqu’alors invisibles s’emmêlaient dans les chevelures et les bijoux, quelqu’un arrachait quelque chose, et la soirée s’achevait en gifles et en reproches comme si convoquer les morts relevait désormais de la scène de ménage. On aurait dit que les morts, surpris dans leur retraite par des appels incessants et comme étonnés d’être à ce point regrettés, bâclaient leur retour sur la scène des vivants. Ils semblaient tour à tour maladroits, farceurs, timides, empêtrés dans leur gaze ou déformés par l’hésitation. Que leur voulait-on ? Ils ne reviendraient jamais pour de bon, c’était fini pour eux ici-bas, ils habitaient désormais des limbes en perpétuelle expansion, où toutes les époques se confondaient en un fastidieux brassage, à quoi bon se donner la peine de faire de brefs caméos. Ils n’avaient rien à dire à ceux qui respiraient sans y penser, pensaient sans en tirer les conséquences, n’agissaient que pour agir. Leurs préoccupations étaient autres désormais, et on aurait voulu qu’ils reprennent de la substance, qu’ils reviennent sous forme de voix, s’octroient un épisode de chair, et tout ça pour quoi ? Pour que des assis en cercle frissonnent, pour les éblouir ou les affliger par d’inutiles révélations ? "— Claro, Substance, Actes Sud, sortie le 21 août
Published on August 21, 2019 01:31
August 17, 2019
Patientes antennes: Traduire "Vers la baie", de Cynan Jones
 Vers la baie
, quatrième livre traduit de Cynan Jones, est l’exemple typique du roman qui force l’admiration, une admiration partagée à parts égales entre son auteur et sa traductrice. La prose de Jones, qui atteint des sommets de précision même quand elle s’attache à décrire des états diffus ou des sensations improbables, ne souffre aucun flou, et il fallait l’incomparable talent de Mona de Pracontal pour qu’elle puisse renaître avec la même cinglante acuité.
Vers la baie
, quatrième livre traduit de Cynan Jones, est l’exemple typique du roman qui force l’admiration, une admiration partagée à parts égales entre son auteur et sa traductrice. La prose de Jones, qui atteint des sommets de précision même quand elle s’attache à décrire des états diffus ou des sensations improbables, ne souffre aucun flou, et il fallait l’incomparable talent de Mona de Pracontal pour qu’elle puisse renaître avec la même cinglante acuité.Le récit, en lui-même, est d’une simplicité absolue, et réside tout entier dans la dérive en mer d’un homme sur un kayak, ses tentatives aussi désespérées que méticuleuses pour se maintenir en vie, ses liens avec le monde réduits aux mouvements de l’eau, à la brûlure du soleil ou la mitraille des pluies. Non seulement la traductrice devait rendre la phrase dans sa rêche économie, mais également dompter un certain lexique marin sans qu’il déséquilibre la syntaxe. La tâche a dû être rude, mais elle a été si bien menée qu’à aucun moment on ne sait pointer les os de l’anglais sous la peau du français. On sent en outre à chaque instant la délectation du mot juste, qui ne sert ici aucune fioriture, mais au contraire assure la nécessaire tension de chaque énoncé, un peu comme ce « bonbon de beurre brûlé qui poisse les doigts » : l’image a ressuscité en français dans sa pleine sonorité.
Le texte (français), en oscillant subtilement entre temps du présent, du passé simple et de l’imparfait, parvient à restituer à merveille la sensation de déséquilibre qui menace à tout instant le récit :
« Il avait un tintement dans les oreilles, une stridulation d’insecte. Il se sentait ivre. Sa tête éclatait sous les pulsations. Il laissa la lumière entrer petit à petit, comme s’il l’avalait par gorgées avec son œil, leva la tête et vit l’eau. Il crut d’abord qu’il était aveugle, puis il comprit : il n’y avait que l’eau à voir, rien d’autre. »La cadence soutenue ici entre autres par les sons « v », « t », et « s », n’est possible évidemment que parce que la traductrice a l’oreille absolue, et que ses choix de traduction sont intrinsèquement liés à un instinct musical.
La beauté dénudée du texte de Cynan Jones est donc ici non pas magnifiée mais interprétée sur un clavier non moins exigeant. C’est une question d’équilibre, un équilibre chimique, quasi magique ; disons plutôt que cette traduction est une affaire électrique, une histoire de tensions, d’impulsions, de reconduction des forces magnétiques – et comment mieux expliciter la chose qu’en citant ce passage exemplaire qui semble à la fois décrire le miracle de la prose de Cynan Jones que celui opérée par la traductrice, Mona de Pracontal :
« L’orage était né à plusieurs kilomètres au large. Une masse d’air avait fini par céder à d’infimes variations et devenir instable. Sous les différentes pressions, un nuage s’était formé et déplacé, poussant l’air froid devant lui.La lecture n’est pas le texte. C’est l’effet traduit du texte. Autour de laquelle le lecteur exulte.
En chemin, le nuage lui-même se mit à se polariser. Les charges positive et négative qu’il contenait se séparèrent. La charge négative amassée dans sa base envoyant des traceurs descendants – de l’énergie négative, qui progressait par lignes – jusqu’à ce que le sol réponde en émettant des traceurs à charge positive, patientes antennes.
Quand les deux charges se rencontrèrent, le courant circula, essayant de neutraliser la séparation qui s’était faite dans le nuage. De la court-circuiter.
La foudre n’est pas la décharge. C’est l’effet local de la décharge. Autour de laquelle l’air explose. »
_________________________
Cynan Jones, Vers la baie, (titre original : Cove), traduit de l’anglas (Pays de Galles) par Mona de Pracontal, éd. Joëlle Losfeld
Published on August 17, 2019 03:23
August 16, 2019
Technique du déluge: "Borgo Vecchio" de Giosuè Calaciura
 Paru il y a deux ans en Italie, et traduit une fois de plus avec brio par Lise Chapuis, le nouveau roman de Giosuè Calaciura s’appelle
Borgo Vecchio
, du nom d’un quartier truculent que se partagent à parts égales la cruauté et l’extase, la répression et l’inventivité. Armé d’une simple tribu d’enfants perdus, d’adultes roublards et d’animaux pensants, Calaciura fait du merveilleux un insolent remède à la misère, et du miracle une ultime échappée belle pour les plus démunis. Sous sa plume, la fresque sociale devient un opéra fabuleux : si les uns et les autres n’ont pour seuls loisir et recours que le larcin, le lecteur découvre très vite qu’ils ne volent pas que des biens terrestres, mais aussi bien des instants de grâce et des fugues mentales. Il faut dire que Calaciura a une façon bien à lui de déployer les petits accrocs du quotidien. Passé maître dans l’art d’accordéonner le réel, il étire ce dernier pour en faire d’insolites guirlandes, jusqu’au leur point de rupture ou plutôt d’évanescence, suspendant notre incrédulité comme on soulagerait d’un pesant fardeau, autorisant tous les envols, toutes les folies.
Paru il y a deux ans en Italie, et traduit une fois de plus avec brio par Lise Chapuis, le nouveau roman de Giosuè Calaciura s’appelle
Borgo Vecchio
, du nom d’un quartier truculent que se partagent à parts égales la cruauté et l’extase, la répression et l’inventivité. Armé d’une simple tribu d’enfants perdus, d’adultes roublards et d’animaux pensants, Calaciura fait du merveilleux un insolent remède à la misère, et du miracle une ultime échappée belle pour les plus démunis. Sous sa plume, la fresque sociale devient un opéra fabuleux : si les uns et les autres n’ont pour seuls loisir et recours que le larcin, le lecteur découvre très vite qu’ils ne volent pas que des biens terrestres, mais aussi bien des instants de grâce et des fugues mentales. Il faut dire que Calaciura a une façon bien à lui de déployer les petits accrocs du quotidien. Passé maître dans l’art d’accordéonner le réel, il étire ce dernier pour en faire d’insolites guirlandes, jusqu’au leur point de rupture ou plutôt d’évanescence, suspendant notre incrédulité comme on soulagerait d’un pesant fardeau, autorisant tous les envols, toutes les folies.Très souvent, l’auteur part d’une situation aux contours précis, concrète, tangible, puis sonde alors le phénomène afin de l’évaser mentalement, de lui faire rendre tous ses possibles. Ainsi de l’odeur du pain qui « se présent[e] à la porte de la boulangerie », dont on va suivre non seulement le parcours rhizomatique dans le Quartier mais également les conséquences sur ceux et celles qu’il croise :
« L’odeur du pain traversa la place anéantissant les efforts vespéraux des agrumes captifs sur les étals du marché, désireux de laisser une dernière trace olfactive dans la nuit, elle effaça l’illusion de printemps contenue dans le mystère odorant du pomélia, prit possession des carrefours et resta en garnison dans les ruelles et les tavernes afin que personne n’échappe à son étreinte. Elle atteignit le moribond du troisième étage qui, à travers ses râles, prenait congé de sa famille en larmes, et éclaira son agonie d’une involontaire perfidie en lui faisant sentir, à l’instant des derniers spasmes, combien il était atrocement douloureux de se séparer du parfum du pain et de la vie, elle pénétra dans l’alcôve bleu de Carmela […]. »
Odyssée mirifique d’un parfum, que rien n’arrête et qui infuse la longue phrase qui le porte, et c’est là où Calaciura excelle sans cesse : à faire de sa phrase un vecteur, lui permettant de modifier insensiblement la nature des choses, d’opérer délicatement, avec ivresse, leur inéluctable et ravageuse métamorphose Après le pain, c’est au tour du ciel d’imposer sa déferlante, et voilà qu’un déluge insensé, une véritable hystérie diluvienne s’abat sur le quartier, brouillant les frontières entre mer et terre, laissant les bateaux s’avancer dans les avenues, et les passagers saluer les habitants aux balcons… Tous les éléments sont passibles d’épopée : le couteau et le pistolet de Toto, le voleur aux semelles de vent, les boucles d’oreille de la prostituée Carmela, une balle tirée par un policier… et chaque fois, l’émotion surgit, inédite, éblouissante, parce que l’auteur sait s’emparer du trivial comme d’un bout de métal susceptible, après friction et polissage, d’acquérir une dimension poétique, fabuleuse.
En lisant Borgo Vecchio, on pense parfois aux parades fantasques qui enluminent les livres de Genet, et où saintes putains, frêles voleurs et tristes flics dansent une danse fatale, tandis que l’enfant survit entre volées de coups et cris du cœur, le tout baignant dans une atmosphère mi-païenne, mi-sacrée, comme si plongé dans la misère le monde n’avait plus pour seul destin que l’indécidable, et pour seul porte-parole le dernier des agneaux._________________________
Giosuè Calaciura, Borgo Vecchio , traduit de l’italien par Lise Chapuis, éd. Noir sur Blanc / Notabilia [Parution le 22 août 2019]
Published on August 16, 2019 07:52
August 10, 2019
PIvert au Point
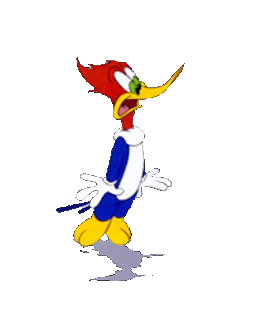 Toc toc toc, fait le pivert, mais personne ne lui ouvre. Pareil pour Patrick Besson, écolier français vivant et travaillant au Point : il tape tape tape, mais personne ne l'écoute. Ses livres n'ayant jamais fait la Une du Monde des Livres, il en a conçu une grande amertume pour ce supplément littéraire. Aussi, au lieu de parler dans les colonnes du Point des livres qu'il a aimés, ou terminés, ou coloriés, il gaspille son encre à picasser et pleupleuter – comme le pivert, ou pic-vert – et à tambouriner du bec sur les critiques du Monde des Livres. Il s'est longtemps défoulé sur Eric Chevillard, qui pourtant l'a cité à plusieurs reprises, et quand Chevillard a arrêté le Feuilleton, il m'a pris en grippe (aviaire?). Rendez-vous compte, il en est à sa deuxième chronique sur mon cas – le mot chronique étant ici plus que pertinent tellement ça en devient pathologique. Donc, cette semaine, revenant sur mes "adieux" (puisque j'ai arrêté le Feuilleton début juillet), le voilà qui remet une couche – bon, rassurez-vous, je me garderai bien de broder sur cette expression imagée, hélas fort à propos.
Toc toc toc, fait le pivert, mais personne ne lui ouvre. Pareil pour Patrick Besson, écolier français vivant et travaillant au Point : il tape tape tape, mais personne ne l'écoute. Ses livres n'ayant jamais fait la Une du Monde des Livres, il en a conçu une grande amertume pour ce supplément littéraire. Aussi, au lieu de parler dans les colonnes du Point des livres qu'il a aimés, ou terminés, ou coloriés, il gaspille son encre à picasser et pleupleuter – comme le pivert, ou pic-vert – et à tambouriner du bec sur les critiques du Monde des Livres. Il s'est longtemps défoulé sur Eric Chevillard, qui pourtant l'a cité à plusieurs reprises, et quand Chevillard a arrêté le Feuilleton, il m'a pris en grippe (aviaire?). Rendez-vous compte, il en est à sa deuxième chronique sur mon cas – le mot chronique étant ici plus que pertinent tellement ça en devient pathologique. Donc, cette semaine, revenant sur mes "adieux" (puisque j'ai arrêté le Feuilleton début juillet), le voilà qui remet une couche – bon, rassurez-vous, je me garderai bien de broder sur cette expression imagée, hélas fort à propos. Allons, Monsieur Besson, un peu de sérieux, que diable! Ça ne peut pas intéresser vos lecteurs, cette vaine détestation qui vous pousse à lâcher, comme le pivert quand il est contrarié, des "kuk-ku-kuk" stridents et inutiles. Vos lecteurs, s'ils sont de votre acabit, ne me lisent certainement pas, et n'ont que faire des livres qui m'interpellent au niveau du vécu, alors franchement, me consacrer deux chroniques dans Le Point en un an, je trouve que c'est un peu pousser vos fidèles dans les orties. Attention, à force de me montrer du bec, vous allez leur donner envie de me lire… kuk-ku-kuk!!! Et puis votre ire vous égare: vous me traitez de "journaliste", et on a l'impression que pour vous c'est une insulte – bizarre, non? Ensuite, vous vous demandez s'il est vrai que je suis traducteur. Se peut-il que de votre vie vous n'ayez jamais ouvert un livre de William Gass, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, William T. Vollmann, Vikram Seth, Anne Carson, Alan Moore, Kathy Acker? Mais suis-je bête! Vous les lisez en anglais, bien sûr… Enfin, vous passez sous silence le fait que j'ai écrit des livres, mais là, j'ai envie de dire: ouf. Nous n'aurions pas aimé pas que nos proses troublassent votre sieste intellectuelle.
Allez, patience, le Monde des Livres va bientôt reparaître et vous pourrez de nouveau kuk-ku-kuker l'écrivain ou l'écrivaine qui me succédera. Et puisque le pic-vert aime faire son nid dans les bois morts et les arbres sénescents, ne changez surtout pas de support, hein, continuez de dormir au Point.
Published on August 10, 2019 05:53
August 7, 2019
Le jeu des excuses, ou l'art du Buisson creux
Tu as dit n’importe quoi, tu as dit une contre-vérité, tu as affirmé calmement, « à froid » comme tu l’as si humblement précisé, que Malik Oussekine n’était pas mort à la suite de violences policières, alors que la justice de l’époque a très clairement établi le contraire, mais peut-être contestes-tu cette décision de justice, ce qui apparemment n’est pas le cas, car c’est bien le fait que Malik Oussekine soit décédé suite à des violence policières que tu as froidement nié l’autre jour, et publiquement, sachant que personne ne te contredirait. Tu as dit cette chose immonde et fausse puis, voyant que ça ne passait pas, découvrant que ça coinçait, comme on dit, puisque l’opinion n’est finalement qu’un gros meuble aux tiroirs capricieux, tu as présenté des excuses, ou plutôt tu as dit que tu « t’excusais », ce qui est impropre grammaticalement mais prouve assez que tu n’es bien servi que par toi-même. Mais de quoi t’excuses-tu ainsi ? D’avoir dit ces choses, de les avoir pensées, de les avoir crues, de n’avoir pas réfléchi, vérifié, fait ton métier ? En tout cas, ce qui est clair, évident, grave, c’est que tu ne t’excuses pas d’avoir estimé que l’exemple déformé que tu as donné servait ton propos, et ce propos, hélas, lui, n’est pas excusable, à l’heure où ces violences policières que tu sembles minimiser ont fait plusieurs victimes (renseigne-toi, c’est ton métier, non ?).
Et puis il y a l’usage que tu fais, très calmement, de ce mot : « factuellement ». Un mot qui semble agir tout seul, de son plein droit, un mot qui semble dire que la relation de cause à effet n’est pas recevable, et que si je pousse le faible et que le faible tombe, la faute en revient à sa faiblesse. J’ai l’impression désagréable d’avoir déjà entendu cet argument et je ne te ferai pas l’affront de recourir au point Godwin pour t’expliquer d’où me vient cette impression. Mais enfin, je trouve que ce genre d’argument est plus que pernicieux. Et tu le sais très bien. Tu as le droit d’être bêtement de droite, de vouloir défendre la police, de trouver qu’il y a de la violence du côté des manifestants, mais en quoi ce droit t’oblige-t-il à fausser les faits et salir la mémoire d’un mort ? Mais peut-être savais-tu exactement ce que tu faisais, comme tant d’autres avant toi. Peut-être n'as tu pas été surpris d'apprendre que tu mentais. Tu cherches à défendre une position – une posture? –, et pour cela tout est bon, même la contre-vérité, même s’il faut par la suite faire machine arrière, présenter des excuses, ou plutôt s’excuser. J’espère qu’il n’y a aucune stratégie délibérée derrière ta façon faussement objective d’assener des horreurs. J’espère sincèrement que tu es bête et méchant, par aveuglement politique, et non froid et calculateur, par machiavélisme.
Tu emploies également l’expression « donner à penser », mais là je t’arrête tout de suite : tes propos ne donnent pas à penser, ils ne relèvent même de la pensée, ils sont le contraire de la pensée, ils insinuent, s'insinuent, au même titre que les saletés morales que déversent régulièrement nos tristes philosophes du PAF. De quoi relèvent-ils, alors, ces propos ? Tu le sais très bien. Ils relèvent, et ici la langue semble nous jouer un tour pendable, de l’abaissement. A croire que c’est désormais votre job : abaisser. Abaisser la vigilance, le niveau intellectuel, l'exigence morale, faire de tout un cirque, et tester la puissance d'absorption de la sciure. Et plus vous œuvrez à cet abaissement, plus vous haussez le ton – autre paradoxe.
Tu le vois, les mots ont un sens, qui ne coule pas de source, à l’inverse du sang, qui lui va toujours de l’homme au sol, et la terre le boit, et la tache demeure, et ceux qui piétinent ces taches en affirmant qu’il ne s’agit que d’ombres ont beau jeu de s’excuser. Mais peut-être les excuses sont-elles, pour eux, pour toi, un jeu ? Qui perd gagne ? Allez, je te laisse avec une expression qui devrait te parler: réviser son jugement.
Published on August 07, 2019 01:41
July 29, 2019
LE DECLENCHEMENT – Maria Pourchet, "Toutes les femmes sauf une"
 Comme une lettre à la poste : cette expression, aussi usitée soit-elle, est loin d’être de rigueur dès lors qu’il s’agit d’évoquer un accouchement, et sans doute ne l’est-elle guère plus pour désigner tout ce qu’on aimerait dire à sa génitrice. Quelque chose, en effet, ne passe pas, ou plutôt a du mal à passer. C’est pourtant la vie, ici, qui est transmise, autorisant la vision pas si abstraite que ça d’une longue chaîne de femmes se perpétuant de génération en génération, comme à l’écart des hommes, entre fèces et urine, et merci saint Augustin. La vie, certes, mais pas que. Qui dit transmission dit également valeurs, peurs, interdits. Et si donner naissance c’est reprendre le rôle de mère (le flambeau ? se brûler à son tour ?), c’est l’occasion parfois de régler ses comptes avec celle qui, Folcoche ou Médée, n’y est pas pour rien dans votre présence au monde, à commencer par votre présence dans cette salle d’accouchement où vous vous dites enfin :
Comme une lettre à la poste : cette expression, aussi usitée soit-elle, est loin d’être de rigueur dès lors qu’il s’agit d’évoquer un accouchement, et sans doute ne l’est-elle guère plus pour désigner tout ce qu’on aimerait dire à sa génitrice. Quelque chose, en effet, ne passe pas, ou plutôt a du mal à passer. C’est pourtant la vie, ici, qui est transmise, autorisant la vision pas si abstraite que ça d’une longue chaîne de femmes se perpétuant de génération en génération, comme à l’écart des hommes, entre fèces et urine, et merci saint Augustin. La vie, certes, mais pas que. Qui dit transmission dit également valeurs, peurs, interdits. Et si donner naissance c’est reprendre le rôle de mère (le flambeau ? se brûler à son tour ?), c’est l’occasion parfois de régler ses comptes avec celle qui, Folcoche ou Médée, n’y est pas pour rien dans votre présence au monde, à commencer par votre présence dans cette salle d’accouchement où vous vous dites enfin :« […] dans une mare de sang, de pisse et d’eau je viens d’apprendre la vérité : je suis un animal. »Dixit Maria Pourchet, qui avec Toutes les femmes sauf une semble continuer le travail d’Annie Ernaux – on pense entre autres à Une femme (1987) ou La honte (1997) – mais par d’autres moyens, tout aussi incisifs, et ici le mot incisif peut, oui, blesser.
Est-ce une lettre à la mère ? Peut-être. Mais, avant toutes choses, le livre se présente comme une lettre à la fille, Adèle, celle qui vient de naître. On est dans une maternité – mot qui, faut-il le rappeler, désigne à la fois une usine à gaz amniotique et un état brutal et nouveau. C’est un lieu de violence et d’apprentissage forcé – Julie Bonnie l’avait très bien cerné dans Chambre 2 (Belfond, 2013) – où le temps se contracte en même temps que le col se dilate, comme si une double respiration, cosmique et contrariée, faisait s’adjoindre, au mitan d’une délivrance, la mère passée et l’enfant à venir. Pour l’auteure, c’est l’instant t du travail : celui de la parturiente comme celui de la mémoire.
« Je connais quelque chose comme la terreur d’un naufragé, et sa fatigue. (…) Juste avant, il y a ma mère. Et encore avant, sa mère, et la mère de sa mère, et toutes les filles avant elles. Les fortes, les pas faciles, les tondues, les mauvaises, les tordues, les saintes, les pendues au téléphone, les paysannes, les reines d’Angleterre, les presque belles, les trop, les Carmen, les battues, les conscientes, les increvables. Et le berceau qui n’a rien demandé. Ou peut-être que si. J’ignore après tout ce qui gouverne la chute des âmes. »La transmission : telle est la grande affaire de Maria Pourchet. Ou plutôt : en finir avec. En effet, plutôt que de s’attaquer à la lâche lignée des hommes, c’est à celle des femmes, outils de la transmission, que s’en prend l’auteure. S’en prend, parce que désireuse de se déprendre, de tout faire pour que sa fille, à son tour, ne s’en prenne pour son grade. Il faut dire que la mère de celle qui parle ici est une armée à elle toute seule, dispensant sans compter ordres et jugements :
« Regarde où tu mets les pieds. Ne réclame pas. Ne te fais pas remarquer. Tu la vois celle-là ? Tu l’as pas volée ? Ça t’apprendra. »
Pour dire la violence de la mère, comme pour peindre celle de la maternité, Maria Pourchet forge une langue parfaitement rompue, qui progresse par à-coups, selon un rythme saccadé, des paquets de syllabes hachées et hachantes, comme en quête d’expulsion.
« Chez les animaux que nous sommes, fous du désir de parler, ça commence par la catastrophe de la langue. »Et de faire défiler la litanie des désastres prononcés, toutes ces paroles assenées par la mère au fil des ans et des maturations pour brider/briser la fille. Chaîne ininterrompue de commandements, qui intime à la suivante de faire profil bas plutôt de relever la tête. Maria Pourchet accuse, reproche, constate, juge ? Surtout, elle montre les marques, laissées par les mots, et dont elle refuse que l’empreinte passe à sa fille. Assez de cet apitoiement sur soi, de cette humilité refilée en dot à chaque génération.
« Les pauvres femmes sont penchées sur les éviers, la terre, les bites, les bassines, les mômes, les poules. Une femme penchée sur un cahier, c’est un homme. C’est un homme et personne ne l’emmerde. »On devine que ce cahier, il a fallu s’en saisir à mains nues et rageuses.
Toutes les femmes sauf une : par ce titre, par cette promesse aussi, Maria Pourchet ne cherche pas seulement à enrayer la machinerie de la soumission et tuer la mère. Parce que la frontière entre victimes et complices, opprimées et passeuses d’oppression, demeure inévitablement floue, l’auteure paie également ses dettes :
« Je dois ma liberté à la sauvagerie, au souvenir des forêts. A la révolte inutile qui couvait en ma mère mais qui, chez moi, monte, éclate et se tait. »C’est donc un livre sauvage, au tempo tenace, bien décidé, et ce littéralement, à en découdre. A rompre un fil dont il restitue, implacablement mais sans aigreur, toute la tension, porté par une écriture elle-même en tension, à la fois blessée et coriace, crue et sagace, qui laisse béer les plaies pour que brille, enfin affranchi, un sang nouveau.
______________________
Maria Pourchet, Toutes les femmes sauf une, Pauvert
Published on July 29, 2019 08:42
July 12, 2019
Entre Lazare et Reznikoff
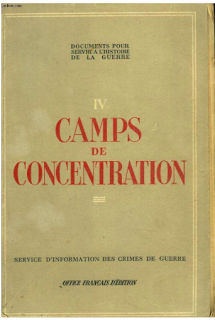 La « littérature lazaréenne » – pour reprendre une expression forgée par Jean Cayrol, autrement dit les récits issus de l’expérience concentrationnaire durant la Seconde Guerre mondiale – est un corpus en soi, dans lequel le témoignage fait l’épreuve d’une « mise en forme » à la fois impossible et nécessaire, puisque la parole tourne autour d’un indicible qu’il faut néanmoins restituer. Il existe d’autres textes qui, bien qu’émanant d’écrivains n’ayant pas vécu directement l’horreur de la Shoah, entretiennent avec la mémoire du génocide un lien particulier, et parmi ceux-ci on citera bien entendu Holocauste, ouvrage publié en 1975 par Charles Reznikoff et qui a marqué un tournant.
La « littérature lazaréenne » – pour reprendre une expression forgée par Jean Cayrol, autrement dit les récits issus de l’expérience concentrationnaire durant la Seconde Guerre mondiale – est un corpus en soi, dans lequel le témoignage fait l’épreuve d’une « mise en forme » à la fois impossible et nécessaire, puisque la parole tourne autour d’un indicible qu’il faut néanmoins restituer. Il existe d’autres textes qui, bien qu’émanant d’écrivains n’ayant pas vécu directement l’horreur de la Shoah, entretiennent avec la mémoire du génocide un lien particulier, et parmi ceux-ci on citera bien entendu Holocauste, ouvrage publié en 1975 par Charles Reznikoff et qui a marqué un tournant.Dans Holocauste, Reznikoff s’est appuyé sur des compte-rendu de procès, où abondaient les témoignages de victimes, pour restituer, via un montage brut mais réfléchi, ce point de bascule de l’Histoire. S’absentant de l’œuvre, l’auteur se pose en artisan, composant une mosaïque qui, à la fois dans le détail et par son ampleur, permet au lecteur d’affronter l’horreur des camps selon une perspective polyphonique. Dans un esprit similaire, on citera également nachschrift (1986/93/97, de Heimrad Bäcker, récemment paru en France sous le titre transcription(cf. biblio).
*
Bien qu’uniques en leur genre, ces ouvrages, qui ont marqué un tournant dans l’approche « textutelle » de l’horreur concentrationnaire et de l’extermination humaine, ont été précédés dans leur démarche singulière par un ouvrage recourant au même procédé « accumulatif ».Publié par l’Office français d’édition en 1946 (mais l’achevé d’imprimer est du 15 novembre 1945), le volume IV des « Documents pour servir à l’histoire de la guerre, intitulé Camps de concentration, offre un saisissant précédant aux textes de Reznikoff et Bäcker. Réalisé par Eugène Aronéanu – pénaliste et pionnier de la théorie du crime contre l’humanité –, sous la houlette de Jacques Billet, directeur du Service d’information des Crimes de guerre, ce volume se veut une "synthèse" de l’horreur concentrationnaire. Comme l’explique Aronéanu dans sa courte préface :
« J’ai pensé qu’il fallait faire connaître à l’opinion publique mondiale que l’Allemagne nationale-socialiste dans son ensemble […] n’était plus qu’un immense camp de concentration et que par conséquent si l’on voulait faire autre chose qu’un récit de plus, il fallait établir un document de synthèse. […] Ce travail concernant l’entité ‘camps’ ne doit pas faire mention de certains en particulier et c’est pourquoi aucun d’entre eux n’est cité dans le texte […]. En effet, chaque témoignage n’est qu’une fraction d’un ‘crime unique’ dont nous voulons reconstituer ici l’exécution. »Pour parvenir à cette "reconstitution », Aronéanu s'est fondé sur cent témoignages et vingt-cinq rapports et a effectué un montag obéissant à des « thèmes », en procédant de façon chronologique, montage qui débute avec les entrées Départ, Arrivée, Vols, Vêtements, Habitation, Nourriture, Hygiène… pour s’achever par celles de Gazage, Crémation, Libération. Sur près de deux cents pages, les citations s’amoncellent, uniquement protégées par des guillemets et assorties d’un chiffre qui permet d’identifier leurs sources. (Les noms des témoins et la liste des rapports figurent, avec le numéro correspondant, en début de volume). Dans une optique pénale, l'auteur a également dégagé, en exergue, quatre « chefs d’inculpation » ayant servi à "justifier" les arrestations : Racial, National, Religieux et Politique.
En décidant de « gommer » la spécificité des camps, comme celle des nom de lieux et de personnes, l'auteur de cette somme a donc, à sa façon et ce sans volonté formaliste ou poétique, devancé le travail de Reznikoff. En fondant en une litanie éparse la masse des témoignages, mais sans pour autant laisser dans l’anonymat ceux et celles qui nous les ont livrés, ce volume tend néanmoins vers le même but que s’étaient fixé un poète objectiviste comme Reznikoff ou une figure de l’avant-garde autrichienne comme Heimrad Bäcker : restituer, par un montage brut (bien qu’ici soumis à une ligne à la fois chronologique et thématique), l’expérience concentrationnaire.
Les témoignages cités peuvent aller d’une simple phrase – « La stérilisation était pratiquée » ; « Les coups de pied et de matraque pleuvaient, même si on était malade » – à des récits ou descriptions plus circonstanciées :
« On nous prévenus que le chef de block était fou et qu’il fallait s’en méfier. En effet, il passait parmi nous avec une énorme cravache formée d’un gros fil téléphonique de 1 centimètre de diamètre et frappait au hasard dans les rangs. »L’ouvrage est suivi d’un appendice d’une cinquantaine de pages, une « liste des camps, kommandos et prisons ayant servi à l’internement », ainsi que d’un cahier photos comportant une petite centaine de clichés – insoutenables – et d’un plan, une « carte des camps de l’Allemagne nazie ». Sa lecture, brute et brutale, montre que, bien avant Reznikoff et Bäcker, des auteurs ayant eu à cœur de dénoncer l’horreur nazie, ont senti que, en plus des nombreux rapports, ouvrages historiques, analyses documentées, etc. dédiés à l'extermination humaine, il importait de livrer au public, telle quelle, la parole des survivants, dans sa matérialité nue, hors toute spécification locale, afin, peut-être, de rendre sensible moins l’infamie des camps de concentration que l’inquiétant phénomène que représentait, selon certains, cette « concentration des camps » totalement inédite. Un chœur hagard s'élève ici parmi les cendres:
…
« A partir d’octobre-novembre 1944, le charbon nécessaire au four crématoire n’arrivait plus et les cadavres ne pouvaient être brûlés. Ils restaient entassés auprès du four et les Allemands, soucieux de l’harmonie, les faisaient placer par paquets de 500 en tas réguliers. Les cadavres étaient placés tête bêche et, en attendant le charbon, ce sont des milliers de cadavres qui restaient entassés dans la cour du four crématoire. En mars, après les premiers rayons du soleil, les cadavres ont commencé à sentir mauvais. »
"Et pendant que des transports d'innocents se dirigeaient vers le four, de l'autre côté de l'allée, l'orchestre jouait de grands airs."
BIBLIO
Documents pour servir à l’histoire de la guerre, Vol. IV, Camps de concentration, édité par le Service d’Information des crimes de guerre, Office français d’édition (1946-
Holocauste, de Charles Reznikoff [On pourra consulter la traduction d’André Markowicz, aux éditions Unes, ou celle d’Auxeméry, paru en 1980 chez Bedou puis rééditée en 2007 par Prétexte éditeur]
transcription, de Heimrad Bäcker, traduit par Eva Antonnikov, éditions Héros-Limite, 2017
Published on July 12, 2019 01:51
July 1, 2019
CALLIGRAPHIE DES DESTINS DISCRETS – Marie Frering
 Le principe même de la discrétion fait qu’on peut rester aveugle à ses effets. En société, elle glisse, se faufile, et c’est tout juste si on remarque son élégance, tant l’oblitèrent les passes des matadors du verbe. En littérature, il en va pour ainsi dire de même – les écritures discrètes, qui vont souvent de pair avec des auteurs discrets, voire avec des éditeurs discrets, ne s’interdisent pourtant rien, elles ne sont pas nécessairement sèches, et certainement pas plates, elles sont souvent filetées, feuilletées, faussement frêles. Et peut-être exigent-elles, à leur tour, des lecteurs discrets. Allons plus loin : la discrétion, en littérature, est l’inverse de la distraction, là où l’une guette l’ombre, l’autre effraie sa proie. Non, ici, il convient de ne perdre pas une miette, de laisser la miette raconter le pain. Un instant d’inattention, et voilà mille festins escamotés. Mais laissons reposer la pâte. A qui chercherait une métaphore permettant de mieux saisir ce qu’est cette discrétion, nous proposerons, à l’instar de Marie Frering, dont vient d’être publié un recueil de nouvelles intitulé L’heure du poltron, le tricot. Une activité en apparence anodine, ne requérant que quelques doigts et un peu de lumière, du fil embobiné, et ce qu’il faut de patience pour éviter qu’une maille sautée défasse tout l’ensemble, rappelez-vous le rat et le lion, et n’oubliez pas une certaine Dentelière. Une activité somme toute assez proche de l’écriture, par ailleurs.
Le principe même de la discrétion fait qu’on peut rester aveugle à ses effets. En société, elle glisse, se faufile, et c’est tout juste si on remarque son élégance, tant l’oblitèrent les passes des matadors du verbe. En littérature, il en va pour ainsi dire de même – les écritures discrètes, qui vont souvent de pair avec des auteurs discrets, voire avec des éditeurs discrets, ne s’interdisent pourtant rien, elles ne sont pas nécessairement sèches, et certainement pas plates, elles sont souvent filetées, feuilletées, faussement frêles. Et peut-être exigent-elles, à leur tour, des lecteurs discrets. Allons plus loin : la discrétion, en littérature, est l’inverse de la distraction, là où l’une guette l’ombre, l’autre effraie sa proie. Non, ici, il convient de ne perdre pas une miette, de laisser la miette raconter le pain. Un instant d’inattention, et voilà mille festins escamotés. Mais laissons reposer la pâte. A qui chercherait une métaphore permettant de mieux saisir ce qu’est cette discrétion, nous proposerons, à l’instar de Marie Frering, dont vient d’être publié un recueil de nouvelles intitulé L’heure du poltron, le tricot. Une activité en apparence anodine, ne requérant que quelques doigts et un peu de lumière, du fil embobiné, et ce qu’il faut de patience pour éviter qu’une maille sautée défasse tout l’ensemble, rappelez-vous le rat et le lion, et n’oubliez pas une certaine Dentelière. Une activité somme toute assez proche de l’écriture, par ailleurs.Si l’on vous parle ici de tricot, c’est parce que le personnage de la première nouvelle du recueil, qui s’intitule « La Renarde », confectionne un chandail. Fermez les yeux. Ecoutez le cliquetis des aiguilles. Déjà votre pensée vague, et peut-être s’y invite autre chose, y dansent d’autres sons, ceux par exemple qui fraient dans les livres de Rilke, Hölderlin, Stifter, Moritz, les auteurs fétiches de la femme au tricot, qui, « par ailleurs », écrit des poèmes. « La Renarde tricote, ses yeux divaguent vers la petite fenêtre où les dentelles de givre ont vaincu les araignées et rompu leurs toiles. Elle est presque aveugle. Les mains croisent le fer des aiguilles, l’index en crochet règle la tension du fil et la laine est engloutie à toute allure. La mémoire construit avant, arrière, manches, bordures de côtes, mailles à l’endroit, à l’envers, les filées glissent comme un navire léger. » Voyez comme la discrétion, mine de rien, fait cent choses à la fois – dentelle, toiles, escrime, dévoration, navette, vaisseau… On est dedans, dehors, dans l’atelier, au gymnase, à table, en pleine mer. Touches légères, indices semés. Qui sait ce que l’esprit tricote en douce ? Martha Gregor-Jäklin, la Renarde, quel âge lui donnez-vous ? « On dirait une vieille miséreuse au fond d’un isba. Mais la renarde n’a pas trente ans, même si son visage émacié et marqué par la scrofule la fait paraître bien plus âgée. Sous cet accoutrement, dans ce corps éprouvé et sous ce sobriquet, vit une femme à l’âme tumultueuse et vive, visitée, si ce n’est assaillie sans cesse par les mots et les phrases. » Pour vivre en poésie, vivons voûté. La discrétion est une ruse, comme le savent très bien certains insectes, capables d’épouser un devenir-brindille, un devenir-corolle.
Dans toutes les nouvelles écrites par Marie Frering, on retrouve la présence envoûtante d’une langue, moteur secret animant en coulisse les cœurs de ses personnages. Démasquée, la Renarde sera traitée de sorcière et connaîtra un sort digne de ses sœurs de Salem. Dans « La Patrie », une femme qui habite Strasbourg se rend chaque soir de l’autre côté du Rhin, à Kehl, pour jouer au casino, et faire chanter les machines à sous. Mais c’est moins la passion du hasard ou l’appât du gain qui motivent ces déplacements que le besoin de se retrouver en pleine Babel : « Ses comparses des bistrots de jeux sont turcs, serbes, bosniaques, russes, italiens, polonais, arméniens, bulgares, géorgiens, roumains, maghrébines. […] Tout le monde communique en sabir, et pense que Lydie est grecque. » Dans « Le coureur », un certain Youri renonce à ses ambitions olympiques – il est marathonien – pour fuir l’Union soviétique, travailler comme docker (et écrire des poèmes). Dans « Nocturne anversois », Cornelius s’improvise traducteur et voilà qu’une fièvre le précipite dans un décor de Rembrandt et en plein Verhaeren. Dans le monde de Frering, les textes sont des révélateurs, des intrus, ils bousculent, s’immiscent, impossible d’errer dans Baden-Baden sans que s’allonge l’ombre de Dostoïevski, inutile de se fier à son manteau puisque Gogol n’est pas loin… Prague, Hiroshima, Saint-Pétersbourg. Les lieux et les peaux se traversent, la conscience est passe-partout, et c’est dans la plus grande discrétion que le temps tue, que les écrits brûlent.
Dans L’ombre des montagnes, paru il y a huit ans chez Quidam, Marie Frering s’aventurait dans Sarajevo et se préoccupait, discrètement, du sort d’arbres assassinés. Avec L’heure du poltron, elle continue de tisser de clairs récits, imprégnés d’effluves pouchkiniens, où, une maille à l’endroit, une maille à l’envers, rêveurs et sorcières tentent de traverser « le bruit du temps », comme autrefois Mandelstam.
Marie Frering, L’heure du poltron, éd. Lunatique, 14€
Published on July 01, 2019 07:12
Christophe Claro's Blog
- Christophe Claro's profile
- 12 followers
Christophe Claro isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



